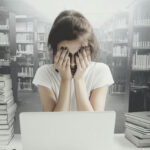Féminicides : du fait divers au fait de société

Longtemps relégués à la rubrique « faits divers », le féminicide est désormais considéré comme un problème systémique. Une prise de conscience progressive, fruit de stratégies mises en place par des collectifs féministes.
« Drame de la jalousie », « tragédie conjugale », « tuée par amour »… En 2003, Bertrand Cantat roue de coups Marie Trintignant et la tue. À l’époque, et jusqu’au milieu des années 2010, nombreux sont les médias et les fans qui souscrivent à la thèse des amants « qui s’aimaient trop ». Il n’est pas si loin, le temps où les féminicides étaient romantisés et perçus comme des faits divers isolés. En mars 2025, une série documentaire diffusée sur Netflix revient sur ce meurtre à travers le prisme du féminicide. Le mythe du crime passionnel a disparu. Comment une telle prise de conscience collective a-t-elle pu avoir lieu ? La réponse se trouve peut-être dans les rangs féministes.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
En 2014, c’est « Osez le féminisme » qui, le premier, tente d’alerter les pouvoirs publics sur le caractère systémique des crimes sexistes à travers une campagne qui trouve peu d’écho. Pour faire sortir le féminicide de l’indifférence, les collectifs féministes imaginent alors deux outils chocs : les collages dans l’espace public, et la publication d’un décompte des féminicides, à partir de 2016. « Les chiffres sont le levier le plus efficace dans la lutte contre les violences, parce que quand on est féministe, on nous reproche beaucoup de fonctionner à l’idéologie, on nous parle de morale. Quand on produit des données quantitatives, il n’y a aucun contre-argument possible », analyse Maëlle Noir, militante au sein du collectif #NousToutes, membre de l’Inter Orga Féminicides.
À l’époque, le terme « féminicide » est reconnu par l’ONU et vient de faire son entrée dans le dictionnaire. Il n’est pas connu du grand public, et quasiment jamais utilisé par les journalistes. Les collectifs militants évoluent, et les outils aussi. Les premiers recensements ne comptabilisent que les cas de féminicides au sein du couple – environ 65% des meurtres sexistes – et invisibilise ainsi les autres femmes tuées à raison de leur genre. « À #NousToutes, nous avons décidé d’améliorer notre système décompte pour inclure les féminicides qui ont lieu en dehors des couples. Nous avons constaté que les meurtres les plus invisibilisés étaient ceux perpétrés sur des personnes déjà minorisées comme les femmes trans, handicapées ou les travailleuses du sexe. Nous avons donc créé l’Inter Orga Féminicides pour travailler avec des associations qui œuvrent sur le terrain et qui nous apportent une remontée d’information que nous n’avons pas », précise Maëlle Noir. Un travail de recensement bénévole qui pallie les carences de l’État en la matière.
Ce décompte permet aussi aux militantes féministes de focaliser l’attention davantage sur la victime que sur l’auteur du crime. Une manière de rompre avec la tradition des rubriques « faits divers » qui entretient une fascination pour les hommes qui tuent et qui perpétue le mythe du monstre. Dans les colonnes des journaux pourtant, le traitement des féminicides évolue au fil des années. Selon la dernière enquête de #NousToutes publiée en novembre 2024, l’expression « crime passionnel » a disparu presque systématiquement des articles de presse en cinq ans de temps et le mot « féminicide » est vingt-huit fois plus utilisé dans les médias en 2022 qu’en 2017.
Au-delà de l’évolution sémantique, l’enquête pointe aussi une mise en contexte plus importante des meurtres misogynes : ils ne sont plus seulement évoqués comme des cas isolés mais aussi comme des faits de société, comme le point d’orgue du continuum des violences sexistes. L’évolution du rubriquage des médias est parlant : en 2022, cinq fois plus d’articles concernant des cas de féminicides sont classés dans les rubriques « société », au détriment des « faits divers ».
Si les médias et leurs lecteurs sont mieux informés quant aux violences sexistes, les décisions politiques se font attendre. Malgré la mobilisation des associations sur le sujet, le féminicide n’a d’ailleurs toujours aucune existence pénale. À l’image des « téléphones grave danger », les quelques mesures qui ont été mises en place ces dernières années ne concernent que les violences au sein des couples. Des dispositifs qui, selon Maëlle Noir, ne voient le jour qu’à la suite de meurtres très médiatisés : « Les pouvoirs publics n’interviennent que ponctuellement, lorsqu’un cas de féminicide marque les esprits, comme s’il ne s’agissait que de cas individuels. Finalement, c’est l’État plus que les médias qui rentre dans une logique de faits divers dans sa lutte contre les violences, au lieu de traiter le problème de manière systémique. »