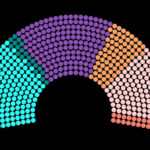Patrick Boucheron : « Après la hantise xénophobe vient celle du genre »

Alors que l’extrême droite mondiale fait de la question du genre un champ de bataille politique, l’historien Patrick Boucheron analyse les ressorts profonds de cette obsession. Pour lui, la haine de la différence sexuelle n’est pas qu’un outil de diversion : elle touche à un fond anthropologique, où se rejoue la peur de l’altérité. Face à cette offensive réactionnaire, il plaide pour une lucidité critique et un optimisme de méthode.
Regards. Patrick Boucheron, vous êtes un historien, medieviste, spécialiste du pouvoir et vous avez consacré une année de votre séminaire au collège de France à la question du genre. Une question nous taraude : comment expliquer que la « révolution réactionnaire », dont Donald Trump est un porte-drapeau, ait fait de la question du genre un fer de lance ? Lors des élections, dans une de ses dernières adresses aux Américains, il listait cinq raisons de voter pour lui et la cinquième était « la lutte contre les transgenres ». Pourquoi ce thème prend-il aujourd’hui une telle place ?
Patrick boucheron. La première chose à faire, c’est de s’étonner. Objectivement, les personnes trans sont peu nombreuses ; on pourrait croire que la question est marginale ou en passe d’être socialement acceptée. Pourtant, elle surgit comme question primordiale et existentielle. Vous citez Donald Trump. L’exemple le plus frappant pour moi reste Jair Bolsonaro : il a réussi à convaincre qu’au Brésil le problème principal n’était ni la pauvreté, ni la destruction de l’Amazonie, ni les désastres sociaux, mais la « déstabilisation » anthropologique provoquée par l’irruption de la question du genre. C’était obsessionnel, au cœur de sa campagne et cela a fonctionné.
On peut l’expliquer par la vieille thèse de la diversion, qui consiste à déplacer les colères sociales vers les problèmes identitaires. Les premières études américaines sur les raisons pour lesquelles les pauvres votent républicain contre leurs intérêts vont dans ce sens : on les persuade que les problèmes qu’ils vivent ne sont pas leurs vrais problèmes, qu’il y en a de plus graves. Après la hantise xénophobe viendrait celle du genre. Mais je pense qu’il y a davantage qu’une instrumentalisation. Ces leaders sont d’autant plus convaincants qu’ils sont convaincus. L’argentin Javier Milei l’est, l’étasunien Donald Trump le sont. Le milliardaire Elon Musk a switché sur ce point en passant d’un libéralisme aimablement démocrate à une posture férocement républicaine. Pourquoi ? Parce que la haine de la différence sexuelle est la mère de toutes les détestations. On touche à un fond d’anthropologie politique.
Vous dites qu’il ne faut pas s’enfermer dans l’analyse du discours réactionnaire. Pourquoi ?
Parce que c’est un piège. On finit par réagir au réactionnaire, par commenter sans fin des discours de haine. Prenez le zemmourisme : au départ, il y a une rancœur masculiniste, une haine des femmes ; tout le reste n’en est qu’une déclinaison. On peut passer des années à en démonter les ressorts. Je préfère déplacer le regard : d’où vient la force de ces affects, pourquoi ça prend, comment cela s’ancre dans des sociétés où, du point de vue des pratiques, la tolérance progresse.
Certes, dans les pratiques, la société paraît moins raciste, moins homophobe, plus tolérante. Pourtant dans les discours et dans les urnes, le bloc réactionnaire pèse, notamment chez les jeunes hommes. On parle de « retour de balancier », de « backlash ». Ça vous inquiète ?
Oui. Les enquêtes montrent des progrès d’acceptation ; mais le vote d’extrême droite, ou d’une droite xénophobe et autoritaire, devient plus jeune et plus masculin. L’écart hommes/femmes est marqué sur certaines classes d’âge. L’idée de backlash est séduisante car elle met un nom simple sur ce que l’on vit politiquement : « On est allés trop loin, ça revient ». Pourtant je m’en méfie. Parler de retour du balancier supposerait qu’il est parti très loin d’un côté. Or, sur les violences faites aux femmes, en France, ça commence seulement. #MeToo a été amorti et retardé ; des milieux professionnels entiers n’ont pas fait leur examen de conscience. Où aurait-on « trop » avancé ? Nulle part. Et l’argument commode des « pauvres hommes » qu’il faudrait protéger contre tant d’ingratitude et de cruauté me fait sourire : c’est devenu un sous-genre littéraire que de témoigner du chagrin de l’homme blanc. On a même vu récemment le PCF condamné à une amende parce qu’il y avait trop de femmes sur une liste ; la preuve qu’on peut encore détester l’égalité en la caricaturant.
« On observe une mise à jour de nos pratiques et de nos langages : des termes qui n’existaient pas il y a vingt ans (comme féminicide) ont remplacé des fables (crime passionnel). On s’aperçoit que des choses acceptées hier nous horrifient aujourd’hui. C’est une révision biographique à l’échelle d’une vie, qui oblige chacune et chacun d’entre nous à faire – et c’est passionnant – son examen de conscience. »
Vous restez pourtant optimiste?
Plutôt, oui. Je pense à Michelle Perrot, qui est un peu la doyenne des historiennes et des historiens : si elle adopte un optimisme de méthode, c’est parce qu’elle connaît si bien la culture du mouvement ouvrier et celle des luttes féministes. Les acquis peuvent être violemment trahis mais ils reviennent par vagues et par relais générationnels. Nous l’avons vécu en préparant la nouvelle édition de l’Histoire mondiale de la France qui se prolonge jusqu’en 2024 (et c’est Michelle Perrot qui nous a fait l’honneur d’écrire ce dernier chapitre). Lors de cette année, trois événements ont battu des records d’accréditations de journalistes étrangers en France – la cérémonie d’ouverture des JO, la réouverture de Notre-Dame et le procès des violeurs de Gisèle Pelicot. Cette triade dit quelque chose : la diversité et le spectacle assumés ; un patrimoine catholique remis en lumière ; et l’exemplarité d’un procès de violences sexuelles, avec l’icône mondiale qu’est devenue Gisèle Pelicot. Autre moment décisif : la constitutionnalisation de l’IVG. C’était un moment ambigu mais nécessaire, né de la prise de conscience que, contrairement à l’aimable chanson que l’on se fredonnait sur l’air de « Jamais on ne reviendra sur la légalisation de l’IVG », il était plus prudent d’établir un cran institutionnel. Politiquement, c’est instructif : voir des responsables de droite – Aurore Bergé a joué un rôle, Gérard Larcher l’a dit publiquement – changer d’avis aussi pour des raisons intimes (« Si je vote contre, je ne pourrai plus déjeuner en paix avec ma fille et ma petite-fille »). Et constater que parmi les derniers réfractaires, il y a beaucoup de femmes : on peut être antiféministe en étant femme.
La remise en cause du patriarcat est une révolution anthropologique extrêmement rapide, tout au plus un siècle. C’est forcément déstabilisant. Vous comprenez cet argument pour expliquer le « retour de bâton actuel » ?
Oui, la profondeur de la transformation est réelle et accélérée. Mais cela ne valide pas l’idée d’un backlash « normal ». L’histoire des luttes sociales montre plutôt des retours après des reculs. Ce que j’observe, c’est une mise à jour de nos pratiques et de nos langages : des termes qui n’existaient pas il y a vingt ans (comme féminicide) ont remplacé des fables (crime passionnel). On s’aperçoit que des choses acceptées hier nous horrifient aujourd’hui. C’est une révision biographique à l’échelle d’une vie, qui oblige chacune et chacun d’entre nous à faire – et c’est passionnant – son examen de conscience.
Sur la longue durée : la domination masculine est-elle universelle et intemporelle ou bien s’est-elle raidie au 19ème siècle ?
Les anthropologues, comme Françoise Héritier, ont décrit une « valence différentielle des sexes » qui place toujours le masculin du côté du dominant. Mais l’ordre patriarcal qui nous régit aujourd’hui se met en place au 19ème siècle : par le truchement du Code Napoléon, de la bourgeoisie triomphante, du victorianisme. C’est l’ordre des pères, masculin et bourgeois, qui assoit ce moment de raidissement normatif qui accompagne l’industrialisation. Si l’on veut comprendre nos contraintes actuelles, c’est là qu’il faut regarder, pas dans un patriarcat médiéval fantasmé.
Reprenant les idées écoféministes, vous liez la domination des femmes et l’exploitation de la Terre…
Oui. L’écoféminisme (je pense à Émilie Hache et à son grand travail publié en 2024 sous le titre De la génération, enquête sur sa disparition et son remplacement par la production) éclaire un imaginaire commun : le virilisme extractiviste est une sexualisation brutale de la nature comme du corps des femmes. Quand Donald Trump lance son slogan « Drill, baby, drill », tout y est : la pénétration du sol, l’affirmation d’une toute-puissance masculine. Longtemps, le féminisme a résisté à la naturalisation (l’idée que la femme serait par essence plus proche de la nature), en rappelant que le genre est une construction. Mais face au fait que les mêmes acteurs (Trump, Bolsonaro et consorts) s’en prennent à la fois aux femmes et à l’écologie, il faut reposer ces questions. Et repenser la hiérarchie entre création (ex nihilo, virile, séminale) et génération (travail de la vie, transformation) : elle traverse nos arts et nos savoirs.
« L’histoire de la condition féminine ne se fait pas avec quelques destins extraordinaires : elle se lit dans les collectifs, les pratiques, les rapports de pouvoir. »
Vous êtes médiéviste. Que vous enseignent les « femmes puissantes » du Moyen Âge : Hildegarde de Bingen, Aliénor d’Aquitaine, Christine de Pizan ?
Qu’il ne faut pas confondre exemplarité et condition. Oui, il y a des exceptions. En 1980, Régine Pernoud a montré, dans La femme au temps des cathédrales, qu’il existait des marges de manœuvre pour certains « femmes puissantes ». Mais l’histoire de la condition féminine ne se fait pas avec quelques destins extraordinaires : elle se lit dans les collectifs, les pratiques, les rapports de pouvoir. Reste que Christine de Pizan est, à mes yeux, la grande penseuse politique de la fin du Moyen Âge. Veuve, obligée de faire vivre les siens, elle invente une issue – « Le génie est l’issue qu’on s’invente dans les cas désespérés », disait Sartre. Elle ne flatte pas le pouvoir ; elle pense l’insoumission. On a rappelé aux Jeux olympiques que le premier « homme de lettres » vivant de sa plume en France est… une femme : Christine de Pizan. Ce n’est pas un gadget symbolique.
Certaines historiennes comme Arlette Farge, étonnent en affirmant qu’au 18ème siècle, au 19ème, des femmes du peuple avaient parfois plus de capacité d’agir, voire de liberté, que les bourgeoises corsetées, au sens propre et au sens figuré.
Il ne faut ni idéaliser ni mépriser. Dans la scène urbaine, des femmes du peuple avaient une puissance d’agir plus visible. Détail significatif : le corset. Noué devant, on peut l’ajuster seule ; noué derrière, il appelle la domestique… Signe aristocratique par excellence. Renverser le corset, pour les femmes du peuple au 18ème siècle, c’est renverser un ordre. Mais sur la sexualité, le mariage, les violences, le contrôle des naissances, l’asymétrie reste massive. D’où l’utilité du concept d’intersectionnalité : il ne décrit pas un empilement mécanique de déterminations, mais au contraire des croisements multiples des rapports de domination. Être femme de la très haute bourgeoisie d’origine maghrébine, n’expose pas aux mêmes contraintes qu’être homme blanc déclassé. Parfois cela se compense, souvent cela s’additionne ; en tout cas, cela complexifie. L’intersectionnalité sert à ne pas être dupe des représentations homogénéisantes : « le peuple », « les femmes ».
Vous avez participé à l’écriture de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques. La mise en avant de figures féminines, le recours à la statuaire, n’était-ce pas une « histoire exemplaire » ?
Si, et je l’assume. Idéalement, je préférerais une société sans héros. Mais aujourd’hui, puisque l’espace public est saturé de héros masculins, nous avons besoin de figures féminines pour créer des effets de reconnaissance. Voir Axelle Saint-Cirel chanter la Marseillaise cheveux détachés, c’est permettre à des petites filles issues de la diversité de se reconnaître. Ce n’est pas suffisant intellectuellement mais c’est efficace symboliquement. Quant aux statues : oui, c’est une galerie ; oui, on peut nous reprocher d’opposer une imagerie à une autre ; mais faute de mieux, ou en attendant mieux, ce geste qui consiste à rendre visible ce qui ne l’était pas assez compte. On a évoqué les noms de femmes scientifiques sur la Tour Eiffel : quand il y avait soixante-douze hommes et aucune femme au 19ème siècle, chercher autant de noms féminins oblige à compléter le tableau. On élargit la mémoire, on n’invente pas. Et surtout, on ne remplace rien.
Que valoriser, que raconter : la foule ou les personnes ?
Il faut les deux. Le mouvement de la foule et l’intensité des noms et des visages. On reconnaît une personne, pas une abstraction. Les Culottées de Pénélope Bagieu relèvent de l’histoire exemplaire, certes, mais elles produisent des effets de reconnaissance utiles – y compris pour des adolescentes. Mais remplacer Napoléon ou Louis XIV par des héroïnes et croire que nous sommes quitte : non. Il faut compléter le patrimoine (donner des modèles d’identification) et faire l’analyse des structures. Sans quoi on met au même niveau des glorieuses exceptions et des conditions ordinaires. Nous savons toutes et tous que l’idéal serait une société où l’on n’aurait pas besoin de héros. En attendant, donner à voir des femmes compte.
Vous dites vouloir « penser contre soi », revenir sur ce qu’on a aimé, dit, fait. Qu’est-ce que cela veut dire quand on est Patrick Boucheron ?
C’est accepter que l’on ne regarde plus de la même manière qu’auparavant et que certaines œuvres peuvent nous tomber des yeux. Ainsi par exemple du cinéma de Bertrand Blier, que j’ai beaucoup aimé adolescent, parce qu’il me libérait. Mais comme je comprends aujourd’hui que cette libération se fait au prix d’une domination qui nous est désormais inacceptable, il me faut réviser mon jugement. Cela n’a rien à voir avec la « cancel culture » mais avec l’évolution ordinaire des goûts et des valeurs. Mon écrivain préféré était et reste aujourd’hui Vladimir Nabokov : je comprends que la lecture de Lolita puisse aujourd’hui poser problème, mais je sais pourquoi je le lis. Le but n’est pas de se flageller, mais de faire un retour critique sur nos attachements.
Vous n’êtes pas un historien du genre, mais historien des pouvoirs. Pourquoi vous être saisi de ces questions au Collège de France?
Parce que je suis un homme blanc, bien né, bientôt soixante ans, professeur au Collège de France, je me situe toujours du bon côté des structures de domination. Celui qui parle depuis une telle position d’autorité doit chercher à déjouer la violence de sa propre parole. C’est pourquoi je choisis volontairement des objets qui m’affaiblissent, je veux dire des objets pour lesquels je ne suis pas le mieux placé. J’essaie d’aller là où ma parole tremble, de « marcher sur des œufs ».
« Beaucoup de haines politiques rejouent la peur de la différence sexuelle : la peur du trouble dans le genre, du mélange, de l’indétermination. C’est un ressort archaïque et brutal, qui explique la force de ces thèmes aujourd’hui. »
Or, tout aujourd’hui semble au contraire célébrer la force nue, ce qu’Achille Mbembe appelle le brutalisme. À rebours, je préfère fréquenter un champ qui, par sa vivacité et parfois sa virulence polémique, oblige à penser : celui des épistémologies féministes. Lire Camille Froidevaux-Metterie, Manon Garcia, Émilie Hache, c’est découvrir un foisonnement intellectuel qui bouscule, qui dérange et donc qui stimule. Ceux qui rejettent ce champ d’études par principe font preuve d’une ignorance militante : ils se privent d’un pan entier de la bibliothèque contemporaine.
Car au fond, ce que révèlent ces lectures, c’est que beaucoup de haines politiques rejouent la peur de la différence sexuelle : la peur du trouble dans le genre, du mélange, de l’indétermination. C’est un ressort archaïque et brutal, qui explique la force de ces thèmes aujourd’hui. Les réactionnaires y puisent leur puissance parce qu’ils accèdent à cette force archaïque. Comprendre d’où vient la haine de la différence sexuelle, repérer ses relais contemporains (médias, droit, économie), verrouiller quand il le faut, nommer et montrer pour la reconnaissance, et revenir à chaque vague. On peut reculer. Mais on finit toujours par revenir à l’endroit que l’on avait laissé. Autrement dit, il nous appartient toujours de relever les promesses non tenues. Comprendre cela, sans fascination mais avec lucidité, c’est se donner les moyens de résister. C’est cela l’histoire : se souvenir de tout ce qui reste à faire.
***
Cet article est extrait du n°63 de la revue Regards, publié en octobre 2025 et toujours disponible dans notre boutique !
***