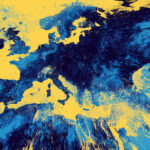Loi Duplomb : l’avenir de l’agriculture ne se fera pas sans les agriculteurs

En débat à l’Assemblée nationale après avoir été voté au Sénat, le texte Duplomb révèle les impasses écocidaires de la droite et le manque de lien de la gauche avec les agriculteurs.
« Lever les contraintes à l’exercice du métier d’agriculteur » : tel serait l’objet central de la proposition de loi du sénateur Les Républicains, Laurent Duplomb. Dans sa version sortie de la Haute Chambre, le texte prévoit de réintroduire certains pesticides (dont les néonicotinoïdes, interdits en 2018), la possibilité d’épandage par drones et la construction facilitée de mégabassines. Il est aussi proposé l’affaiblissement de l’indépendance de l’Anses, autorité en charge d’examiner les demandes d’autorisation des produits phytopharmaceutiques.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
À l’Assemblée nationale, la gauche était à pied d’oeuvre pour modifier la future loi. Plus de 2000 amendements avaient ainsi été déposés par le groupe Écologiste et social et les insoumis notamment. Pour parer l’éventualité d’un texte complètement remanié, la droite l’a rejeté par 49.3 (alors qu’elle était pour !) pour s’en remettre en commission mixte paritaire à la première initiale. Les principaux syndicats d’agriculteurs, la FNSEA, les Jeunes Agriculteurs notamment, sont largement favorables au texte Duplomb et travaillent activement avec la droite politique pour peser dans le débat. La Coordination rurale aussi, même si elle est moins à la manœuvre en ce moment. Seule la Confédération paysanne, classée à gauche, s’y oppose.
Les questions de souveraineté sont au centre du débat politique. Notre alimentation en est l’un des piliers. A gauche, les programmes sont clairs en la matière, que ce soit chez les écologistes ou chez les insoumis : il faut que la France se dote d’un projet alternatif en matière agricole. Les Français comme les agriculteurs le savent : leur survie passent par la qualité de leur production, écologiquement soutenable, dans un cadre économique qui assure au travail une juste rémunération. Dont acte. Mais là où le bât blesse, c’est que l’organisation de la lutte de gauche dans ce secteur relève davantage du registre des idées que du mouvement social.
Lors des élections syndicales de janvier dernier, la FNSEA et les Jeunes Agriculteurs ont perdu la majorité des suffrages, mais conserve leur domination avec 46,7% des suffrages recueillis. La Coordination rurale, qui a axé sa campagne sur une dénonciation de la co-gestion avec l’État, a obtenu 29,9% des voix. La Confédération paysanne, proche de la gauche, stagne à 20,5%.
Si la gauche veut avoir voix au chapitre agricole, elle a besoin des agriculteurs. Or, aujourd’hui, comme depuis trop longtemps, ce n’est plus vraiment le cas : agronomes et scientifiques sont davantage convoqués que celles et ceux qui travaillent la terre. Voire ils sont mis en opposition.
Le modèle d’agrobusiness, qui découpe les terres arables en grandes exploitations pour une toujours plus forte rentabilité, tend à devenir majoritaire. Selon l’Insee, les très grandes exploitations valorisent désormais 36% du territoire agricole et sont en augmentation constante. Dans le même temps, les mobilisations pour dénoncer les difficultés à vivre se multiplient sans que les « plans » gouvernementaux n’apportent de réponse valable et pérenne.
Bien sûr, la mécanisation comme l’introduction des pesticides et des engrais ont permis une amélioration considérable des conditions de travail des agriculteurs. Évidemment aussi, la dépendance aux investissements s’est accru et le recourt aux pesticides peut générer des maladies et aggraver la crise écologique. Rationaliser en offrant un avenir à la filière agricole, en harmonie avec les êtres humains et avec la nature, est donc une nécessité urgente. Le faire avec les agriculteurs, c’est-à-dire les premiers concernés mais aussi les travailleurs du secteur, en est un prérequis.