Hannah Arendt : « La terreur est l’essence du gouvernement totalitaire »

Son identité, son histoire, sa relation amoureuse avec le philosophe nazi Martin Heidegger : la vie de Hannah Arendt a fait d’elle une des philosophes et politistes les plus citée dans les débats sur le totalitarisme, le sionisme, le nationalisme. Ce long entretien permet de mieux comprendre cette femme et cette pensée des plus marquantes de la modernité.
Regards. Merci, madame Arendt, de répondre à nos questions depuis votre dernière résidence, à New York. Vous avez une formation de philosophie et vous vous dites politologue. Vous êtes américaine, d’origine allemande. Rappelez-nous les conditions de votre départ d’Allemagne ?
Hannah Arendt. Je suis née en 1906 à Hanovre, dans une famille juive. Mon père est mort alors que j’avais six ans. Mon grand-père était président de la communauté juive libérale de la ville. Ma mère était une fervente admiratrice de Rosa Luxemburg. La bibliothèque familiale était très fournie et j’ai pu lire, jeune, les poètes et les philosophes grecs et allemands. Après mon baccalauréat, j’ai suivi des études de philosophie d’abord avec Martin Heidegger puis avec Karl Jaspers. Ma thèse a traité du concept d’amour chez Augustin.
J’ai quitté l’Allemagne en 1933. Jeune, j’ai été tout simplement naïve. Être une femme et être juive faisait partie des faits indubitables de ma vie. Ce que l’on appelait la question juive m’ennuyait. Mais bien avant 1933, l’indifférence n’était plus possible. Dès 1931, j’étais intimement persuadée que les nazis allaient prendre le pouvoir.
Ce qui s’est passé le 27 février 1933, l’incendie du Reichstag et les arrestations illégales qui ont suivi la nuit même, fut un terrible choc pour moi. À ce moment, je me suis sentie responsable. Je ne pensais plus que l’on pouvait rester un simple spectateur. J’ai essayé d’apporter mon aide de diverses façons dans une organisation sioniste. J’avais en effet acquis deux certitudes : que l’appartenance au judaïsme était devenue un problème politique ; que si quelqu’un est attaqué en tant que juif, il doit se défendre en tant que juif. Pas en tant qu’Allemand, pas en tant que citoyen du monde, pas en tant que partisan des droits de l’homme.
J’avais l’intention d’émigrer de toute façon. Je n’avais pas l’intention de me balader en Allemagne comme une sorte de citoyenne de seconde zone. Mais j’ai été arrêtée. J’ai dû quitter le pays clandestinement. Ce fut pour moi une gratification. Je me disais qu’au moins j’avais fait quelque chose. Au moins, je n’étais pas « innocente ».
J’ai connu une vie d’exilée en France de 1933 à 1940. Avant même la capitulation française, j’ai été internée au camp de Gurs. Je m’en suis évadée, j’ai retrouvé par hasard mon second mari, Heinrich Blücher, à Montauban, et nous avons réussi à embarquer vers les États-Unis à partir de Lisbonne. J’ai acquis, à ma demande, la citoyenneté américaine en 1951. Même avant le nazisme, je ne me suis jamais considérée comme Allemande. Mais ce qui m’est toujours restée, c’est la langue maternelle.
J’ai dit adieu à la philosophie. J’ai continué à avoir une activité politique parmi les sionistes jusqu’en 1948. Mon métier, si je puis dire, c’est la théorie politique. Les hommes se soucient toujours d’avoir de l’influence. Cela m’est assez extérieur. Ce que je veux, c’est comprendre.
Vous avez été une jeune élève et amoureuse passionnée de Martin Heidegger, philosophe qui, à tout le moins, a pris le train du nazisme. Et après 1950, vous avez renoué avec lui des liens amicaux. Cela a beaucoup nuit à votre crédit… Qu’en a-t-il été ?
En 1958, j’ai renoncé à la dédicace à Martin Heidegger que j’avais projetée pour mon livre La condition de l’homme moderne. Dans mon journal de pensées, j’ai noté : « La dédicace de ce livre est laissée en blanc. Comment pourrais-je le dédier à celui, si proche, envers qui j’ai gardé toute fidélité et je ne l’ai point gardé. Tous deux avec amours ». Cela exprime ce que, pour moi, il en a été.
Est-ce que l’amour que j’ai eu pour Martin Heidegger a altéré mon jugement sur sa compromission avec le nazisme ? Dans le livre Vies Politiques, j’ai regroupé des textes que j’ai écrit sur des personnalités comme Rosa Luxemburg, Walter Benjamin, Karl Jaspers ou Bertolt Brecht, dont la vie et leur œuvre ont fait briller, dans les temps sombres, de la lumière même incertaine et vacillante. Parmi ces portraits figure celui de Martin Heidegger rédigé à l’occasion de ses 80 ans. Cela peut sembler choquant. Mais après la guerre de 1914, quand la crise de la modernité était déjà là, que les temps sombres avaient déjà commencé et que le règne de la tradition s’écroulait, Martin Heidegger a redonné vie à l’activité de penser. Non pas penser sur quelque chose mais penser quelque chose.
Qu’en est-il lorsque l’activité de pensée débouche sur ce qu’il a dit être son « erreur » vis-à-vis du nazisme ? Chez lui, la pensée solitaire s’est perdue dans les ramifications de la forêt. J’ai parlé de faute professionnelle d’un philosophe. Il ne faut pas y voir une minimisation ou une excuse. Le penchant tyrannique peut se constater, dans leur théorie, chez presque tous les grands penseurs. Marx y compris, avec la dictature du prolétariat. Kant est la grande exception, Aristote en est une autre qui, ayant sous les yeux l’exemple de Platon, a conseillé aux philosophes de ne pas vouloir jouer les rois dans le monde de la politique. Au contraire pour Heidegger, Platon était la référence. Et pour lui, comme je l’ai écrit, cela a encore plus mal tourné parce que la tyrannie et ses victimes se trouvaient dans son propre pays.
Dans la mesure où le nazisme d’Heidegger serait au moins pour une part le fruit de sa pensée, est-ce que ma propre pensée n’en serait pas comme infestée ?
La dédicace non publiée dit assez bien que « la condition de l’homme moderne », et pas seulement ce livre, doit beaucoup à Martin Heidegger. Pas parce que j’aurais essayé de monter sur ses épaules, mais parce que j’ai essayé de progresser par la critique de son œuvre. J’ai cherché à comprendre ce qui faisait défaut : l’échange de paroles, la pluralité, la capacité humaine d’initiative, de création, de nouveau commencement en tant que conditions de la politique.
On évoque souvent votre livre Les origines du totalitarisme. Son premier tome porte sur l’antisémitisme. Vous analysez sa longue histoire jusqu’à l’affaire Dreyfus. Vous affirmez que la France avait 30 ans d’avance sur la question juive. La France a donc été un terreau de l’émergence du fascisme…
Avec Les origines du totalitarisme, j’ai voulu comprendre l’événement que fut le totalitarisme. Comprendre comment, au moment où j’ai vécu, un régime qui a pulvérisé nos catégories politiques et nos critères de jugement moral a pu advenir et durer. Ma démarche a consisté à en découvrir et analyser les principaux éléments, l’antisémitisme et l’impérialisme. Ceci dans la mesure où ils ont, en quelque sorte, non pas causé, mais cristallisé dans le totalitarisme. C’est pourquoi, ce livre traite non pas de la haine historique du juif, d’origine religieuse, mais de l’histoire juive en Europe centrale et occidentale à l’époque du développement des États-nations et de l’antisémitisme, idéologie laïque du dernier quart du 19ème siècle. L’affaire Dreyfus est le dernier chapitre du livre.
L’affaire dure de 1894 à 1906. Durant toutes ces années, la France a été comme le symbole de la grande vague d’antisémitisme qui s’est propagée en Europe. C’est en réalité le seul épisode où les forces souterraines du 19ème siècle se sont montrées dans la pleine lumière de l’Histoire. Il a généré une idéologie, des organisations de masse, des organes de presse, des intellectuels qui ont imprégné durablement la société française. La fin de l’affaire les a fait rentrer dans l’ombre. Mais ils n’avaient pas disparu. Pour les juifs en Europe, la seule conséquence visible de l’affaire Dreyfus a été la naissance du mouvement sioniste, seule réponse idéologique et politique que les juifs aient trouvé à l’antisémitisme. Mais la France avait découvert dans des slogans tels que « Mort aux Juifs » ou « La France aux Français », des formules presque magiques permettant de réconcilier les masses avec le gouvernement et la société.
Cela a cristallisé 40 ans plus tard. Avant tout parce que la France n’avait plus de vrais dreyfusards, plus personne qui crût pouvoir encore défendre ou réaliser la démocratie, la liberté, l’égalité et la justice dans un régime républicain. La République est tombée comme un fruit mûr dans la main de la vieille clique antidreyfusarde. Le clan de Pétain n’était en rien un produit du fascisme allemand. Et les dirigeants français de Vichy adoptèrent promptement une législation antijuive tout en se vantant de n’avoir aucun besoin de l’antisémitisme importé d’Allemagne et de l’originalité de leurs lois concernant les Juifs par rapport aux lois du Reich.
Vous avez été une activiste sioniste de 1933 à 1948. Vous avez ensuite rompu avec le sionisme, car opposée à la création d’Israël telle qu’elle s’est déroulée. Quelle était votre idée, votre proposition ?
J’ai toujours considéré qu’il existe un peuple juif et que j’en fait partie. Je m’inscris en faux contre « l’existentialisme » sartrien qui a défini le juif comme celui qui est considéré et défini comme juif par les autres. Une connaissance même sommaire de l’histoire juive permet de comprendre le souci constant de la survie du peuple juif en dépit des dangers énormes résultant de sa dispersion. Cette appartenance ne signifie pas soutien ou approbation de tout ce qu’il fait ou de tout ce que ses dirigeants font. La critique de ce qui est fait en votre nom est indispensable. Cela n’a rien à voir avec la haine de soi. Mon ami Gershom Scholem m’a reproché mon manque d’amour pour le peuple juif. Je lui ai répondu que, de toute ma vie, je n’ai jamais aimé quelque peuple que ce soit, ni le peuple allemand, ni le peuple français, ni le peuple juif, ni le peuple américain, ni la classe ouvrière, ni quoique ce soit d’autre du même genre. Je n’aime effectivement que mes amis. Un jour, Golda Meir m’a dit : « En tant que socialiste, je ne crois pas en Dieu, je crois dans le peuple juif ». Je ne lui ai pas répondu. J’ai été effrayée. Si le peuple juif ne peut croire qu’en lui-même, que peut-il en sortir ?
En 1941, j’ai appelé à la formation d’une armée juive constituée de volontaires juifs issus de tous les pays. Pour la simple raison que la liberté n’est pas une récompense pour la souffrance que l’on endure. Mais elle ne peut pas être une récompense pour la souffrance que l’on fait endurer. C’est pourquoi je n’ai été, comme l’a dit mon ami Hans Jonas, qu’un hôte de passage dans le sionisme. En fait, j’ai toujours été opposé à la version nationaliste du sionisme, celle de Herzl, qui repose sur le présupposé d’un antisémitisme éternel et qui considère qu’une nation est un groupe d’individus liés par un ennemi commun.
En 1942, le programme de Biltmore adopté par l’Organisation sioniste mondiale a formulé pour la première fois les objectifs politiques des juifs. À savoir, un État juif unitaire en Palestine avec l’octroi de certains droits des minorités aux arabes de Palestine, qui, en réalité, à l’époque, composaient encore la majorité de la population. Sous la houlette de Ben Gourion, le mouvement sioniste s’est en fait aligné sur les révisionnistes qui envisageaient ouvertement un transfert des Palestiniens arabes vers des pays voisins. Et il a renforcé son désintérêt à l’égard des juifs européens autrement que comme émigrants vers la Palestine.
« Le régime totalitaire constitue un monde de mensonges se substituant à la réalité. En utilisant massivement l’arme de la propagande, il établit un monde fictif capable de concurrencer le monde réel. »
Dès ce moment, j’ai marqué mon opposition à l’État-nation juif en Palestine, mais également à la partition de la Palestine en deux petits États nationaux. En 1943, j’ai préconisé l’alternative de l’incorporation du foyer national pour les juifs à une perspective de fédération. Soit dans le cadre d’un Proche-Orient qui aurait trouvé sa place au sein d’un nouveau Commonwealth, soit dans une sorte de Fédération méditerranéenne, voire même élargie en Europe. Sans réclamer un État-nation qui leur soit propre, les juifs de Palestine et de la diaspora auraient pu avoir le même statut politique que les autres peuples de la Fédération, et la Palestine aurait eu le statut particulier de foyer juif.
En 1948, j’ai encore plaidé pour cela. Comme vous le savez, cette vision ne s’est jamais concrétisée. Le second livre dans Les origines du totalitarisme est L’impérialisme. En quoi le distinguez-vous des traditionnelles conquêtes qui ont parcouru les siècles ? Quel lien avec l’avènement du totalitarisme ?
J’ai traité uniquement de l’impérialisme colonial strictement européen à partir de 1884 et qui a pris fin, après la domination totalitaire, avec la liquidation de la domination britannique en Inde, lorsque la France a abandonné l’Algérie et, plus tard, pour le Portugal. La caractérisation comme impérialiste de cette période de l’histoire n’est pas originale. Voyez Hobson, Hilferding, Rosa Luxemburg ou même Lénine. Même si je suis en désaccord total avec sa caractérisation comme stade suprême du capitalisme. L’histoire ne connaît ni loi, ni nécessité.
Il reste que ce sont les dépressions des années 1860 et 1870 qui ont ouvert l’ère de l’impérialisme. Elles ont joué un rôle décisif en contraignant la bourgeoisie à prendre conscience que le péché originel du pillage pur et simple de « l’accumulation primitive du capital » allait devoir se répéter si l’on ne voulait pas voir soudain mourir le moteur de l’accumulation.
Il ne fallait donc pas s’étonner si, comme je l’ai écrit pour l’édition de 1968 du livre, en pleine guerre du Vietnam, les actions et les paroles qui donnaient à la politique un caractère si menaçant présentaient une ressemblance sinistre avec les actions et les justifications verbales qui ont précédé le déclenchement de la Première guerre mondiale.
Même si la connaissance du passé ne permet pas de connaître le futur, il est donc à craindre que cela reste durablement un enjeu. Du reste, L’impérialisme s’ouvre sur une citation de Cecil Rhodes, homme d’affaires de la deuxième moitié du 19ème siècle et figure majeure de l’impérialisme britannique en Afrique du Sud : « Si je le pouvais, j’annexerais les planètes ».
Quant aux liens avec le totalitarisme, ils sont multiples. À commencer par l’alliance entre la populace et les élites, entre les hommes superflus rejetés par les crises de la société productive et les capitalistes superflus qui vont chercher à prospérer ailleurs. Il y a surtout le racisme et la bureaucratie qui sont les deux moyens visant à imposer autorité et domination sur les populations étrangères. Ces deux « découvertes » ont été mises en œuvre d’abord dans le continent africain. Le racisme conduisit aux massacres les plus terribles, à des exterminations de tribus entières. Il servit en même temps de justification à toute l’entreprise coloniale. Puis par extension dans les politiques étrangères ordinaires. Et peut être pire que tout, il devint un moyen normal et permanent de la politique. Le racisme et la bureaucratie, à l’origine indépendants l’un de l’autre, se sont révélés à maints égards étroitement liés. Et l’on sait la place qu’ils ont occupée ensemble dans l’organisation totalitaires des camps de concentration et des massacres de masse.
L’impérialisme européen continental, ayant moins de possibilités ailleurs, a cherché à s’étendre en Europe en s’appuyant sur la base d’un nationalisme tribal pangermaniste et panslave et avec l’expansion d’un racisme totalement idéologique qui a débouché sur un antisémitisme violent.
Il y a, enfin, les contradictions et les limites de l’État-nation du fait de sa transformation d’instrument de la loi, en instrument de la nation. Cette transformation a fait émerger et a multiplié les groupes qui perdent les droits de l’homme : les minorités, les réfugiés, les apatrides, les colonisés. Ils sont contraints à vivre en dehors du monde commun, exclus des droits à la liberté, des droits d’agir, du droit d’avoir une opinion. Ce droit d’avoir des droits devrait valoir pour tous les humains mais les États les ont établis et organisés, et ils n’ont plus valu que pour les nationaux.
Vous avez proposé le concept de totalitarisme qui fut beaucoup discuté par les historiens. Pouvez-vous nous dire ce qu’il recouvre ? Par-delà leur différence essentielle, vous mettez sur un même plan, nazisme et stalinisme. Pourquoi ?
J’ai travaillé sur le livre Les origines du totalitarisme à partir de 1943. Le projet initialement uniquement centré sur le nazisme a effectivement évolué avec une meilleure connaissance du stalinisme. Ce que j’ai compris du totalitarisme m’a amené à souligner notamment les points suivants : s’il ne vient pas de nulle part et s’il s’inscrit dans la modernité, le totalitarisme est un régime sans précédent. Il constitue quelque chose de différent des tyrannies, des dictatures, des révolutions et des contre-révolutions. À la fois dans son essence, son principe et son gouvernement. Les régimes totalitaires ont surgi quand la majorité des gouvernements européens étaient des dictatures. Mais le régime totalitaire ne vise pas seulement à contrôler une population. Il détruit toutes les traditions sociales, juridiques et politiques. Son ambition est l’élimination de la politique, la destruction de la pluralité, l’éradication totale de la liberté intérieure et extérieure des hommes.
Le principe du régime totalitaire est son idéologie. Il prétend organiser un peuple avec une seule idée susceptible de l’animer. Et il prétend aussi étendre cette domination à l’échelle mondiale. Peu importe que cette idéologie soit aussi inepte et dépourvue de culture spirituelle authentique que le racisme ou qu’elle soit imprégnée de ce qu’il y a de meilleur dans notre tradition comme le socialisme. Le socialisme et le communisme sont devenus une idéologie lorsqu’ils ont prétendu être un système d’explication de la vie et du monde qui se flatte d’être en mesure d’expliquer tout événement, passé ou futur, sans faire autrement référence à l’expérience réelle. Le régime totalitaire constitue un monde de mensonges se substituant à la réalité. En utilisant massivement l’arme de la propagande, il établit un monde fictif capable de concurrencer le monde réel.
La terreur est l’essence du gouvernement totalitaire. Et cette terreur est différente de celle de la tyrannie ou de celle des guerres civiles ou des révolutions. En fait, le tournant qui décide si un système restera seulement une dictature ou se développera en régime totalitaire tient en ce que la terreur continue et s’amplifie lorsque le régime n’a plus d’ennemis, lorsque toutes les classes de suspects sont éliminées. La terreur totalitaire se tourne alors vers des gens absolument innocents. Et elle s’intensifie. La catégorie des fins et des moyens ne s’applique même plus. La terreur n’est même plus un moyen d’assujettir les gens par la crainte, mais une fin à laquelle les gens sont sacrifiés.
S’agissant du gouvernement, j’ai souligné notamment l’organisation en oignon des structures du pouvoir avec le chef au centre dans une sorte d’espace vide ou le rôle crucial de la police secrète. Et c’est un fait que tout ceci caractérise le régime stalinien autant que le régime nazi. Y compris, les camps de concentration qui sont les plus importantes institutions de la domination totalitaire. Après Staline, l’URSS est devenue une tyrannie. Les régimes totalitaires ont été éliminés mais pas la fabrique moderne des hommes superflus. Les solutions totalitaires peuvent fort bien ressurgir chaque fois qu’il semblera impossible de soulager la misère politique, sociale et économique d’une manière qui soit digne de l’homme.
Vous avez couvert, pour le New Yorker, le procès d’Adolf Eichmann en Israël en 1961. Vous y avez forgé le très célèbre concept de « banalité du mal ». Ce fut une polémique mondiale. On vous accusa d’amoindrir la responsabilité d’Eichmann dans la mise en œuvre de la solution finale. Pouvez-vous revenir sur votre idée et les polémiques qu’elles ont suscitées ?
J’ai voulu aller au procès Eichmann à Jérusalem et en rendre compte parce que j’ai voulu voir l’un des principaux coupables en chair et en os. Je voulais savoir qui était Eichmann et qu’avait-il fait ? Non pas dans la mesure où ses crimes faisaient partie intégrante du système nazi mais dans la mesure où il était un sujet libre. Et cela m’a permis de mieux comprendre la nature du mal, une question à laquelle je n’ai jamais cessé de penser.
La polémique sur le livre a été effectivement systématique et mondiale. Ce à quoi l’on a assisté, à mon avis, c’est à un effort concerté et organisé pour créer une « image » et pour substituer cette image au livre que j’avais écrit. Des déformations volontaires, des falsifications complètes qui n’ont pu avoir de l’effet que parce qu’elles étaient organisées et massives. Quant à l’auteur qu’on attaque, il ne peut pas faire grand-chose de plus que répéter, après Anatole France : « Si l’on m’accusait d’avoir volé les tours de Notre-Dame, je m’enfuirais ».
J’en viens à la banalité du mal qui figure dans le sous-titre du livre et qui le conclut. Contrairement à ce qui a été dit ou écrit, rien n’est plus éloigné de mon propos que de minimiser le plus grand malheur du monde. Rien non plus qui vise à diminuer la responsabilité et la culpabilité d’Eichmann. C’était sa défense qui prétendait qu’il se contentait d’obéir aux ordres, qu’il n’était qu’un bureaucrate, un exécutant passif.
Je n’ai parlé de banalité du mal qu’au niveau des faits en mettant en évidence un phénomène qui sautait aux yeux lors du procès. Je n’ai pas ôté à Eichmann son caractère diabolique, démoniaque ou simplement criminel. J’ai simplement constaté qu’il n’en avait pas. Il a agi avec conscience, en toute conscience, sauf que celle-ci lui dictait de réaliser, par-dessus tout, la volonté du Führer. Et il s’est soumis à une inversion du devoir moral. Non plus « Tu ne tueras point » mais « Tu tueras ».
Au cœur de cela, ce qui m’a frappé chez Eichmann, c’est son absence de pensée. Ce qui est tout à fait différent de la stupidité. Eichmann n’était pas stupide, il était dans l’incapacité de juger, de se mettre à la place d’autrui, d’être affecté par les conséquences de ses actions sur autrui. Quand il pensait, Eichmann ne pensait qu’à l’impact de ce qu’il faisait sur sa carrière. C’est cela que j’ai appelé la banalité du mal. Même dans un régime de terreur, nul n’est obligé d’abandonner son humanité. Pour le dire en termes politiques, la plupart des gens se soumettra, mais certains ne le feront pas. Et pour les pays auxquels la solution finale a été proposée, cela n’est pas arrivé partout, comme au Danemark. Humainement parlant, nous ne demandons rien de plus, et rien de plus ne peut raisonnablement être demandé, pour que cette planète reste un lieu propre à l’habitation humaine.
Le pire mal n’est finalement pas radical, mais seulement extrême. Il ne possède ni profondeur, ni dimension démoniaque. Il peut tout envahir et ravager le monde entier précisément parce qu’il se propage comme un champignon.
***
Cet article est extrait du n°63 de la revue Regards, publié en octobre 2025 et toujours disponible dans notre boutique !
***




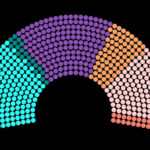

Mais qu’est-ce que c’est que ça ?!!
Voilà que vous nous présentez un entretien, daté du 25/12/25 sans préciser de quoi il s’agit ? Hannah Arendt étant morte en 1975, est-ce une republication auquel cas où est la source ?! Est-ce un exercice de style ? Auquel cas pourquoi ne pas l’introduire ?
Bref, votre approche est trompeuse et indigne. Vous faites croire des choses fausses à ceux qui n’auraient pas le contexte.