Ukraine : sale temps pour la paix

Se prétendant homme de paix, Donald Trump entend forcer l’Ukraine à renoncer à la Crimée, sous occupation russe depuis 2014. La puissance pour seule boussole…
À ce jour, les tractations autour du conflit russo-ukrainien se nouent autour de trois acteurs, avec pour chef de file Donald Trump – le président américain s’étant institué en porte-parole du reste du monde. C’est lui qui a décidé de faire de Vladimir Poutine son interlocuteur privilégié et qui pèse pour un règlement dans lequel la Crimée sera officiellement reconnue comme faisant partie de la Fédération de Russie.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
La Crimée a été hellénistique pendant dix-sept siècles, ottomane pendant trois siècles et russe pendant deux siècles. Elle a été l’objet de conflits armés incessants, où se jouait l’accès à la mer – et donc à la puissance –, où les meilleures raisons du monde ont été multipliées pour dresser les peuples les uns contre les autres, au nom de la civilisation, de la religion ou de la nation éternelle.
Il en fut ainsi pendant la très longue période où la guerre était la méthode par excellence pour juger de qui est assez fort pour imposer « son » droit. Au 20ème siècle, au lendemain des deux hécatombes mondiales, on semblait pourtant s’être mis plus ou moins d’accord sur l’idée que la souveraineté des États, le droit international, le droit des peuples et ceux des individus étaient la seule manière de nous sortir de la loi de la jungle. Peut-être sommes-nous en train de revenir sur ce pari d’humanité.
Il n’est pas vrai qu’il ne nous reste qu’à choisir entre la capitulation et la course infinie à la puissance. Il n’y a pas que des despotes continentaux. Il y a des États qui s’inquiètent, des peuples et des individus qui ne se résignent pas à la mort.
En 1997, dans les tensions russo-ukrainiennes avivées par la dislocation de l’URSS, tout semblait s’acheminer vers un possible apaisement. Après une longue période de confusion, la Russie avait en effet décidé de reconnaître officiellement le rattachement de la Crimée à l’Ukraine. Mais en 2014, profitant de la crise extrême dans laquelle l’Ukraine se trouva plongée, le dirigeant russe a décidé que le moment était venu de revenir sur la parole donnée. Avec 140 millions d’habitants contre une quarantaine et une position de seconde puissance militaire du monde, à quoi bon faire semblant d’être gentil ?
Poutine et ses séides fomentent alors un coup de force, soutenu par l’armée russe, qui débouche sur la sécession de la Crimée et, dans la foulée, sur son intégration dans la Russie. À l’époque, les États-Unis et l’Europe refusent le coup de force, tout comme une Assemblée générale de l’ONU, par 100 voix contre 11 et 58 abstentions. L’ONU qui exprime ce refus n’est certes plus la grande organisation régulatrice qu’elle a été, parce que l’on a tout fait, États-Unis en tête, pour tenir l’Organisation à l’écart de ce qui compte. Mais, même divisé, quel lieu de concertation et d’arbitrage est plus légitime que celui-là ?
Pour l’instant, où en est-on ? À l’initiative du président américain, les dirigeants de deux États-continents décident de ce qui est légitime, en se fondant sur la force cynique et non pas sur l’éthique commune ni sur un droit international manifestement tenu pour périmé. Si l’on allait jusqu’au bout de cette logique, il serait donc acquis désormais que le tracé des frontières, la maîtrise des territoires et la propriété des ressources relèvent strictement d’un rapport des forces réduit à son expression la plus primitive : la loi du plus fort.
Le monde est au bord du désastre climatique, la faim et les pandémies se répandent. Les conflits répertoriés sont au nombre de 130 et la course à l’armement a repris de façon massive, au grand dam du haut-commissaire de l’ONU pour les réfugiés, qui vient de se dire effaré par un monde « aveuglé par l’idée que seule une victoire militaire totale convient« . Dans ce monde inquiétant, ne déciderait que le petit nombre des États qui combinent l’étendue continentale ou quasi continentale, la force du nombre, la richesse, la maîtrise technologique et la centralisation extrême des pouvoirs !
Dans le cadre étroit qui est le sien, sans l’Europe et hors de l’ONU, la négociation tripartite en cours risque de déboucher sur une impasse ou sur de nouvelles rancœurs. Ce fut le cas avec la « paix des vainqueurs », ces traités qui, de Versailles à Sèvres (1919-1920), démantelèrent les Empires, humilièrent l’Allemagne et rabaissèrent l’Italie. En 2025, n’aurions-nous donc le choix qu’entre une resucée de Versailles ou un remake de Munich ?
Or il n’est pas vrai qu’il ne nous reste plus qu’à choisir entre la capitulation et la course infinie à la puissance. Il n’y a pas que des despotes continentaux ou des satellites potentiels des plus puissants. Il y a des États qui s’inquiètent, des peuples et des individus qui ne se résignent pas à la mort, des sociétés civiles qui ne rêvent pas d’un univers de realpolitik. Pour l’instant, toutes et tous ne sont pas des acteurs, mais de simples spectateurs.
En fait, une solution durable et digne ne peut se trouver que dans un cadre cohérent : la suspension des hostilités, l’ouverture de négociations sous l’égide des Nations unies et la soumission de tout accord conclu à l’approbation des populations concernées, dans un laps de temps raisonnable et sous contrôle onusien.
Au moment où ces lignes sont écrites, nous sommes bien loin d’un scénario de ce type. C’est pourtant le plus raisonnable.



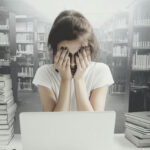


Lors de la dissolution de l’Union soviétique en 1991, un accord fut signé entre Mikhaïl Gorbatchev et George Bush, obligeant l’OTAN à ne pas s’étendre plus à l’est.
En 1994, Clinton décida unilatéralement de retirer cet accord de non-expansion de l’OTAN, et en 1999, l’OTAN s’étendit à la Hongrie, à la Pologne et à la République tchèque.
La Russie de Boris Eltsine protesta officiellement, mais personne en Occident ne remarqua la violation de l’accord, et la Russie refusa d’entrer en guerre, car ces pays étaient éloignés de sa frontière.
En 2004, l’OTAN poursuivit son développement en violation de l’accord de 1994, intégrant l’Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Bulgarie, la Roumanie, la Slovénie et la Slovaquie.
La Russie se rétrécit. En 2007, Poutine déclara « ça suffit », mais la diplomatie occidentale décida de l’ignorer.
Puis, en 2008, l’OTAN a décidé de conclure des traités pour l’intégration de l’Ukraine et de la Géorgie, pays limitrophes de la Russie.
La Russie a de nouveau protesté officiellement, soulignant que si elle décidait d’installer des bases au Canada ou au Mexique, les États-Unis déclencheraient immédiatement une guerre. L’Occident a continué à l’ignorer.
La Russie a alors décidé de déclarer la guerre à la Géorgie pour cette raison (casus belli), comme nous le savons tous, et la Géorgie a été bombardée.
Continuons. En 2010, les États-Unis ont déployé des missiles en Pologne et en Roumanie, violant une nouvelle fois l’accord de 1994.
La même année, le peuple ukrainien a élu Viktor Ianoukovitch à la présidence, dans le cadre d’un programme gouvernemental promettant la neutralité entre la Russie et l’OTAN.
En 2014, la Russie et l’Ukraine ont signé un accord par lequel la Russie souhaitait louer Sébastopol pour 25 ans. Il n’était pas question d’annexer la Crimée ou le Donbass.
Mais en 2014, les États-Unis ont tenté de renverser Ianoukovitch, comme en témoigne l’appel scandaleux et tristement célèbre entre Victoria Nuland et l’ambassadeur américain en Ukraine, Geoffrey Pyatt, qui a fuité.
Vient ensuite le traité de Minsk II, qui a instauré l’autonomie des régions russophones de l’est de l’Ukraine. Cet accord a été soutenu à l’unanimité par le Conseil de sécurité de l’ONU.
Mais les États-Unis et la nouvelle Ukraine sont intervenus, estimant que cela ne serait pas obligatoire. L’Ukraine a massacré plusieurs milliers de citoyens russophones dans le Donbass, Zelensky étant l’intellectuel et le principal organisateur de ces inondations génocidaires.
En 2022, les États-Unis ont revendiqué le droit de déployer des missiles « n’importe où » en Ukraine, et Blinken a déclaré à Lavrov que les États-Unis installeraient des systèmes de missiles n’importe où en Europe, et pas seulement en Ukraine.
Et c’est ce casus belli qui a conduit la Russie à déclarer la guerre à l’Ukraine : faire respecter l’obligation de l’OTAN de ne pas s’étendre vers l’est. Ni plus, ni moins.
L’intention de Poutine, avec cette guerre, est de stopper l’avancée de l’OTAN (contrainte depuis 1994 à ne pas se développer) et de contraindre Zelensky à signer un accord de neutralité.
Zelensky était prêt, dès le septième jour de la guerre, à signer un accord de neutralité avec Poutine. Mais à la dernière minute, Zelensky a décidé de refuser de signer la demande directe de Joe Biden.
L’idée était d’intégrer l’Ukraine, la Roumanie, la Bulgarie, la Turquie et la Géorgie dans un anneau de blocus russe en mer Noire.
La guerre continue encore aujourd’hui. Et à cause de la décision de Biden et Zelensky, plus d’un million d’Ukrainiens ont péri dans une guerre insensée.
C’est là toute la vérité historique, ni plus ni moins, des événements entre la Russie, l’Ukraine et l’OTAN.
Tout le reste n’est que jérémiades d’ignorants qui ne comprennent rien à ce qui se passe dans cette région du monde et de gens qui gobent la propagande des deux camps sans aucun esprit critique.
C’est du Jeffrey Sachs dans le texte (sauf votre dernière phrase). Et on peut vous remercier de transmettre ces rappels historiques sans lesquels il n’y a pas de compréhension des enjeux, des volontés et des aveuglements qui ont conduit à cette guerre. Et sans cela, le risque est énorme de s’enfoncer dans une guerre plus étendue ou à une situation qui prépare un futur conflit.
Mais il est tout aussi important d’écouter Jeffrey Sachs pour ce qui est de l’avenir et du chemin que l’on devrait emprunter (il s’adresse aux européens). On peut écouter sa conférence du 17 février à l’invitation de je ne sais pas qui au Parlement Européen : « Professor Jeffrey Sachs at European Parliament » : https://youtu.be/u4c-YRPXDoM?si=t6iLizw5fzLyN9y2 avec les réponses aux questions.
C’est en anglais. (Il y a des sous titres et une transcription) et une traduction serait très utile . Quand on l’écoute, on voit qu’il est possible de tracer une route pour la paix qui n’est pas l’écrasement d’un camp par un autre.
Pour un extrait de 16m : https://youtu.be/xNMgJ83oh2M?si=I2Bp1vn7PTjf7yUE