On a lu pour vous « Les structures fondamentales des sociétés humaines » de Bernard Lahire

Déplorant l’absence de lois générales dans les sciences sociales, le sociologue Bernard Lahire se propose de faire la synthèse entre sciences de la nature et sciences sociales, expliquant que les premières permettent de comprendre les sociétés humaines.
Le sociologue Bernard Lahire a écrit une somme de 1000 pages intitulée Les structures fondamentales des sociétés humaines dans laquelle, déplorant l’absence de lois générales dans les sciences sociales, contrairement à la physique (les physiciens se reconnaissent dans Newton et Einstein) et à la biologie (la plupart des biologistes acceptent la théorie de l’évolution et la génétique), il se propose de faire la synthèse entre sciences de la nature et sciences sociales, expliquant que les premières permettent de comprendre les sociétés humaines.
Pour un biologiste, la chose semble évidente : les humains comme les autres espèces sont soumis à des contraintes reproductives, par exemple la nécessité de soins parentaux pendant près de 15 ans avant une autonomie minimale des descendants, et cela limite ou encadre ce que peuvent être les sociétés humaines. Pour donner un exemple connu, Karl Marx écrivait dans Salaire, prix et profit qu’« une succession rapide de générations débiles et à existence brève approvisionnera le marché du travail tout aussi bien qu’une série de générations fortes et à existence longue », une phrase qui rappelle les stratégies reproductives des mammifères, certaines espèces étant très prolifiques et vivant peu de temps (les souris) alors que d’autres, peu prolifiques, doivent vivre longtemps pour se maintenir en tant qu’espèce (les humains). Marx avait raison et tort à la fois. Raison, parce que la condition de la classe ouvrière britannique, décrite par exemple dans Le Capital, ne pouvait que mener à une mort précoce après une vie effroyable. Tort, parce que la journée de travail en Grande-Bretagne au 19ème siècle était si proche des limites physiologiques que ses dirigeants durent finir par la limiter pour ne pas voir la population disparaître à terme. Ces dirigeants, en rien des philanthropes, furent bien obligés de tenir compte des contraintes reproductives : si les ouvriers sont trop faibles pour élever leurs enfants et meurent trop tôt, avant que leurs enfants ne soient autonomes, il n’y aura personne pour « approvisionner le marché du travail » à la génération suivante. En résumé, la société doit s’adapter à la biologie humaine, parce que le contraire n’est pas possible très longtemps : des « générations débiles et à existence brève » ne sont pas équivalentes à des « générations fortes et à existence longue », y compris dans un domaine aussi social que le travail. Si les sociétés humaines ne peuvent que tenir compte de la biologie humaine et des contraintes reproductives, les sciences sociales doivent donc forcément le faire aussi, mais Bernard Lahire affirme le contraire : à tort ? Peut-être pas, car cela me rappelait que mes rapports avec un certain nombre de démographes avaient pu être houleux quand ceux-ci négligeaient les bases de la biologie humaine en faisant l’hypothèse, par exemple, d’une longévité maximale de 275 ans, une hypothèse qui n’a aucun sens pour un biologiste. Si Bernard Lahire a raison dans des domaines autres que la démographie, ce n’est pas une bonne nouvelle. C’était là la première surprise du livre : quoi que non sociologue, mais étant capable de lire au moins certains de leurs livres, j’étais persuadé que ce qui était évident pour moi, biologiste, l’était aussi pour les sciences sociales. De fait, après un premier chapitre où Bernard Lahire se lamente des conditions actuelles de la recherche scientifique — quel que soit le domaine — qui limitent la créativité par le peu de temps consacré réellement à la recherche, à cause de la chronophagie administrative entre autres, il décrit dans le chapitre suivant des sciences sociales rétives à l’idée de lois générales, à l’utilisation des données collectées par les prédécesseurs, et campées dans leurs « points de vue ». Plus grave, s’il est possible, Bernard Lahire écrit (p. 67) que « le nominalisme » des chercheurs en sciences sociales « se détache ainsi assez nettement du réalisme épistémologique pour qui… le réel existe indépendamment des savants qui l’étudient » : on a l’impression de lire la critique, par le philosophe communiste Georges Politzer dans Principes élémentaires de philosophie, des philosophes idéalistes pour qui la réalité n’est que la création de l’esprit, à qui s’opposent les matérialistes pour qui la réalité existe en dehors de nous.
Encore une fois, que la situation des sciences sociales soit celle-ci est difficile à comprendre pour un biologiste, mais l’auteur enfonce le clou dans les deux chapitres suivants. Si certains passages sont difficiles à suivre pour ceux qui ne sont pas au fait des débats en sciences sociales, on en retient, grâce à de nombreuses citations, qu’il y a bien un refus explicite de certains (nombreux ?) chercheurs en sciences sociales de la recherche de lois générales, par exemple en histoire ou en sociologie, pour se focaliser essentiellement sur les variations, ce que résume l’auteur en écrivant « pas de général, pas de grands principes structurants, pas de mécanismes généraux, mais seulement du contextuel, du particulier, du singulier, de l’éphémère, et l’éblouissement général devant l’infini foisonnement des différences ». En tous cas, si Bernard Lahire voulait convaincre qu’il y avait un problème, à la fin de ces premiers chapitres, c’est une réussite totale.
Logiquement, Bernard Lahire aborde alors la question de ceux ayant tenté d’aller contre cet état de faits en faisant « des essais de lois en sciences sociales ». Ce qui choque immédiatement est que, au-delà des précurseurs du 19ème siècle évidemment décédés, comme Auguste Comte, Karl Marx, mais curieusement pas Friedrich Engels dont on s’attendait à voir citée ici L’Origine de la famille, de la propriété privée et de l’État, ou Émile Durkheim, la plupart des autres sont morts, comme si ces tentatives d’établir des lois en sciences sociales n’intéressaient pas les chercheurs actuels. Mais il est vrai que Bernard Lahire nous a déjà expliqué cela dans les chapitres précédents, et ce simple fait semble le confirmer amplement.
Ce chapitre pourrait clore cette première partie du livre, mais elle se termine par un dernier faisant directement appel à la biologie qu’on s’attendait donc à trouver dans la seconde partie de l’ouvrage dont c’est le sujet majeur. L’auteur aborde en effet « les convergences anatomiques, comportementales, sociales et culturelles », un chapitre qu’un biologiste peut lire aisément car faisant appel à des notions de base en biologie, en particulier celle de convergence. En deux mots, il n’y pas forcément des milliers de solutions pour résoudre un problème, comme la nage, et il est attendu que la sélection naturelle va favoriser les individus qui s’approchent au plus près de la solution optimale, les autres, moins bien adaptés, ayant moins de chance de se reproduire et donc de transmettre leurs caractéristiques : par exemple, ceux qui nagent moins vite du fait de nageoires moins adaptées que d’autres ont plus de risque de finir sous la dent d’un prédateur et donc moins de chances de se reproduire. Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les poissons et les mammifères comme les baleines aient des nageoires qui semblent similaires, même si leur structure est très différente, les nageoires des baleines ayant évolué à partir de la structure des pattes de mammifère. La notion de contrainte en biologie est essentielle, une espèce donnée ne prospérant qu’en tenant compte des contraintes qui s’imposent à elles. Une méduse ne peut vivre que dans la mer car son absence de squelette lui rend impossible de survivre en dehors, comme on peut le voir à ces amas flasques sur nos plages si différents de leur grâce dans l’eau. Pour les sociétés humaines, la situation est similaire, les contraintes imposent des solutions qui ne sont pas infinies, et donc des convergences dans des sociétés qui ne se sont jamais rencontrées. Bernard Lahire cite l’exemple de l’emmaillotement des bébés, qui était la solution la plus pertinente pour protéger le nourrisson dans des milieux où la température des habitations n’était pas idéale.
Toutefois, ce chapitre soulève une question sur la notion de contingence que l’auteur semble opposer à celle de convergence. Du fait de la contingence, certaines espèces peuvent disparaître, comme les dinosaures, visiblement suite à la chute d’une météorite un peu trop grosse pour ne pas modifier le climat terrestre. À l’inverse, certaines espèces peuvent se maintenir parce que les conditions qui les ont fait disparaître ailleurs ne sont pas observées ici : si la séparation de l’Australie avait eu lieu plus tard, les mammifères placentaires auraient eu le temps de la coloniser et, comme ailleurs, d’évincer les marsupiaux, ce qui est donc une pure contingence ayant des effets primordiaux pour l’évolution des espèces. Autre exemple, il existe une île au large des États-Unis séparée du continent depuis 4000 ans sur laquelle ont prospéré des opossums en l’absence de prédateurs. Dans ces conditions, ces animaux vivent 25% de plus que sur le continent, ont deux saisons reproductives au lieu d’une, mais avec moins de petits par saison (4 à 6 au lieu de 6 à 9). L’absence de prédateurs a permis cette évolution : puisqu’il n’est plus nécessaire de se reproduire au plus vite, les opossums laissant plus de descendants au final (8 à 12 est plus grand que 6 à 9) sont sélectionnés. Ce résultat est donc lié à la contingence : sans formation de l’île, et donc l’absence de prédateurs, les opossums n’auraient pas évolué ainsi. Cela ne change rien au fait que, pour toutes les espèces, les contraintes auxquelles elles font face imposent des solutions convergentes : de nombreux prédateurs peuvent imposer une reproduction rapide, simplement parce que les parents ont peu de chances de survivre longtemps, cas des souris. Pourquoi donc écrire « à la contingence s’oppose le déterminisme de la convergence », alors qu’il s’agit, selon moi, de deux problèmes différents ? Si, pour des raisons contingentes (ou accidentelles) le processus évolutif est modifié, donnant naissance à de nouvelles espèces qui ne seraient peut-être pas apparues sous cette forme ou au même moment, il n’empêche que ces nouvelles espèces devront tenir compte des contraintes de leur environnement, de la physique, de leur propre biologie, etc., pour prospérer, sinon elles ne se maintiendront pas, ce qui implique une convergence des solutions : pour se déplacer en utilisant des pattes, il faut être bipède, quadrupède, ou encore marcher en trépied comme les insectes avec leurs six pattes, mais il ne semble pas exister d’animal marchant sur cinq pattes, peut-être simplement parce qu’il ne serait pas possible d’avoir un mouvement coordonné et régulier, d’abord sur trois pattes et ensuite sur deux, ce qui fait qu’un tel animal n’aurait eu aucune chance de se maintenir en vie et de se reproduire (c’est pour ça qu’on cherche en vain les moutons à cinq pattes ou les dahus).
Ce livre est important et sa tentative de faire la liaison entre la biologie et les sciences sociales est bienvenue, en particulier par sa volonté d’asseoir les sciences sociales sur le concret de la vie ordinaire.
La deuxième partie de l’ouvrage s’intitule « ce que les sociétés humaines doivent à la longue histoire du vivant ». Après deux chapitres où l’auteur fait un détour par les précurseurs faisant le lien entre la biologie et les sciences sociales, il rentre dans le vif du sujet en exposant tour à tour les caractéristiques des sociétés humaines liées aux contraintes reproductives (longue dépendance des enfants par exemple) et au fait que l’espèce humaine construit son environnement, chaque génération trouvant à sa naissance l’accumulation de toutes les connaissances et acquis des générations précédentes, contrairement aux espèces animales qui, même si elles peuvent utiliser des outils, voire transmettre de nouveaux comportements, ne sont pas des « espèces culturelles » caractérisées par cette accumulation. Dans le dernier chapitre de cette deuxième partie, le plus long du livre, l’existence de « grands faits anthropologiques », comme la grande longévité humaine (pages 339-342), conduit l’auteur à tirer des « lignes de force », comme ici la dépendance des personnes âgées à l’égard des « productifs », et donc leur domination par les adultes jeunes (pages 360-362). Puis, il énonce 16 « lois générales » des sociétés humaines, au sens qu’elles sont universelles et « fonctionnent depuis le début de l’histoire de l’humanité », comme le tabou de l’inceste, ou celle de « l’accroissement démographique tendanciel » qui n’a été possible de manière de plus en plus rapide chez les humains qu’à partir du moment où l’agriculture l’a permis.
La troisième et dernière partie du livre vise à montrer toutes les conséquences des « lignes de force » et « lois générales » des sociétés humaines décrites dans la deuxième partie. Il est hors de question de passer en revue chacun des douze chapitres qui la composent : il faut les lire. Les raisonnements tenus, faisant la part belle aux contraintes liées à la biologie humaine, permettent à l’auteur de passer en revue l’ensemble des sociétés humaines afin d’expliquer pourquoi elles sont ainsi et pas autrement. Je ne m’attacherai ici qu’à des passages qui méritent discussion ou posent problème.
Bernard Lahire, bien qu’il prenne en compte la biologie évolutive a un problème avec la longévité, parce qu’il semble considérer que la longévité dans une espèce donnée — et en particulier la nôtre — peut varier indépendamment des autres caractères. Ainsi, page 534 (voir aussi pages 340 et 501), il écrit que « si nous n’avions que quelques semaines ou quelques mois devant nous, comme des abeilles, une accumulation culturelle n’aurait jamais pu s’enclencher ». Cette hypothèse n’a pas de fondement, simplement parce que la longévité est liée à tout un tas d’autres caractères de la vie reproductive, comme la durée de la gestation, le poids à la naissance, la taille des portées, la dépendance plus ou moins longue des petits, etc. Les humains doivent vivre longtemps parce que leur gestation est longue, qu’ils ont rarement des jumeaux, qu’ils ont des enfants qui ne sont pas autonomes avant 15 ans. Une longévité de « quelques mois » serait simplement incompatible avec le maintien de notre espèce et se demander si alors une accumulation culturelle aurait pu s’enclencher n’a guère de sens, revenant à se demander ce que seraient les automobiles si les roues étaient carrées. À l’inverse, imaginer, comme certains le font, que nous pourrions vivre des centaines d’années est pur fantasme, parce que notre biologie fait que, dans une société avec peu de soins médicaux, mais ni guerre, ni famine, ni épidémies — le Québec au 18ème siècle — les femmes ayant au moins un enfant vivent en moyenne entre 60 et 65 ans, ce qui permet de mener à l’indépendance le dernier enfant né avant la ménopause, et certaines femmes vivent plus de 90 ans. Si les soins médicaux et le progrès social font que l’espérance de vie a beaucoup augmenté, il est illusoire de penser que nous allons dépasser les 122 ans de Jeanne Calment, qui restera une exception avec quelques rares élus. Ensuite, Bernard Lahire écrit page 667 que notre espérance de vie « n’a longtemps pas dépassé la trentaine d’années ». Dans cette page, Bernard Lahire s’intéresse aux contraintes, liées à la présence d’enfants, qui s’imposent aux femmes, en particulier la longue dépendance à l’égard des parents, et en particulier des mères. On parle donc ici de la longévité individuelle nécessaire pour élever les enfants, ce qui n’a rien à voir avec l’espérance de vie : si l’espérance de vie avait été d’une trentaine d’années, avec la même répartition des âges au décès qu’aujourd’hui — la plupart des gens mourant un peu plus tard que l’espérance de vie du moment — l’espèce humaine aurait disparu, parce que les femmes seraient mortes avant de laisser suffisamment d’enfants au monde : à 30 ans, le premier enfant né quand sa mère avait 15 ans est autonome, les suivants non, et ils ont donc toutes les chances de mourir. L’espérance de vie était faible dans les siècles passés d’abord parce que la mortalité infantile était effroyable mais, passé ce cap, les gens pouvaient vivre des décennies, comme au Québec au 18ème siècle.
Bernard Lahire passe en revue les sociétés humaines, des chasseurs-cueilleurs au capitalisme. Toutefois, il semble qu’il y ait trois manques ici. Le premier concerne, à mon avis, une réflexion sur les débuts du capitalisme, en particulier en Grande-Bretagne, quand les dirigeants de l’époque n’hésitaient pas à détruire une partie de leur population pour obtenir le profit maximal le plus rapidement possible. Ce point a pourtant été étudié par Karl Marx et Friedrich Engels que cite largement Bernard Lahire, et on ne comprend pas pourquoi se priver d’un développement montrant qu’aller contre les contraintes de la biologie humaine peut mener à l’extrême à la disparition de la population, un point aussi documenté par Jack London, 50 ans plus tard, dans Le Peuple de l’abîme. Le deuxième manque est une réflexion sur les pays socialistes disparus, en Europe : ces pays ont-ils eu une politique différente des pays capitalistes, en particulier en ce qui concerne la prise en compte des contraintes de la biologie humaine ? Qu’en est-il aussi des pays socialistes qui existent encore ? Le troisième, enfin, est le manque de réflexion sur l’avenir de nos sociétés. On a fortement l’impression que nombre de sociétés capitalistes actuelles ne considèrent plus comme une priorité (comme les Britanniques au 19ème siècle ?) la reproduction de leur population, l’horizon de leurs dirigeants ne dépassant guère quelques années. Pour ne prendre qu’un exemple, la très faible fécondité en Corée du Sud, certainement liée en partie à la compétition sociale, mais aussi à des attitudes rétrogrades, a inspiré à ses dirigeants l’idée d’augmenter la durée du travail jusqu’à 69 heures par semaine afin de compenser le manque de main d’œuvre lié justement à cette faible fécondité. Alors que les salariés travaillent déjà souvent une cinquantaine d’heures, augmenter encore cette durée ne pouvait que faire encore baisser la natalité : n’importe quel imbécile comprend que si les couples n’ont simplement pas le temps de s’occuper de leurs enfants, il y a de forts risques qu’ils n’en aient pas. Comme il n’y a pas d’imbécile dans le gouvernement coréen, on arriva à cette proposition favorisant la rentabilité immédiate aux dépens de la survie à terme du pays : elle fut finalement abandonnée après des protestations massives. La parade possible à la faible natalité serait, peut-être, de revoir toute la politique coréenne, et peut-être les fondements idéologiques profonds de cette société. Le biologiste que je suis reste sidéré devant ce genre de situation suicidaire, ignorant totalement la biologie humaine, et on aimerait l’avis du sociologue Bernard Lahire : comment des dirigeants peuvent-ils négliger à ce point les données de base de toute société humaine ?
Dans sa conclusion générale, Bernard Lahire règle quelques comptes, espérant que les réactions à son livre « ne se réduiront pas aux classiques ricanements contre ce que d’aucuns s’obstinent à percevoir comme un naturalisme naïf, un positivisme d’une autre âge, ou, pire un ‘simple’ travail de bureau, théorique ou livresque, façons radicales de disqualifier tout travail scientifique ». Ce n’est pas mon cas. Ce livre est important et sa tentative de faire la liaison entre la biologie et les sciences sociales est bienvenue, en particulier par sa volonté d’asseoir les sciences sociales sur le concret de la vie ordinaire.
À lire.


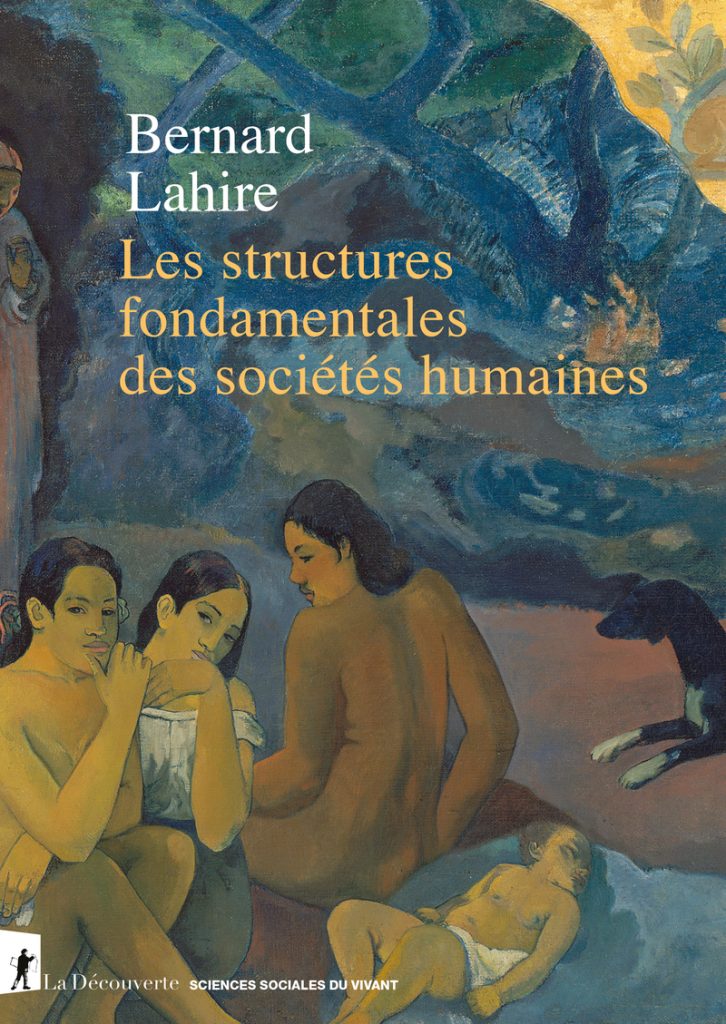




Il me semble que le point le plus faible du livre de B. Lahire est l’explication de la domination masculine : Pour lui, fondée bio socialement sur la dépendance des enfants et sur la domination parentale sur les enfants, l’infantilisation féminine serait la cause de la domination masculine.
Or, on ne voit pas le lien logique entre, d’une part la division sexuée des tâches et des rôles ou la domination maternelle sur les enfants, et d’autre part la domination masculine sur les femmes infantilisées. De plus, l’explication de Lahire ressemble à une tautologie : Comme « infantilisation féminine » est une paraphrase de « domination masculine », cela revient à dire que la domination masculine est à elle-même sa propre cause.
Pour sortir de cette impasse circulaire, on peut suggérer une autre explication bio sociale, fondée sur le fait biologique primordial de la gestation féminine, qui entraîne une dissymétrie au niveau de la transmission des gènes et de la filiation : La mère en a l’absolue certitude, le père jamais totalement. Or, la pleine conscience, féminine et masculine, de cette paternité incertaine, déjà présente chez les mammifères et en particulier chez les primates non humains, est intense chez les humains, et a donné lieu à un accord gagnant-gagnant entre hommes et femmes : Les femmes-mères soumises et cantonnées à la vie domestique se sont ainsi assurées des ressources protectrices des hommes-pères dominants et se réservant la vie publique, ainsi rendus moins incertains de leur paternité. Cette solution imparfaite, renforcée par la monogamie, a favorisé la paix durable et prospère des couples.
Alors, dans nos Sociétés modernes, tout ce qui peut contribuer à diminuer l’importance de l’incertitude de paternité, comme le couple amoureux et la fécondité maîtrisée, contribue effectivement à démolir le socle de la domination masculine.
Bonjour,
Je vous trouve assez sévère avec les manques que vous pointez dans ce livre. Lahire cherche à identifier les lois évolutives (biologiques, sociales et culturelles) qui cadrent son évolution. Dit autrement, il recense les invariants que l’on trouve tout au long de l’histoire humaine et, en prime, il s’interrogent sur leurs conséquences. Je ne vois pas en quoi se pencher sur le début du capitalisme, le socialisme façon URSS ou la natalité en Corée du Sud au 21e siècle nous apprend de pertinent ; ce sont des épiphénomènes au regard de la très longue histoire évolutive qui intéresse Lahire dans son projet. Il me semble que vous lui reprochez de ne pas s’intéresser à vos intérêts à vous, mais dans la mesure où ils ne sont pas centraux pour la compréhension de sa tête, je comprends tout à fait qu’il les ait laissé hors champs.