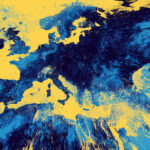Loi sur la fin de vie : laisser à chacun son choix

Alors que le débat parlementaire s’ouvre ce lundi à l’Assemblée, notre chroniqueur Éric Le Bourg, spécialiste en biologie du vieillissement, donne son point de vue.
L’Assemblée nationale examine à partir du 27 mai le projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. C’est une loi délicate et douloureuse en ce sens qu’on ne peut en aucun cas se féliciter de son adoption, puisqu’elle ne fait que nous dire que notre vie et celles de nos proches peuvent s’achever dans la maladie et la souffrance. Cette loi complète la loi Léonetti de 2005 permettant d’administrer « un traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger sa vie ».
Le député communiste André Chassaigne s’est ému du risque que certaines personnes décident de recourir au suicide assisté pour épargner aux proches des dépenses perçues comme inutiles. Cette impression est probablement liée au fait que le reste à charge des frais médicaux augmente avec l’âge, ou que les EHPAD coûtent une fortune. Toutefois, en ce qui concerne les frais médicaux, les soins de la dernière année de vie ne coûtent pas 50% des dépenses de santé de la vie entière, comme le pensait le député, mais plutôt environ 12 années de soins.
L’article de CheckNews de Libération, comparant le coût de la santé à 85 ans par rapport aux âges de 6-10 ans ne répond donc pas à la question posée par André Chassaigne qui est celle du coût de la dernière année de vie. De plus, contrairement à ce que beaucoup pensent, le coût des soins médicaux de la dernière année de vie diminue fortement avec l’âge, à partir de 60 ans (deux fois plus faible à 90 ans qu’à 60), et l’effet est encore plus net chez les centenaires dont le coût de la dernière année de vie est aussi la moitié de celui à 90 ans, un phénomène similaire étant observé au Japon. Les craintes d’André Chassaigne semblent donc pouvoir être apaisées.
Pour sa part, Pierre Dharréville, autre député communiste, s’est ému que cette loi ne risque de masquer l’insuffisance des soins palliatifs en France. D’autres députés, de droite ou de gauche, s’inquiètent d’un basculement éthique, comme la presse le rapporte.
Toutes ces positions sont respectables et traduisent le malaise de chacun devant la perspective de sa fin et de celle de ses proches. On ne peut donc en aucun cas les condamner comme on condamne les politiciens et militants anti-IVG qui s’opposent, aux États-Unis par exemple, par la loi et parfois la violence aux droits des femmes en décidant ce qui est « bon » pour elles, même au prix de leur mort – comme c’est arrivé en Pologne.
Toutefois, et c’est une position personnelle liée à la même histoire douloureuse que dans toutes les familles, on ne peut simplement pas interdire à un individu de décider de la fin de sa propre vie : s’il ne peut mourir dans des conditions supportables, grâce à cette loi, il le fera peut-être dans des conditions sûrement plus atroces s’il en a la force. On ne peut non plus imposer à quiconque de continuer à vivre si la seule perspective n’est que la dégradation continue et la souffrance physique et morale qui l’accompagne. Certains veulent continuer à vivre dans ces conditions et tout doit être fait pour les aider grâce aux soins palliatifs, comme le dit Pierre Dharréville.
D’autres veulent pouvoir bénéficier d’un autre chemin et de quel droit les en empêcher ? Dans les deux cas, c’est une décision strictement personnelle que l’on doit respecter : que la société fasse tout pour assurer un vieillissement en bonne santé le plus longtemps possible n’est pas contradictoire avec le fait de permettre la fin de vie quand cela n’est plus possible.
Certains députés s’inquiètent des dérives possibles à l’avenir si cette loi était votée. Pour l’instant, ces dérives à la « Soleil vert » ne sont qu’hypothétiques, et on ne saurait interdire à chacun de pouvoir prendre ses décisions sur cette base. Qui plus est, n’oublions pas qu’en l’absence de loi un malade peut déjà recourir au suicide, mais pas forcément dans la sérénité, entouré des siens. Les députés opposés à cette loi sur la fin de vie devraient en tenir compte et ne pas, par leur vote, s’opposer à ce choix ultime de chacun : leur abstention sur ce projet de loi serait parfaitement compréhensible et honorable.
Si des députés, par contre, votaient cette loi dans l’espoir de diminuer les coûts des retraites ou ceux de la santé, ce qui semble vain dans ce dernier cas vu la baisse notable des coûts de la dernière année de vie quand l’âge augmente, leur position serait aussi ignoble que celle de ceux qui, en 2020, s’opposaient à l’extension du congé suite à la mort d’un enfant, parce que cela allait pénaliser financièrement les entreprises. Ce projet de loi demande de la hauteur et la question de la fin de vie dépasse de loin les pauvres calculs des économies qu’il pourrait apporter, même si en 2007 Jean-Marie Le Pen osait dire « Je me pose la question de l’euthanasie » à cause « des coûts médicaux vertigineux […] du fait de millions de très grands vieillards ».