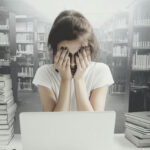Femme de ménage, un métier à l’intersection des discriminations

Indispensables au bon fonctionnement du monde du travail, les femmes de ménages sont pourtant peu considérées. Elles officient dans l’ombre d’un secteur qui concentre les logiques de domination de race, de classe et de genre.
Un immense portrait à l’arrière des bus des grandes métropoles de France. Au-dessus du slogan « je fais briller mon métier », une femme pose fièrement pour le célèbre studio photo Harcourt. Une actrice célèbre et richissime ? Plutôt une femme de ménage payée 12 euros de l’heure, égérie éphémère de la campagne de communication de l’entreprise de nettoyage Shiva. Une opération séduction pour recruter de nouvelles « aides-ménagères » qui contraste avec la réalité des conditions de travail : dans le secteur du nettoyage, les employés sont sous-payés, exposés à des produits toxiques, soumis à des tâches physiques et à des horaires souvent décalés.
Des entreprises comme celles-ci, il en existe des dizaines en France. Certaines demandent à leurs femmes de ménage de créer un statut d’auto-entrepreneur. D’autres sont seulement « mandataires » des contrats : des intermédiaires qui touchent des commissions pour la mise en relation et la gestion administrative. Dans ce cas, c’est le particulier qui demande le service qui est l’employeur de la femme de ménage, sans engagement, donc sans garantie de stabilité de l’emploi. Les salaires non plus ne sont pas fixes : plus on se rend disponible, plus on travaille, plus on est payé, et sans garantie minimum de missions par mois. Les femmes de ménage sont évaluées et surveillées au travail à travers divers procédés : pointage, notes et même carnet de liaison entre le particulier et l’entreprise intermédiaire.
Une précarisation encouragée par l’État lui-même à travers de politiques fiscales, comme le service Avance immédiate de crédit d’impôt ou le chèque emploi-service (CESU). Ce secteur entretient donc la précarité alors même qu’il ne tient que grâce à des travailleurs et travailleuses souvent à l’intersections de plusieurs discriminations.
Une révolution féministe en demi-teinte
« Agent d’entretien », « employé de maison », « assistant ménager » : ces termes au masculin neutre ont remplacé celui de « femme de ménage », alors que seuls 20 % des salariés du secteur du nettoyage sont des hommes. Une proportion qui chute même à 2 % en ce qui concerne le ménage à domicile, selon une étude de la Dares parue en 2016, la dernière sur ce sujet.
À partir des années 1960, les femmes entrent massivement sur le marché du travail. On aurait pu penser que la diminution du nombre de « femmes au foyer » permettrait de répartir davantage les tâches domestiques et du care au sein des couples hétérosexuels. Les études sur le sujet montrent que la part prise par les hommes dans l’entretien de la maison n’évolue plus depuis 20 ans. En réalité, soit les femmes effectuent des doubles journées – la journée de travail salariée et la journée de travail domestique -, soit elles ont recours à d’autres femmes pour faire le ménage chez elles.
La politologue Françoise Vergès, autrice d’Un Féminisme décolonial (Éditions La fabrique) et de Making the World Clean (Éditions Planetarities), note que ce phénomène est aussi à l’oeuvre en dehors des foyers : « Sans ménage dans les crèches, les femmes n’auraient pas pu déposer leurs enfants. Sans ménage dans les administrations, les femmes n’auraient pas pu aller travailler. L’émancipation des femmes bourgeoises s’est en partie appuyée sur la domination de femmes plus précaires. » Certains entreprises du secteur du ménage vont d’ailleurs jusqu’à s’approprier des concepts féministes pour les transformant en argument de vente. En 2024, Wecasa a par exemple tapissé les couloirs des métros parisiens de son slogan « le ménage à domicile anti charge mentale ».
Un métier à l’intersection des discriminations
Un pinkwashing qui tend à faire oublier les logiques de domination qui alimentent ce secteur, et qui touchent en premier lieu des femmes racisées. Selon l’étude de la Dares, 20 % des emplois du nettoyage sont occupés par des immigrées : une part deux fois plus élevée que pour l’ensemble des salariés. À cette proportion s’ajoute celle, non mesurée mais indéniablement élevée, de Françaises racisées.
Françoise Vergès retrace l’histoire de ce phénomène : « Très rapidement dans l’histoire coloniale, les Blancs ne peuvent plus être esclavagisés dans les maisons de maîtres, donc le travail de domestique va être assigné aux femmes noires. Dans la colonie post-esclavagiste, ça va être la même chose. Dans les années 1960, de nombreuses femmes des outres-mers vont être amenées en métropole par le Bureau des migrations des départements d’outre-mer pour travailler comme femmes de ménage. C’est l’État qui organise cette racialisation du secteur. » Ce secteur du nettoyage est un rouage indispensable du capitalisme racial, puisque notre économie tient grâce à l’usure des corps racisés.
Indispensables mais invisibles
Comme le sont souvent les populations discriminées, les femmes de ménage sont invisibilisées : elles travaillent lorsque les maisons ou les entreprises sont vides, prennent les transports en commun à l’heure où tout le monde dort, ne sont que très peu représentées dans les médias et les productions culturelles.
Un manque de considération qui contraste avec leur ressenti : 78 % d’entre elles considèrent leur travail utile et éprouvent un sentiment de fierté à bien le faire. Et pour cause : notre société productiviste ne pourrait continuer de fonctionner sans le travail invisible de nettoyage. Il suffit de voir les réactions de panique à chaque grève des éboueurs.
« Les cadres sont toujours en train de nous seriner sur leurs performances, mais ils ne pourraient pas faire la moitié de ce qu’ils font s’il n’y avait pas des milliers de corps racisés qui rendent ça possible. Pour un corps blanc de cadre dynamique, il y a une dizaine de corps racisés qui entretiennent la possibilité d’être performant. », s’insurge Françoise Vergès. « Un jour il faudra inventer d’autres manières de nettoyer, mais en attendant il faut se battre pour qu’il y ait des bonnes conditions de travail et que ce secteur soit payé à la hauteur de son importance sociale. » Pour elle, c’est certain : le secteur du nettoyage est un terrain de lutte féministe et antiraciste par excellence.