De la « créolisation » et de la « nouvelle France »

Jean-Luc Mélenchon a un grand mérite : il raccorde ses objectifs stratégiques à de larges visions du monde. Depuis quelque temps, il articule deux notions : la « créolisation » et la « nouvelle France » et en fait un fondement d’une stratégie politique.
De la créolisation
« Notre France, c’est une France créolisée, mélangée. Une nouvelle France constituée de tous ceux qui veulent vivre ensemble. » Le leader des Insoumis utilise ces mots, le 9 juin 2024, au soir du premier tour des élections législatives anticipées. Il emprunte la notion de créolisation à Édouard Glissant.
Chez l’écrivain martiniquais, la créolisation est inséparable d’une autre notion, celle de « Tout-Monde » ou de « mondialité »1. Qu’est-ce que la mondialité ? La communauté de destin qui relie l’ensemble des êtres humains. Antithèse d’une mondialisation capitaliste qui n’en est que le dévoiement, elle écarte ce qui contrarie le commun, aussi bien la concurrence universelle du marché que l’obsession de la puissance et le heurt des égoïsmes nationaux. Elle conduit ainsi à se défier d’un universalisme édicté par les dominants comme à refuser la juxtaposition des cultures particulières et des « communautés » censées les défendre.
Ni l’universalisme conquérant des dominants ni le repli communautariste des dominés… Pour l’écrivain, la seule alternative se trouve dans la créolisation, c’est-à-dire « la mise en contact de plusieurs cultures ou au moins de plusieurs éléments de cultures distinctes, dans un endroit du monde, avec pour résultante une donnée nouvelle, totalement imprévisible par rapport à la somme ou à la simple synthèse de ces éléments ».
Les nouvelles générations vivent d’autant plus mal les discriminations qui les affectent que leur condition s’est rapprochée objectivement de celle des Français prétendument « de souche ».
Apparue dans les années 1970, la métaphore de la « créolisation » s’est élargie à de nombreux domaines. En avril 2018, la juriste Mireille Delmas-Marty défendait ainsi devant l’Unesco la « créolisation par transformation réciproque », qui était pour elle une manière de concilier le pluralisme et l’universalisme. Pour parvenir au nécessaire « langage commun de l’humanité », elle proposait de combiner trois pistes, d’intensité et de complexité variables : le dialogue (l’échange des pensées), la traduction (la compréhension de l’autre) et la créolisation, cette dernière étant ce qui « permet d’unifier les différences en les intégrant dans une définition commune »2.
La notion de créolisation ne fait pas l’unanimité et n’est pas acceptée partout sans nuance. Déployée avant tout dans un contexte caribéen marqué par l’insularité, la colonisation et l’esclavage, elle a été soumise à des interrogations sur ses contours concrets et sur la validité de son universalisation. Certains ont suggéré le recours à des termes plus neutres, moins géographiquement déterminés, comme celui « d’hybridation culturelle ».
Le débat des termes est ici secondaire et nous verrons plus loin que, de toute façon, l’usage de chaque mot exige beaucoup de prudence, si l’on veut qu’il s’installe utilement dans l’univers de la politique. Mais les préoccupations qui ont conduit le fondateur insoumis à prôner la créolisation émergent au moment où l’extrême-droite impose le grand remplacement des valeurs. Comme pour la « nouvelle France », il reste à savoir jusqu’à quel point le terme est pertinent pour les confrontations contemporaines.
Une « nouvelle France » ?
Face aux discours poussiéreux de la France éternelle et de l’identité française toujours menacée, la France insoumise a choisi de promouvoir la notion de « nouvelle France ».
« Sur trois générations, un peuple nouveau s’est constitué en France. Il y a trois générations, la majorité du peuple français ne vivait pas en ville. Aujourd’hui, de quoi sont peuplées les villes ? D’immigrés. Corses, girondins, maghrébins, maliens, savoyards, bretons. Ce qu’ils font ensemble ? Ils vivent. Ils se créolisent. Cette France, c’est une nouvelle France constituée de tous ceux qui veulent vivre ensemble. »
Jean-Luc Mélenchon, L’Insoumission, 18 juin 2024
Mélenchon a repris depuis, sous une autre forme, ses propos antérieurs. « Dans notre pays, une personne sur quatre a un grand-parent étranger. 40% de la population parle au moins deux langues. Nous sommes voués à être une nation créole et tant mieux ! Que la jeune génération fasse le grand remplacement de l’ancienne génération. » Un peu plus loin, il n’hésite pas à enfoncer le clou : le mérite et la mission de ces nouvelles générations « créolisées » sont ainsi « de guérir la France des plaies du racisme ». Récusant l’image d’une ruralité vouée aux « Français de souche », Mélenchon affirme que d’ores et déjà « la ruralité est brassée » et que la population qui se dirige vers elle est « celle qui arrive des quartiers populaires en ce moment ». Sur plusieurs points, il va trop vite en besogne.
Mélenchon a raison de partir des effets de masse des mouvements migratoires : les immigrés constituent 10,3% de la population résidente, la deuxième génération (un parent immigré au moins) compte pour 11,2% et 10% des moins de 60 ans appartiennent à la troisième génération (au moins un grand-parent immigré). Trois résidents sur 10 ont un rapport sensible à l’immigration… Au fil des années, elle a profondément modifié le paysage humain du territoire français, en l’ouvrant à des populations venant de tous les continents. Mais l’univers des immigrés et descendants d’immigrés varie toutefois selon les générations, les lieux et cultures d’origine et les caractéristiques des territoires d’accueil.
Les immigrés eux-mêmes, surtout s’ils sont d’origine extra-européenne, sont dans une situation plus défavorable que les autres sur le marché du travail, disposent de revenus plus faibles et d’emplois moins qualifiés. Ce n’est plus le cas dès la deuxième génération, dont la situation est tout compte fait plus proche de celle des non-immigrés que de celle des immigrés eux-mêmes. Or des facilités moindres d’accès à l’emploi et au logement décent et, plus encore, les discriminations vécues nourrissent le sentiment de l’inégalité structurelle persistante. Les nouvelles générations vivent d’autant plus mal les discriminations qui les affectent, que leur condition s’est rapprochée objectivement de celle des Français prétendument « de souche ».
L’utopie nécessaire et le réel contraignant
Peut-on parler de créolisation ? Si l’on prend l’indicateur des langues pratiquées, ce n’est pas si sûr. À la fin du XXème siècle, on estimait à 20% la part de la population qui connaissait le français et une des 400 langues parlées en France, étrangères ou régionales. En 2023, les travaux de l’Ined et de l’Insee3 suggèrent certes que la moitié de la deuxième génération avait entendu dans sa famille parler le français et une autre langue. Mais à peine un peu plus du tiers peut parler, comprendre et – en très petit nombre – écrire la langue parentale.
La connaissance d’au moins deux langues offre une possibilité d’ouverture culturelle et affective qui n’existait pas dans le passé. Mais, même chez les descendants d’immigrés, le bilinguisme reste limité et, en tout état de cause, ce bilinguisme n’est pas la créolisation, qui suppose la constitution d’une langue nouvelle et partagée. Exaltant à juste titre les bienfaits du métissage et de la mixité et voulant repousser l’image d’une France périphérique uniformément rétrograde et vieillie, Mélenchon suggère que cette France est en train d’aller vers une plus grande mixité et de se rapprocher ainsi, partout, par l’apport direct de la diversité propre aux couronnes périurbaines. Or, la réalité est bien plus complexe.
Toute exaltation d’un segment des catégories populaires qui serait censé incarner la modernité, au détriment d’un autre persuadé d’avoir perdu un monde qui n’est plus le sien, produit la division d’un univers populaire dont le point commun évident est pourtant d’appartenir à la cohorte des dominés.
D’une part, l’intensité de la croissance démographique reste proportionnelle à la taille des aires d’attraction urbaine et aux possibilités d’accès aux centres. Il n’y a donc pas de déplacement massif et de « remplacement », partout, d’une population par une autre. D’autre part, si le pourcentage des immigrés augmente rapidement dans des territoires jusqu’alors peu touchés, notamment le Grand-Ouest, la surreprésentation des immigrés se consolide dans les régions concernées de longue date (Île-de-France, PACA, Grand Est). Enfin, à l’intérieur des grandes aires urbaines de province, s’il est vrai que la part des ouvriers et des employés a diminué dans les villes-centres et augmenté en couronne, ce n’est globalement pas le cas des catégories populaires immigrées. En effet, leur part relative s’accroît au contraire dans les pôles (communes-centres et banlieues) et diminue dans les communes de périphérie4.
La réalité telle qu’elle est
Les flux migratoires augmentent et augmenteront à l’échelle mondiale. L’extension des contacts qui en résulte est une donnée de fait et c’est une chance, dès lors qu’on en maîtrise les effets sur le territoire d’accueil. Mais pour l’instant, la dynamique de peuplement se présente sous un double visage : elle élargit les potentialités liées à la densité des échanges (notamment dans les aires métropolitaines), mais elle accentue les inégalités et les discriminations dans la distribution sociale et ethnico-raciale des populations. En même temps qu’elle rapproche, la dynamique actuelle provoque de la ségrégation.
On peut dès lors penser que la créolisation, le métissage ou l’hybridation sont des processus possibles et désirables, des utopies utiles qui contribuent à la visée d’un développement sobre et égalitaire des capacités humaines de chaque individu. Mais, dans nos sociétés européennes, ces processus sont au mieux des amorces, dont on peut d’autant moins proclamer l’achèvement qu’une « créolisation » ne se décrète pas. Comme le souligne Glissant lui-même, elle relève de l’impromptu et non de la fatalité et de la prédiction. Nul ne peut donc affirmer qu’une société est « créolisée », surtout si tout ne va pas dans le même sens. À la rigueur, on peut dire qu’il y a des éléments de créolisation (la musique, la mode…) ; à l’extrême limite, que la société est « en voie de créolisation ».
Ajoutons que, dans le modèle antillais de la créolisation, un moteur décisif du processus s’est trouvé dans le désir de reconnaissance, pour des individus que leur statut d’esclaves renvoyait au registre de l’infrahumain. Ce désir a nourri l’effort fourni par les opprimés pour bricoler le langage qui leur permettrait de fusionner leurs racines anciennes et leur enracinement nouveau. Par la suite, cette langue neuve a été appropriée par la population « blanche » locale, pour se différencier des « blancs » de métropole.
On pourrait certes se dire que la non-reconnaissance des immigrés et descendants d’immigrés peut stimuler chez eux le désir ambitieux de forger une nouvelle créolité, qui pourrait alors diffuser en direction d’autres milieux. Le problème est que, dans la société française telle qu’elle est, la crise profonde des identifications de tous types crée de l’incertitude et de la souffrance, plus sans doute qu’elle ne nourrit le désir du partage et de la mise en commun. Ainsi, le risque est immense de voir s’opposer deux souffrances, celle de l’ex-colonisé soumis au déni de reconnaissance et à la discrimination, et celle du dominé non immigré sur qui pèsent à la fois le poids de la relégation et l’angoisse du déclassement. Loin du modèle vertueux de la créolité, deux angoisses peuvent s’affronter, comme deux blocs irréductibles : celle d’une minorité qui craint de le rester et celle d’une majorité qui redoute de ne plus l’être…
Il n’y a pas plus de France « nouvelle » qu’il n’y a de France « ancienne ». Il y a un territoire chargé d’histoire, qui peine aujourd’hui à trouver confiance dans son avenir et qui ne sait plus très bien où sont les ressources qui lui permettent de vivre ensemble.
Toute exaltation d’un segment des catégories populaires qui serait censé incarner la modernité, au détriment d’un autre persuadé d’avoir perdu un monde qui n’est plus le sien, produit la division d’un univers populaire dont le point commun évident est pourtant d’appartenir à la cohorte des dominés. Or, divisés, ceux-là sont confrontés à deux impasses qui se nourrissent l’une et l’autre : soit la démission, le repli sur soi, le désengagement civique ou, souvent, le choix d’une droite d’exclusion ; soit la rage, la radicalité de la forme et la défaite politique à l’arrivée.
Il n’y a donc d’issue, surtout si l’objectif est le mixage, qu’en cherchant à rassembler les segments du peuple disloqué, non dans le ressentiment, mais dans l’espérance de ce qui contredit la régression sociale et la relégation populaire. Le remède aux grandes fractures de notre temps n’est ni dans la foi ardente des avant-gardes missionnaires que l’on mobilise pour promouvoir le nouveau monde, ni dans les grands déplacements de populations qui recouvrent l’ancien. Il suppose plutôt que l’on rompe collectivement avec le cloisonnement de fait de tous les espaces de vie et donc avec l’ensemble des logiques, matérielles comme symboliques, qui produisent aujourd’hui de l’inégalité et de la discrimination, dans tous les territoires sans exception.
Rassembler ce qui est divisé
Les déchirements des espaces économiques, les déplacements contraints, les spéculations foncières, la concurrence entre les territoires, les inégalités d’accès aux services publics sont les substrats matériels des évolutions qui séparent les individus au lieu de les rapprocher. De même que l’inquiétude devant un monde dangereux stimule le désir de protection et légitime le fantasme de la frontière nationale, de même la peur du déclassement nourrit l’idée que les frontières internes, voire les murs, sont les seules solutions pour protéger celles et ceux qui n’ont pas les ressources de la fortune ou du pouvoir à faire valoir dans la jungle irrémédiable de la concurrence. Dans ce contexte potentiellement explosif, évoquer un grand remplacement contre un autre, même métaphoriquement, ne peut que nourrir la rage et préparer le désastre.
De ce point de vue, un problème apparaît dans le choix du terme de « nouvelle France ». Il a l’avantage de l’optimisme, de l’invocation de la nouveauté, de la désignation d’une modernité qui ne serait pas celle de la technocratie, de l’appât du gain et du bling-bling. Mais il a l’inconvénient de laisser entendre qu’il y d’ores et déjà, en France, des territoires qui incarnent plus que d’autres cette nouvelle modernité.
Or, à bien des égards, il n’y a pas plus de France « nouvelle » qu’il n’y a de France « ancienne ». Il y a un territoire chargé d’histoire, qui peine aujourd’hui à trouver confiance dans son avenir et qui ne sait plus très bien où sont les ressources qui lui permettent de vivre ensemble. Un territoire qui doute massivement des vertus de sa démocratie, qui est tenté par le repli, trop souvent ouvert aux tentations de l’autorité. Un territoire qui reste attaché à des valeurs égalitaires, mais qui ne sait plus comment les faire vivre, qui souhaite que ses ressortissants soient plus souvent consultés, mais qui préfère l’efficacité à la démocratie5.
Face à cette France qui doute et s’inquiète, il est dangereux de se réclamer d’une France contre une autre, que cette France soit celle de l’ancien ou du nouveau, du mouvement ou de l’immobilité, des « métropoles » ou des « périphéries ». La France est depuis longtemps un grand État. Elle est devenue une nation quand, à partir de 1789, elle s’est rassemblée autour de l’idée que la liberté, l’égalité et la fraternité étaient des ferments d’unification plus puissants que la ferveur belliqueuse ou la soumission à l’autorité.
Si l’on veut rassembler aujourd’hui, ce ne devrait être ni dans l’invocation de la nouveauté absolue ni dans l’obsession du grand remplacement. Il y a un avenir pour ce qui s’appelle la France, mais le profil qui sera le sien est balisé par des choix. La France telle qu’elle est, avec tous les individus qui y résident et tous ceux qui y résideront, saura-t-elle écarter ce qui limite son déploiement, les habitudes rentières, l’argent facile, l’étatisme sans limites, l’arrogance cocardière, le refus de l’autre, la tentation de l’autorité ? Saura-t-elle prolonger ce qui est propulsif, les valeurs fondatrices de 1789-1793, le respect de la dignité, la recherche de la mise en commun ? Saura-t-elle enfin renouveler ce qui peut l’être, le sens du public, la démocratie d’implication, l’équilibre des souverainetés à tous les niveaux ? Écarter, prolonger, renouveler…
En bref, parviendrons-nous à refaçonner ensemble une France à la fois continuée et renouvelée, dans une Europe des peuples assumée et dans un monde dont la communauté de destin ne sera bridée ni par la dictature des marchés ni par l’équilibre dangereux des puissances ?
Jean-Luc Mélenchon a eu la bonne idée de proposer un cadre de réflexion prospective. Il suggère des mots pour identifier ce cadre : « créolisation » et « France nouvelle ». Il faut accepter d’en discuter la pertinence, l’extension et, éventuellement, le mode d’emploi. En débattre : pas en y voyant un nouvel Évangile ou au contraire une œuvre satanique a priori. L’esprit public a besoin aujourd’hui de ces débats de fond, pas des jeux de posture et des disputes de chiffonniers.
- Des extraits utiles des propositions d’Édouard Glissant : http://www.edouardglissant.fr/creolisation.html ↩︎
- Mireille Delmas-Marty, « Créoliser la notion d’humanité », 2 octobre 2015 ↩︎
- Les données disponibles sont rassemblées par l’Insee dans une synthèse de 2023 : Immigrés et descendants d’immigrés en France, Insee Références, édition 2023 ↩︎
- https://www.strategie.gouv.fr/publications/centre-banlieue-peripherie-repartition-populations ↩︎
- Sondage Opinionway-Cevipof de février 2025 ↩︎




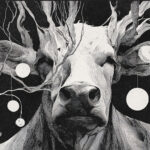

Bonjour Monsieur Martelli, je suis entièrement d’accord avec votre article et tout les faits que vous énoncez sur la créolisation, le principe de Nouvelle France, etc …
Par contre, juste une seule phrase qui pourrait porter à confusion :
« Jean-Luc Mélenchon a un grand mérite : il raccorde ses objectifs stratégiques à de larges visions du monde »
Oui mais non, par pour sa vision du monde car c’est un pro Russe et pro Chinois.
Son antiaméricanisme ne date pas de Trump et Je vous invite à lire son super article concernant sa vision du monde sur son site:
https://melenchon.fr/2025/02/18/parle-a-ton-trump-ta-tete-est-malade/
Voilà, des litanies (Justifiées) sur les USA et une extrême indulgence sur la Russie, je vais vous citer juste deux passages de son article:
« Bien-sûr, le suivisme pro-OTAN restera sans doute la vieille marotte des poussiéreux européens bloqués dans le vingtième siècle. Mais la question clef est la production d’une pensée et d’une action efficace avec le « Sud global », notamment francophone pour une France réellement indépendante, non alignée et souveraine. Et bien sûr avec la Chine. Elle est d’ores et déjà première puissance mondiale. Elle doit être considérée comme telle, sans infantilisme. Et sans s’inclure dans le jeu dangereux des USA à propos de Taïwan, leur prétexte d’agitation irresponsable favori. »
Voilà, la chine, un allié de Poutine. Donc une France non aligné, mais quand même avec la chine, et donc la Russie.
Et un autre passage sur sa vision du monde
« Pour l’instant, entre la Russie et l’Europe sur le plan économique, c’est l’Europe la seule victime du conflit. Les USA en sortent renforcés contre la puissance économique du vieux continent qu’ils ont réussi à rabaisser. Sur le plan militaire, passons…
»
Voilà. D ‘après lui avec les sanctions économiques contre la Russie, ce serions nous les plus punis économiquement. Et les USA, les seuls grands méchants. Bon, les Ukrainiens, la dictature Poutine, il en parle pas …
Donc les valeurs de Gauche étant quand même l’humanisme de tout les Humains,, Melenchon ne correspond absolument pas aux valeurs de la Gauche.
C ‘est sa vision du monde et de l’international qui font qu’il ne pourra jamais passer au pouvoir.
Donc faisons attention a ne pas confondre la justesse de ses propos sur la Creolisation, avec sa vision du monde plus douteuse.
Cordialement 🙂
Anti-americaniste primaire ? on comprend des lors mal son soutien et son enthousiasme pour Bernie Sanders… américain lui même et qui « aurait changé le monde » s’il avait pu être élu selon Mélenchon. J’imagine qu’il s’agit là de la marque de sympathie d’un pro-russe et pro-chinois à un autre pro-russe et pro-chinois…
Que le discernement manque en ce bas monde!
Bonjour Carlos Je n’ai pas écrit antiaméricanismme « primaire ». Mais antiaméricanisme sur sa vision du monde. La preuve en est que Sophia Shikirou a fait partie du staff pour Bernie Sanders, de Miami à Philadelphie.En formation pour sa campagne. La créolisation des méthodes électorales s’est faite.
Et que notre ami Jean Luc écrit régulièrement sur Facebook, ou Twitter qui appartiens à Elon Munsk.
Bon déjà avant de prétendre sortir d’une France soi disant alignée sur les USA, et de se rapprocher de la Chine, pourquoi ne pas commencer soi même en correspondant sur TIK TOK ou sur un forum PHPBB Francais ?
Effectivement, je suis d’accord avec vous que ca manque de discernement 😉
Bien… admettons donc que cet antiamericanisme n’ait rien de « primaire » et soit donc fondée sur des éléments factuels et donc autre chose que de l’irrationnel… alors pourquoi trouvez vous normal ce soutien à Bernie Sanders en même temps que cette posture qualifiée par vos soins de pro-russe et de pro-chinoise???
Ne devez vous pas commencer à vous interroger sur l’utilisation du mot « anti-americanisme »?
Si l’on y regarde de plus près on comprend que ce qui pose problème, c’est la stratégie agressive impérialiste délétère américaine qui l’a conduit a en faire le gendarme du monde, remise en cause pas Bernie Sanders lui-même… Peut être que ce que vous prenez pour une posture pro-russe ou pro-chinoise n’est que l’expression de la volonté de contester l’ordre mondial inique imposé par les Etats-Unis… expliquant de fait la revendication d’une France Non-alignée… plutôt que vassalisée à l’un ou a l’autre… Ça ne vous a pas effleuré l’esprit? Je redis que le discernement manque en ce bas monde. Certains ont toujours tendance à désigner du doigt, les gentils d’un côté et de l’autre les méchants. Trump va leur rappeler que ce n’est pas si simple…
Dites REGARDS, va peut-être falloir vous calmer avec vos images IA de plus en plus fréquentes. Celle « illustrant » cet article est particulièrement banale et inintéressante (je pourrais ajouter hideuse – admettons que c’est subjectif), mais plus largement vous ne vous posez aucune question par rapport à ça ? Je sais bien, c’est pratique et pas cher… mais entre l’impact écologique, la propagation d’esthétiques stéréotypées, l’herbe coupée sous le pied des photographes et illustrateurs-trices, et plus largement face à la promotion folle de l’IA qu’on nous survend partout au mépris de ses manquements et dangers, il y a une dimension politique à son usage – même juste pour faire des visuels – qui semble étrangement vous échapper.
Merci.
C’est de la position géographique du territoire de la France métropolitaine actuelle que résulte la créolité des populations qui y résident, et cela, depuis toujours : située à l’extrémité occidentale de l’Eurasie elle est le point d’aboutissement commun de toutes les populations migrant d’Est en Ouest et d’où qu’elles viennent, jusqu’à ce que finissent terres, à la pointe du Raz. Méditerranéenne, atlantique, nordique par les mers où elle baigne, sillonnée de grands fleuves en partie navigables, elle est depuis des millénaires un lieu de convergences et d’appropriations réciproques entre populations venues de tous les horizons, l’archéologie en témoigne abondamment. Ce n’est pas L’Italien Bardella ou la Bretonne Le Pen qui justifieront du contraire même s’ils se fantasment en « Français de souche » (personnellement, je pense que le terme de « souchiens » inventé par les Indigènes de la République serait plus pertinent pour rendre compte du délire raciste qui caractérise le concept).
Quant à « l’ancienne France », elle existe bel et bien : aujourd’hui encore dominée les héritiers – au sens patrimonial du termes – de ceux qu’Albert Soboul appelait les « coqs de village » dans son ouvrage sur les « problèmes paysans de la révolution », elle vient de se manifester sans aucune ambiguïté, du RN aux macronistes, par l’adoption de la « Loi d’orientation agricole » qui consacre la fuite en avant de l’agriculture capitaliste dans la réhabilitation de tout ce qui rend notre monde invivable, les zones de grandes monocultures offrant des paysages proprement « lunaires ». Parler de « la France telle qu’elle est, avec tous les individus qui y résident » en faisant abstraction de la réalité complexe des rapports de domination croisés qui s’y nouent n’a aucun sens.
La réflexion martellienne n’aurait rien à perdre à se créoliser d’un peu de wokisme.
et au moment où on voudrait à nouveau nous vendre une définition archaïque de notre identité nationale, le rappel de celle donnée en d’autres temps par Fernand Braudel : » .. le fruit d’une tension créatrice, d’un dialogue entre la diversité de nos racines et l’unité de la Nation … » Tout est dit et bien dit !
Monsieur Martelli a quand même raison sur sa phrase:
« Jean-Luc Mélenchon a un grand mérite : il raccorde ses objectifs stratégiques à de larges visions du monde »
Mais en plus il a aussi une large vision de l’histoire du monde. Toujours anti USA et légèrement pro Russe. Il nous raconte dans sa dernière note de Blog comment Hitler est arrivé au pouvoir . A lire et à faire partager !!!!
https://melenchon.fr/2025/02/23/devons-nous-etre-vitrifies-pour-berlin/
« Il a vaincu par hasard, entouré du soutien actif des milliardaires américains, avec des soldats drogués, des pays dirigés par des traîtres et des imbéciles. Ceux-là semblent avoir retrouvé le chemin des congrès nazis que fréquentait Henry Ford, comme l’a fait Vance après Musk, insultant sans vergogne les gouvernants et les démocrates allemands. Le remède fut administré autrefois : l’invincible résistance acharnée des Anglais, d’abord totalement seuls, qui sauvèrent notre civilisation. Puis l’Armée rouge du peuple russe qui a écrabouillé l’armée nazie. De nos jours, à notre échelle, un devoir antifasciste est tout tracé. »
Voilà d’après les évangiles selon Jean Luc ,les américains sont donc de grands méchants collabos des nazis. Puis ce sont les anglais et les Russes qui ont écrabouillé les Nazis.
Moi bizarrement je pensais, ayant été à l’école et petit fils de résistant, je pensais que c ‘était d’abord les anglais et la résistance des autre pays qui s’étaient réfugiés en Angleterre pour continuer à combattre les nazis. Et que les Russes s’étaient alliés avec les nazis pour se partager l’Europe. Pacte Germano Soviétique. Puis que c ‘étaient les américains qui étaient venus nous libérer.
Heureusement, avec la large vision du monde et de son histoire selon Jean Luc , je remets mon cerveau en ordre !!!!
Je n’en reviens pas. Roger Martelli parle d’une proposition de Mélenchon sans la disqualifier de prime abord.