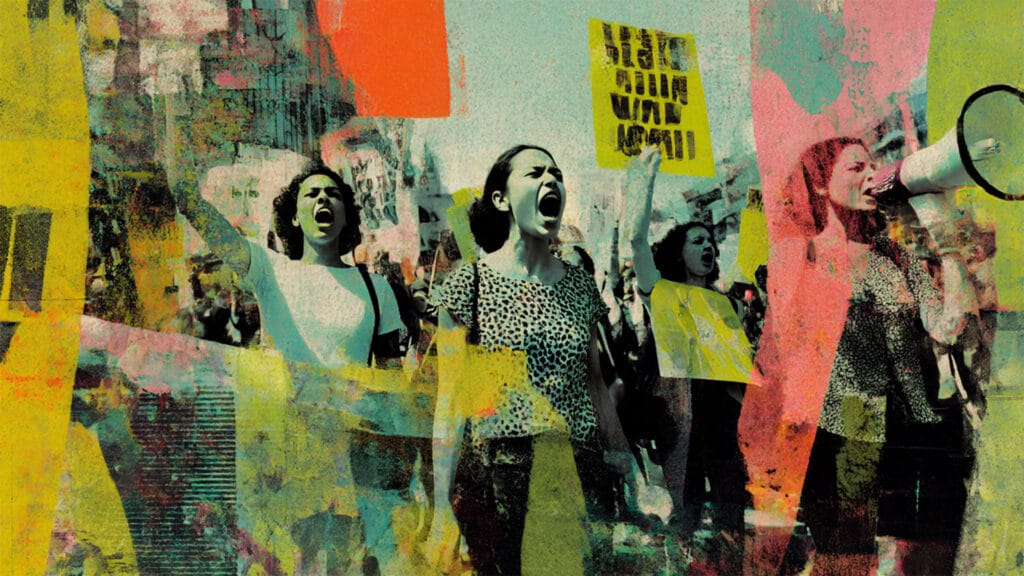
Aux origines des violences dans la culture, il y a l’artiste.
La maille de l’histoire est étroitement tissée : on est encore sonné par le documentaire Netflix sur l’emprise exercée par Bertrand Cantat qui a conduit au meurtre de Marie Trintignant et au suicide de Kristina Rady. Ce mercredi sort un rapport de l’Assemblée nationale sur la violence des mondes de la culture. Fruit d’une commission d’enquête présidée par la députée écologiste Sandrine Rousseau, il recense des dizaines d’auditions et dresse un constat accablant : les espaces de création artistique semblent structurés autour de la prédation des corps.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
On pourrait se dire que les milieux du cinéma et du théâtre n’échappent pas à la violence sexiste issue de la domination patriarcale qui s’exerce dans l’ensemble de la société parce que « la grande famille de la culture » dont on fait parfois mention n’existe pas. Ou plutôt, comme s’est rappelé dans le rapport, parce que précisément, c’est à l’intérieur des familles qu’il y a le plus de violences. Sauf que l’on ne peut s’en contenter : les violences y ont l’air plus virulentes et prégnantes que dans le reste de la société. La modernité a promu un artiste qui fonde sa singularité dans la licence et le débordement… et qui assoit sa recherche autour de l’exploration du désir. Le résultat, c’est donc un monde culturel fait de prédation sexuelle.
La commission s’attache à vouloir réaffirmer les règles et l’égalité des femmes et des hommes. Elle fait donc 86 recommandations, précises et acérées, pour que l’impunité cesse. C’est d’une nécessité absolue bien sûr. Mais ce n’est pas le cœur du sujet : l’artiste qui croit en son génie (Sandrine Rousseau appelle cela « talent » dans son avant-propos), l’artiste à qui l’on fait croire en son génie, va continuer de s’imaginer tout permis. S’il pense que son désir est un paramètre de son processus créatif, rien, ni les lois ni les recommandations, ne sont susceptibles de l’en arrêter. Certes, cela permet de leur couper des subventions ou de mettre en place des gardes-fous. Cette liberté financière des artistes est cruciale : elle a été pensée dès le 18ème siècle avec les droits d’auteurs et n’a cessé d’être repensée dans le cadre du développement du capitalisme.
C’est une atmosphère générale de sexisme industriel qui règne : tout le monde se sent autorisé à prédater qui bon leur semble. Au nom de l’art comme d’autres le font au nom de Dieu.
Dans le rapport parlementaire, on voit la façon dont toute la structure de la création semble vérolée par la violence prédatrice : celle-ci n’est pas réservée aux artistes qui pourraient imaginer que le statut qu’il pense que la société leur octroie justifie leur comportement, mais elle s’étend à toutes les professions afférentes (techniciens, administratifs, etc.). C’est une atmosphère générale de sexisme industriel qui règne : tout le monde se sent autorisé à prédater qui bon leur semble. Au nom de l’art comme d’autres le font au nom de Dieu.
Il n’est pas étonnant que la révolution #MeToo ait commencé dans le milieu du cinéma. Ce n’était pas uniquement dû à la renommée des acteurs et des actrices qui le composent mais aussi parce que c’est là que les crimes commis sont les plus lâches. La prédation sexuelle est un des sucs de l’art (pas le seul, mais non négligeable) : la preuve, c’est que le désir constitue l’un des cœurs de toutes les œuvres. Les artistes sont considérés comme des démiurges qui ont été placés au sommet de la hiérarchie sociale. La transgression fait souvent partie de leur positionnement par rapport au monde mais on ne peut la laisser être absolue, notamment à l’égard des femmes et des enfants, c’est-à-dire tous ceux que la société désigne comme les plus vulnérables. Il ne s’agit donc pas tant de réassocier l’homme et l’artiste que de se poser la question de la définition de l’art, pour mieux s’attaquer à la violence dans les milieux culturels.





