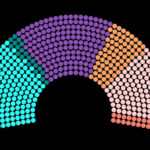Les paris stupides d’Emmanuel Macron

Le président de la République a chargé la Première ministre, Élisabeth Borne, de former un « gouvernement d’action », avec une ligne rouge : la dette, tu n’augmenteras pas.
« Laurent, serrez ma haire avec ma discipline,
Et priez que toujours le ciel vous illumine. »
Molière, Le Tartuffe ou l’Imposteur, III, 2
Durant sa courte escale à Paris entre la réunion du Conseil européen et celle du G7, Emmanuel Macron a confié le 25 juin à l’AFP qu’il confirmait sa confiance à Élisabeth Borne et qu’il la chargeait de réfléchir à un « nouveau gouvernement d’action » pour début juillet. Sa mission : essayer d’obtenir un accord de gouvernement avec les LR et/ou les Verts, le PC, le PS. Le cadre devra être le projet présidentiel qui pourra néanmoins être « amendé ou enrichi ». Mais avec pour ligne rouge de n’augmenter « ni les impôts, ni la dette ».
Le Président trouvera-t-il à nouveau un de Rugy, une Pompili, un Véran ou un Abad, attirés par l’odeur des maroquins ? Peut-être. Mais que cela fasse la rue Michel et qu’il arrive à casser sur de telles bases la NUPES, lui-même ne le croit sans doute pas. Même pas sur un malentendu. Car justement sa feuille de route et sa ligne rouge les ont rendus encore plus difficiles.
La dette, c’est sacré
La mission du gouvernement sera donc de ne pas augmenter la dette.
Comme l’affirmation n’a, une fois encore, attiré l’attention d’aucun décodeur de médias, ni d’aucun « économiste » de plateaux télé, je me suis remis à la tâche.
Que faut-il entendre par « Ne pas augmenter la dette » ?
Ne pas augmenter la dette publique cela veut dire, en principe, supprimer le déficit public. C’est le propre du déficit public que d’être financé par de la dette publique. Ou alors, il faut donner à l’État le pouvoir de battre directement monnaie. Mais cela ne fait pas partie des réformes envisagées par Emmanuel Macron.
Pour savoir à combien se montait le déficit public qu’il faudrait supprimer, je n’ai eu qu’à consulter la projection économique 2022 publiée par la Banque de France, le 21 juin. « En 2022, expliquent les économistes de la Banque de France, le solde public resterait dégradé à − 5,0 % du PIB, après − 6,5 % en 2021 ». Et 5% de PIB, cela fait 135 milliards d’euros.
L’évaluation a été faite en intégrant « les mesures encore massives de lutte contre la crise sanitaire, de soutien au pouvoir d’achat des ménages, et la poursuite du déploiement des mesures de relance ». Du moins les mesures déjà prises, et pas celles dites de défense du « pouvoir d’achat » que le gouvernement Borne devrait faire établir début juillet par le Parlement. Si on les ajoute, le déficit 2022 dépassera donc certainement les 140 milliards.
Ainsi, on ne serait plus sur du 80 milliards de prélèvement sur les dépenses publiques en cinq ans. On serait donc au minimum sur du 140 milliards dès l’année prochaine. Et donc sur le chemin d’une catastrophe sociale, économique et environnementale. Une vraie catastrophe – et pas celle fantasmée contre le programme de la NUPES par un « ancien conseiller de François Mitterrand » dans un think tank de « centre gauche ».
Le banquier amateur
Le Président peut prétendre que sa ligne rouge doit se comprendre comme le fait de ne pas augmenter la dette « en valeur réelle », c’est-à-dire en tenant compte de l’inflation. Si l’inflation est de 6%, la dette « réelle » diminuerait automatiquement de 6%. Ne pas l’augmenter signifierait alors la laisser augmenter nominalement de 6%… À comparer avec une prévision de déficit public et d’augmentation de la dette publique en 2022 à peu près équivalente. Il n’y aurait donc pas de réduction drastique du déficit et des dépenses publiques à programmer mais un ajustement progressif de ceux-ci correspondant à l’évolution de l’inflation. Sauf que, comme le cap fixé par ailleurs, notamment par la BCE est de faire revenir l’inflation à 2% d’ici à 2024, il faudrait parallèlement diminuer d’autant le déficit public. Soit tout de même 120 milliards d’euros actuels (4 points de PIB) en deux ans.
Il est vrai que dans l’après-deuxième guerre mondiale, l’inflation a été une des causes ayant fait fondre la dette publique. Mais l’une des causes seulement, comme l’explique l’économiste Jézabel Couppey-Soubeyran. Il a fallu, en même temps, une forte croissance, réaliser des investissements publics massifs et utiles, eux-mêmes facilités par le circuit de financement hors marché du Trésor public. Le « en même temps » d’aujourd’hui est très, très éloigné de celui de l’époque.
Une troisième façon de comprendre l’injonction présidentielle est de considérer que, même s’il ne l’a pas dit, la ligne rouge est de ne pas augmenter la dette non pas en valeur absolue mais par rapport au PIB. Dans ce cas, le déficit public en valeur ne devrait pas être supérieur à la croissance en valeur du PIB. Les objectifs de réduction du déficit et de la dépense publique ne seraient pas sensiblement diminués.
Menace de forte augmentation des intérêts
La contrainte sur les dépenses utiles sera d’autant plus forte que les charges financières publiques vont augmenter sensiblement. Durant la décennie passée, la politique monétaire de la BCE a favorisé une baisse importante des taux d’intérêts sur la dette publique. Le spécialiste des comptes publics François Ecalle a calculé que de 2010 à 2020, la charge d’intérêt a baissé de 20 milliards d’euros alors que la dette a parallèlement augmenté sur la même période de 770 milliards d’euros.
Le mouvement inverse est en train de se produire. D’une part un peu plus de 10% de la dette publique est indexée sur l’inflation. Selon François Ecalle, un point d’inflation en plus coûte directement 2,2 milliards de charges annuelles d’intérêt. L’inflation de 2022 va ainsi « coûter » au bas mot autour de 8 milliards d’euros de charges financières supplémentaires. D’autre part les Banques centrales des pays occidentaux – notamment la Banque centrale européenne – s’engagent, au nom de la lutte contre l’inflation, dans une politique de relèvement des taux d’intérêt. Selon Patrick Artus, si les taux approchent comme c’est prévisible les 3% l’an prochain, « cela veut dire 80 milliards d’euros de plus à rembourser par an à horizon huit ou dix ans ». Et donc, si l’on comprend bien, une augmentation de l’ordre de 8 à 10 milliards des charges financières publiques annuelles. Soit autant de moins pour les autres dépenses.
Limiter la contrainte grâce à la croissance ?
Il est en réalité impossible dans le cadre du mandat présidentiel de compter sur la croissance pour augmenter les ressources publiques (un point de croissance du PIB = environ 0,5 point de ressources publiques, soit 13 à 14 milliards). Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, affirme que « selon nos projections, la dette publique française resterait au mieux quasi-stable autour de 110% du PIB d’ici à 2032 à politique budgétaire inchangée ». Tout est dans le « au mieux ». Il faudrait en effet que la croissance reste positive en 2022 (2,3% en moyenne) et 2023 (1,2%) et retrouve dès 2024 le niveau de la croissance potentielle de 1,7%. L’inflation rentrerait progressivement d’ici la fin 2024 dans les clous des 2%. Et le resserrement de la politique monétaire de la BCE resterait modéré.
En même temps que ces prévisions, la Banque de France publie elle-même un autre scénario dit « défavorable, mais moins probable » dans lequel la poursuite de la guerre en Ukraine s’accompagne d’un arrêt de l’approvisionnement européen en gaz russe et de hausses de prix durables sur les marchés mondiaux de l’alimentation. Et que croyez-vous qu’il adviendrait ? « La France connaîtrait une récession et l’inflation atteindrait 7% en 2023, avant une amélioration en 2024 ».
Moins probable, ce scénario de poursuite du choc de la guerre en Ukraine ? Et sortie rapide d’une récession dès 2024 sans changement de cap de la politique économique ? Le « camp de la raison » est-il bien raisonnable ? Dans le contexte mondial actuel et dans le cadre fixé par le Président, le plus probable en réalité n’est pas que la croissance permette de fournir des marges de manœuvre pour obtenir ensemble ni impôt, ni dette, ni austérité. Mais au contraire, que cette croissance ne soit pas au rendez-vous. Le plus probable est la réalisation de cercles vicieux bien connus des politiques budgétaires et monétaires restrictives dans un contexte de récession économique.
Les conséquences de la ligne rouge du futur gouvernement Borne fixée par Emmanuel Macron sont donc claires : au-delà d’un « paquet pouvoir d’achat » limité, insuffisant, c’est la baisse des dépenses publiques pourtant indispensables pour assurer les transformations écologiques et sociales de notre pays et réaliser la promesse républicaine d’égalité et de solidarité. Avec son ni impôt ni dette, le Président pense certainement avoir activé deux leviers populaires pour ne pas dire populistes. Ce faisant, il désigne le lieu de batailles incontournables. Et sur l’impôt, et sur la dette.