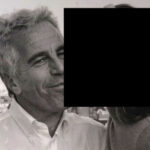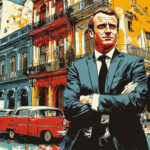En 2023, Houellebecq ou Bégaudeau ?

ARCHIVES. Cette chronique d’Arnaud Viviant est extraite de notre numéro de printemps 2015, à retrouver en cliquant ici.
Le terme de « zadiste » entrera-t-il un jour dans le dictionnaire ? Et si oui, quand ? Le plus vite serait le mieux, car il envahit comme du chiendent la littérature, d’essai ou de fiction. Prenons par exemple Le Grand Paris du séparatisme social, un essai du sociologue Hacène Belmessous. Il pose une question intéressante : pourquoi n’existe-t-il pas, contrairement à la province, de Zone à défendre (ZAD) en Île-de-France, à l’heure grave où le Grand Paris se façonne et se dessine pourtant de façon beaucoup plus politique que citoyenne ?
Certes, l’auteur a bien repéré dans les Hauts-de-Seine, plus exactement dans le quartier de la Défense, deux territoires qui ressemblent à des ZAD : à savoir La Ferme du bonheur et le Champ de la Garde. Mais après les avoir bien étudiés, il remarque combien ces expériences « agro-poétiques » en milieu urbain, diffèrent des ZAD. Il note ainsi que « si le Champ de la garde avait recouru à un mode d’action et de langage plus frontal, par exemple en s’affirmant ouvertement comme un lieu « contre » – le capitalisme, l’urbanisme libéral, la société de consommation, la financiarisation de la sphère publique – l’adhésion à cette mobilisation hebdomadaire ne serait ni aussi pérenne ni aussi massive ». Pas de politisation du geste, donc, mais « un joyeux bordel » où l’on rencontre plutôt des « engagés » que des enragés. Or, quand il se rend à Notre-Dame-des-Landes, le chercheur entend soudain un tout autre langage : « Nous n’avons rien à voir avec les partis politiques. Ils sont du côté de l’État et de sa logique financière et économique. Ils sont partenaires de ce système, ses intermédiaires. On ne lutte pas avec des adversaires, on les combat » (Un zadiste, étudiant en architecture). On laissera le chercheur se dépatouiller avec cet intéressant différentiel de radicalité entre Paris et la province, pour noter que le zadisme est assurément le phénomène politique le plus important de ces dernières années. Très loin devant la montée du Front national, ça c’est sûr.
La preuve ultime, c’est que le zadisme a désormais son roman. La nouvelle fiction de l’auteur de Entre les murs, François Bégaudeau, s’intitule La Politesse. C’est une mécanique textuelle de haute précision qui raconte trois fois la même histoire, celle d’un écrivain (Bégaudeau dans son propre rôle) qui fait sa promo en 2012, en 2013, puis en 2023, dans une France où le « zadisme », appelons-le comme ça, s’est réalisé. Le zadisme ou la politesse, autre nom de cette utopie, politesse envers les autres qu’on ne domine plus, politesse envers soi-même qu’on libère de ses chaînes, politesse envers la nature qu’on respecte (le zadisme est foncièrement écologique). Dans cette France zadiste de 2023, peut-être grâce à un revenu universel garanti pour tous, mais peut-être pas non plus, on travaille beaucoup moins, mais on s’organise en SCOP (comme Regards !), mais on cherche beaucoup plus, on pratique le troc, on laisse les enfants s’occuper d’une ferme qui ressemble furieusement à la Ferme du bonheur évoquée plus haut, on met tout en commun, y compris l’imagination, y compris les droits d’auteur des écrivains, puisqu’il n’y a enfin plus d’auteur, ouf, en tout cas pas dans le sens où on le comprenait en 2012-2013, re-ouf.
Car en racontant ses tournées promos de 2012 et 2013, qui l’emmènent un peu partout en France, et même en Belgique, ce que raconte Bégaudeau, c’est un monde en crise au sens où Gramsci l’entendait. Tout le monde connaît la citation, même Sarkozy. Car Gramsci est à la mode. Même à droite. Surtout à droite, d’ailleurs, où on a toujours compris plus vite qu’à gauche, ce que « crise » veut vraiment dire. La citation de Gramsci, Bégaudeau la réécrit à sa façon. Il raconte à sa petite nièce, qui avait dix ans en 2013 et qui lui demande comment c’était avant, que « le sel de cette époque, c’est que tout mourait, tout émergeait ». De ce point de vue, Bégaudeau est vraiment l’anti-Houellebecq. On se souvient que Soumission, son dernier roman, se situe en 2022, donc un an avant celui de Bégaudeau. Ce sont deux visions diamétralement opposées que nous proposent ces grands écrivains contemporains, dans un style et une idéologie fort différents. On n’est pas à la Nouvelle Star ici, on n’a pas à voter, tant qu’à faire, pour le pire ou le moins pire. On est en littérature, et il faut lire.
On a écrit beaucoup de bêtises sur le roman de Houellebecq, je trouve, jusqu’ici. On a voulu le récupérer politiquement. On a bien raison, mais pas comme ça. Car Houellebecq, très cohérent, on ne peut pas lui enlever ça, ne dit qu’une seule chose : que notre démocratie représentative ne fonctionne plus, ou alors, si on veut continuer à le croire, gare au pire. De l’autre côté, François Bégaudeau ne dit pas autre chose. Cependant, dans ce roman qu’il faut lire, et surtout relire, il fait l’ellipse sur la transition entre l’ancien monde et le nouveau. Comment passe-t-on de l’un à l’autre ? Par vote « démocratique » ou par révolution plus ou moins soft ?