
Alors que le phénomène d’« embrouilles » au sein des quartiers populaires peut avoir de nombreux impacts sur les jeunes, leurs racines sont souvent méconsidérées. Décryptage avec la sociologue Audrey Teko.
En 2024, étaient recensés 440 phénomènes de violences entre bandes dans l’agglomération parisienne, contre 413 en 2023 selon la préfecture de police de Paris. Mais il y a un distinguo à faire entre « rixes » et « embrouilles ». Loin d’être de « simples rixes », les embrouilles de cités sont un phénomène plus large, où l’affrontement physique n’est que la partie visible de tensions permanentes. Insistant sur l’absence de lien entre le trafic de drogue et ce phénomène d’« embrouilles de cités », Audrey Teko1 souligne que « l’attachement au territoire est symbolique et non économique ». Ce phénomène a de nombreuses conséquences, parfois négligées, sur les jeunes impliqués, mais aussi leurs proches.
La culture de l’embrouille représente pour ces jeunes « une sphère de valorisation et de reconnaissance » qu’ils peinent à trouver ailleurs. L’une des conclusions à laquelle mène cette thèse est que « les jeunes les plus impliqués dans les embrouilles sont ceux qui déclarent le plus fort sentiment d’injustice scolaire ».
Par ailleurs, selon une enquête effectuée dans le cadre de cette thèse sur plus de 1000 élèves, l’implication du genre féminin dans ces affrontements semble marginal. Pour autant, elle « ne doit pas être invisibilisée, tout comme la participation des filles à des rôles dits secondaires (incitatrices, spectatrices, victimes etc.) ». L’écrivain Édouard Louis parle de la masculinité comme « la richesse des pauvres » car perçue par une partie des classes populaires comme une béquille à leur honneur, ressenti comme bafoué par les inégalités sociales. Audrey Teko rejoint ce constat en expliquant que la culture de l’embrouille représente pour ces jeunes « un espace d’expression des masculinités marginalisées ».
Au-delà de la violence des affrontements en eux-mêmes, un « spectre de violences moins visibles » impacte la vie des jeunes impliqués ou de leurs proches. Il peut devenir par exemple difficile pour des filles de « sociabiliser avec des garçons de quartiers rivaux ». Il peut être difficile voire dangereux, pour les jeunes directement concernés, de fréquenter certains établissements, par risque de croiser des jeunes de territoires rivaux : un impact non-négligeable sur l’orientation scolaire et professionnelle de ces jeunes.
Traiter la cause et non seulement les effets
Les mesures judiciaires ne prenant place, par définition, que lorsque l’infraction est commise, elles ne peuvent participer au traitement des causes du problème. En menant sa thèse, Audrey Teko a décelé trois temporalités éducatives, de ses racines aux tragédies auxquelles il peut mener : la prévention, « avant qu’un phénomène d’embrouille ne s’installe sur un territoire », la remédiation, « lorsque celui-ci est installé » puis la gestion de crise, « lorsqu’il y a un décès de jeune(s) ou une intense période d’affrontements ».
Tout au long de ces trois temporalités, les acteurs éducatifs (éducateurs, animateurs et associatifs, etc.) jouent un rôle clé auprès des jeunes. Les personnes concernées ont souvent évoqué la nécessité de « revaloriser ces métiers et leurs rémunérations », de se former davantage, tout en offrant « des conditions de travail, notamment matérielles qui ne soient pas décalées de leur engagement professionnel ».
Atténuer l’origine de cet attrait pour l’embrouille
Parmi les pistes à explorer en matière de prévention, une meilleure écoute de la parole des jeunes, « souvent invisibilisée », est un enjeu crucial : « À la violence sociale et scolaire que les jeunes impliqués dans les embrouilles vivent, s’ajoute la violence de la silenciation ».
« C’est cette misère qui rend fou, expliquait un jeune à Audrey Teko. Si on était doté des mêmes moyens que certains quartiers ou collèges parisiens, je ne serais peut-être pas dans les embrouilles. » Une phrase extraite d’un rapport de la Cour des comptes mentionne que « l’établissement scolaire le moins bien doté de Paris reste mieux doté que le plus doté de Seine-Saint-Denis ».
Selon Sophie Venetitay, secrétaire générale du syndicat SNES-FSU, s’impose la nécessité de mener une politique interministérielle (incluant l’éducation, la sécurité intérieure, le logement et la jeunesse), « pour traiter à la racine la question des rivalités entre bandes ».
La sociologue argue que « lutter contre les inégalités sociales et scolaires » est la clé pour atténuer cette dynamique : « Il faudrait que chaque jeune puisse trouver sa place à l’école, sinon il la trouvera ailleurs ».
Répondre par le développement d’alternatives à une quête d’adrénaline et de valorisation
Les inégalités scolaires et sociales correspondant aux principales origines de cette dynamique, ce n’est donc pas demain la veille que ces racines pourront être traitées en profondeur. La principale question réside donc aujourd’hui dans la façon dont est, ou pourrait être, redirigée cette quête de valorisation.
Dans cette optique, les acteurs éducatifs ont souvent recours à l’art, et parfois au sport. Deux acteurs associatifs qu’Audrey Teko a rencontrés utilisaient le football et la boxe par exemple.
Dans les propos des jeunes impliqués, revient souvent la « notion d’adrénaline » qui leur « permet de se sentir vivant ». La boxe et le football peuvent donc répondre à cette recherche, reconnaît-elle. Toutefois, la sociologue souligne le risque que la pratique de ces sports, si elle est mal encadrée, ne renforce des normes virilistes ou ravive des tensions entre les jeunes en embrouilles.
L’implication de jeunes concernés ou anciennement concernés dans ce problème est « une des pistes de sortie », pour qui ces jeunes « font partie du problème mais aussi de la solution » en agissant en tant que jeunes, acteurs éducatifs, et/ou par le biais d’associations. L’universitaire appuie également sur la nécessité « d’investir ces jeunes en tant qu’acteurs, même si ces derniers ne sont pas structurés en association ou autre », de sorte à les faire jouer un rôle moteur dans la mise en place de solutions.
Un expérience ayant particulièrement marqué Audrey Teko à ce sujet est celle d’une junior association, qu’elle a accompagnée pendant plusieurs mois. Celle-ci avait été fondée par des collégiens à la suite de deux expériences de deuils successifs de leurs amis, âgés de 13 ans et 15 ans. « Se considérant comme les principaux concernés, ils ont alors décidé de se réapproprier le traitement de ces violences. » Une expérience particulièrement intéressante pour l’universitaire, puisque « parmi les jeunes endeuillés et engagés dans l’association, se trouvaient des jeunes impliqués dans les embrouilles ».
Concernant cette quête de reconnaissance évoquée plus haut, l’espace de l’association semble donc être une piste à ne pas négliger, cette association est par exemple devenue « un autre espace de reconnaissance et de valorisation ». Un espace où les jeunes « ont alors été reconnus autrement que comme des acteurs de violences », un cercle vertueux qui les a poussés à se désengager d’embrouilles par la suite.
Pour réduire voire endiguer ce phénomène, Audrey constate le caractère « absolument incontournable » des acteurs associatifs. « Néanmoins, poursuit-elle, [ces acteurs] sont peu dotés financièrement pour intervenir et font même parfois l’objet de mépris et de disqualification de la part des institutions. » Ces derniers peinant à être considérés comme des acteurs éducatifs à part entière. »
Par ailleurs, bien que la scène de l’affrontement soit très masculine, « celle de la prise en charge des violences est très féminine, comme l’ont déjà documenté les organisations féministes ».
« Il est donc essentiel de ne pas invisibiliser leur engagement associatif, social et politique. Si elles sont nombreuses à s’engager, c’est aussi parce qu’elles vivent les conséquences des embrouilles et font notamment l’expérience du deuil en tant que mère, sœur, amie, proche. »
Malgré les efforts de médiation, les embrouilles restent une réalité prégnante, elles témoignent d’un besoin de reconnaissance et d’une quête identitaire qui ne peuvent être ignorées. Ce sont des dynamiques profondes liées à la façon dont les jeunes de quartiers populaires peuvent percevoir leur place dans la société. Tant que cette question ne sera pas abordée en profondeur, les embrouilles ne disparaîtront pas. Comprendre ces tensions c’est aussi interroger le regard porté sur ces jeunes et les solutions mises en place pour les accompagner. Entre confrontation et besoins de reconnaissance, les embrouilles de cités restent le symptôme d’un malaise plus large où la question n’est pas tant de savoir qui détient un territoire mais de savoir qui se sent reconnu dans l’espace public.
- La sociologue Audrey Teko, spécialiste des sociabilités et déviances juvéniles, a vécu et travaillé en Seine-Saint-Denis puis y a consacré sa thèse, en contrat doctoral avec le département de Seine-Saint-Denis. ↩︎





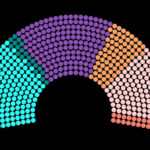
Article remarquable sur la comprehension de ce type de violence inter quartier. Peut-on transférer ces logiques à propos des violences entre jeunes ruraux et jeunes des quartiers?
Très bonne question
a voir quelles sont les réalités des jeunes « ruraux »…