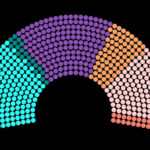14-18 : les enjeux d’une commémoration

Nous republions un entretien avec Nicolas Offenstadt, spécialiste de la Grande Guerre, paru dans le numéro d’hiver 2013 de Regards. Chacun jugera sur pièces de la légèreté historique des propos de M. Kuzmanovic et du caractère inquiétant de l’orientation idéologique qui l’accompagne.
Dans le dernier numéro de Marianne, Djorje Kuzmanovic, « orateur national de la France insoumise », publie une tribune étonnante, intitulée « Pour une commémoration de la victoire de 1918 et contre le mépris de nos morts ».
Il y défend l’idée que la cause de la guerre se trouve dans les « calculs erronés d’une petite élite allemande ». Il s’inscrit ainsi dans la pure tradition du patriotisme revanchard, contre lequel s’est dressé le cœur du mouvement ouvrier européen et dans lequel sombra la social-démocratie continentale, totalement compromise dans la guerre et ses politiques d’Union sacrée.
Pour mesurer les enjeux, de la commémoration de la première guerre mondiale, nous avons rencontré l’historien Nicolas Offenstadt, membre du conseil scientifique de la Mission du centenaire.
Regards. Comment se situe la commémoration en cours par rapport à toutes les précédentes ? N’y a-t-il pas le risque d’une commémoration classique, consensuelle et passe-partout ?
Nicolas Offenstadt. Le risque existe, bien sûr, mais je vois aussi la possibilité d’un événement qui mobilise les populations davantage encore que les États. Les quelque 1 200 projets habilités à ce jour par la Mission du Centenaire, sans compter les autres, donnent une image polycentrique, plurielle, où le théâtre pacifiste, l’initiative culturelle, la pratique enseignante côtoieront des formes plus traditionnelles. Au fond, la commémoration sera ce que les peuples décideront d’en faire et, à mes yeux, l’enjeu est d’en faire une histoire réellement populaire, à tous les sens du terme : une histoire de ceux « d’en bas » et une commémoration où s’associent spécialistes, citoyens, élus et institutions de tous types.
Dans la commémoration au sommet de l’État, je ne cache pas que m’inquiètent quelques signes, comme le récent discours présidentiel du 7 novembre à l’Élysée et du 11 novembre à Oyonnax. J’y ai senti l’attirance, à nouveau, pour une dimension répétitive placée sous le sceau du patriotisme. J’ai perçu aussi la possibilité d’un réel rétrécissement du champ d’observation, avec par exemple le retour vers les « héros de la Marne », ce qui nous renverrait vers cette commémoration franco-française et héroïque que Jean-François Copé appelle de ses vœux. J’ajoute que j’ai les plus vives réserves sur l’affirmation de la continuité du combat des « poilus » et de celui des résistants de la Seconde Guerre. Les Allemands de 1914 n’étaient pas les nazis et les soldats de la Première Guerre étaient des conscrits, qui se sont battus dans des conditions éprouvantes mais n’avaient pas choisi de la faire, tandis que l’engagement résistant relevait quasi exclusivement d’un choix assumé. La dimension fondatrice de la liberté ne fonctionne pas de la même manière en 1914 et dans la France occupée. A l’ignorer, on court le risque de s’engager dans de la mauvaise histoire, la énième redite du grand roman national.
Dans une période de crise, beaucoup peuvent être tentés par le regard consensuel et trouver, dans l’exaltation du sacrifice d’hier, le ciment qui fait justement défaut aujourd’hui. Ce n’est pas de l’histoire ; c’est de la courte vue politique. On a besoin d’autre chose.
Comment définiriez-vous la meilleure manière de conduire aujourd’hui une commémoration vraiment à la hauteur ?
J’attendais du Président de la République le lancement d’une réflexion de long souffle sur la guerre de 14-18 elle-même, et pas une continuation quasi à l’identique de la geste franco-française. Une commémoration digne de notre époque pourrait à mes yeux se déployer autour de quatre grandes exigences. Tout d’abord, nous aurions besoin d’une histoire qui soit pleinement l’occasion de débats publics. Tout le monde n’attend pas la même chose d’une commémoration, ne pense pas de la même manière le sens de ce qui doit faire l’objet d’initiative collective. La seule façon d’éviter le consensus mou, c’est d’assumer ces débats. Et pour qu’ils soient bien menés, rien n’est plus important que de parvenir à une véritable forme hybride de la commémoration où professionnels et citoyens discutent ensemble, par exemple à l’occasion d’initiatives publiques vers la population. Il est des sujets qui méritent de vrais débats, larges et non pas seulement académiques, par exemple le rôle du 11 novembre : je pense aussi à celui qu’aurait pu provoquer la mémoire des désobéissances et des fusillés, ou du moins, la place à accorder à ces questions dans la mémoire nationale. Il est vrai qu’au niveau local et associatif ces questions sont discutées.
Je pense en second lieu qu’il faut utiliser tous les outils culturels disponibles pour renouveler la panoplie des commémorations officielles. Je suis persuadé qu’il est nécessaire et possible de transformer les grands rituels en les démilitarisant et en les culturalisant. li n’y a pas que la gerbe au monument aux morts. On peut organiser des journées du cinéma, utiliser la production souvent très contemporaine des romanciers, chanteurs de hard rock ou de pop. Le groupe Indochine a sorti en 2009 un album étonnant, inspiré de lettres de poilus et intitulé La République des Meteors. C’est un remarquable outil pour faire réfléchir. J’ai un peu l’impression qu’on a raté le coche en 2008, au moment de la mort du dernier poilu, Lazare Ponticelli. On aurait pu donner toute sa dimension humaine et symbolique à ce parcours, en projetant des films, en sollicitant des gens de théâtre ; en fait, on a préféré la sempiternelle cérémonie militaire aux Invalides.
En troisième lieu, je tiens énormément à ce que l’on quitte l’horizon strictement français qui ne suffit pas à comprendre l’originalité fondamentale de ce conflit. Il fut vraiment le premier mondial et sa mémoire touche donc l’Afrique, l’Australie, le Canada, la Chine et tant d’autres. C’est un enjeu extraordinaire, à la fois universitaire, scolaire et citoyen, que de réintégrer ces mémoires, mais aussi de rappeler que la séquence de 1914-1918 fut aussi celle du génocide arménien, des révolutions russes de 1917 et, dans la foulée, de la vague révolutionnaire européenne. Se fixer seulement sur le poilu peut être un appauvrissement, dans la variante héroïsante et patriotique qu’affectionne la droite, mais aussi, à sa manière, dans la variante de gauche qui s’attache d’abord à valoriser le soldat écrasé par la machine de guerre. sacrifice des colonisés au service de la mère partie. Il faut rappeler le recrutement forcé, les violences pour conduire les colonisés à la guerre. Il ne faut pas taire les révoltes et leurs conséquences très dures. Sans compter l’exploitation des travailleurs chinois ou des Camerounais dans les possessions allemandes, etc.
Entre ceux qui voient dans les quelques semaines qui séparent Sarajevo de la guerre générale, l’enchaînement de méfiances et de malentendus venant de dirigeants « somnambules » et ceux qui, au contraire, y voient une sorte de fatalité historique, Les débats ne manquent pas. Qu’avez-vous envie de retenir pour votre part ?
Pas facile d’aller vite sur un sujet aussi complexe. En quelques mots, j’aurais surtout envie de dire qu’il ne faut surtout pas juger du déclenchement du conflit à l’aune de l’horreur qui a suivi. Ce qu’ont risqué les puissances centrales, ce n’était au départ qu’une guerre limitée, pas une guerre mondiale de cette ampleur. L’enjeu de départ concerne l’Autriche et la Serbie, et les deux protagonistes ne raisonnent d’abord que dans ce contexte particulier, même s’ils prennent de plus larges risques. Ajoutons par ailleurs que les anticipations des militaires portent sur une guerre courte, ou plutôt que chacun veut courte, comme si chaque état-major est alors persuadé que la rapidité d’exécution est la seule manière d’obtenir une victoire totale.
Enfin, je crois que, malgré l’existence ici ou là d’écrits d’apparence visionnaire, les acteurs du jeu de l’été 1914 n’ont pas vraiment idée de ce qu’est une guerre industrielle. L’horizon général des militaires de l’époque, c’est la logique offensive des décennies précédentes, c’est la dynamique de la cavalerie et de l’infanterie davantage que la puissance de feu. Il faut avoir tout cela en tête quand on aborde la séquence cruciale qui va du 28 juin au 4 août.
On reprend souvent l’expression d’ Éric Hobsbawm qui dit de la Grande Guerre qu’elle fut l’acte fondateur du « court XXe siècle ». Comment traiteriez-vous personnellement de cette question ?
La guerre introduisit de fait un profond bouleversement. Ce fut la fin d’une société. La naissance de l’inflation a ainsi tué la rente et obligé la bourgeoisie à se mettre au travail, ce qui a accéléré les mutations industrielles. Ces années furent aussi celles de la naissance du communisme, parce qu’elles ont déstabilisé à mort l’empire russe et parce que l’expérience du feu a structuré une génération.
La fièvre révolutionnaire n’a significativement pas touché que la Russie, mais aussi, particulièrement, la Bavière où la Hongrie. L’effondrement du socialisme de 1914 est d’abord le fait de la guerre, alors que les décennies précédentes l’avaient plutôt conforté. De façon plus générale, la guerre a installé dans l’espace public un pacifisme, multiforme, qui n’est plus un mouvement marginal et plutôt intellectuel et culturel, mais un mouvement de masse qui a profondément marqué l’entre-deux-guerres et traversé le siècle. Enfin, il ne faut pas négliger l’aspect anthropologique du conflit, par la marque qu’il a imprimée sur la génération masculine du feu (huit millions de mobilisés pour la seule France), les familles et par les traces qui sont restées dans les générations suivantes. On est devant des mémoires familiales à la fois déchirées et très fortes. La transmission mémorielle est directe – c’est notamment le poids décisif des grands-pères – ou elle est indirecte, par le biais de l’écrit. En 1914, la percée des scolarisations élémentaires de masse a développé des sociétés de l’écrit. Nous en avons gardé, avec la masse des lettres échangées, la trace parfois traumatique qui balise encore notre univers mental. D’autant plus que c’est la génération des petits-fils qui est encore au pouvoir.