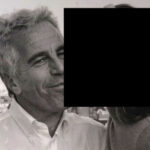Le nouvel âge du féminisme

Il aura fallu beaucoup de temps pour que le vieillissement des femmes et les discriminations qui l’accompagnent soient inscrits à l’agenda féministe. Mais le moment de lier sexisme et âgisme semble venu.
***
Cet article est extrait du n°54 de la revue Regards, publié au premier semestre 2021 et toujours disponible dans notre boutique !
***
Le dimanche après-midi, la journaliste et productrice Laure Adler nage dans le couloir réservé à la brasse de la piscine municipale de son quartier. Dans le bassin, elle remarque un jour une femme de son âge qui double tranquillement un trentenaire. « Pour être aussi gracieuse dans ses mouvements, je me dis qu’elle doit être une ancienne championne. Le jeune type lui bloque le passage au beau milieu de la piscine pour la contraindre à ralentir. Elle prend son inspiration et lui passe dessous puis continue. Il la bloque à l’autre extrémité, enlève ses lunettes, lui crache à la figure en criant : ‘Va te faire baiser, vieille salope, au lieu de nous emmerder à nous faire croire que tu vaux mieux que nous !’ La dame monte à l’échelle sans dire un mot, prend ses tongs et disparaît », relate-t-elle dans son « carnet de voyage au pays de la vieillesse », La Voyageuse de nuit.
L’invisibilité de la femme de cinquante ans
Au fond, rien n’a changé depuis les années 1970. Le bilan s’est même aggravé. À soixante-dix ans, Laure Adler a un certain âge, pas encore un âge certain. Mais dans le regard des autres, son sort est scellé depuis longtemps. « Arrêtons d’accepter d’être traités – et quelquefois dès l’âge de cinquante ans – comme des non-sujets, comme ces denrées périmées que les employés des supermarchés viennent, à la nuit tombée, jeter dans la benne à ordures », clame-t-elle. « Il y a pire qu’un vieux sans signe distinctif. C’est une vieille. Il y a pire qu’une vieille. C’est un vieux pauvre. Il y a pire qu’un vieux pauvre : c’est une vieille pauvre », affirme encore l’autrice. Souvenons-nous du tollé suscité par le chroniqueur de télé Yann Moix, qui s’était répandu dans Marie Claire : « Aimer une femme de cinquante ans ? Ça, ce n’est pas possible. Je trouve ça trop vieux. (…) Elles sont invisibles. Je préfère le corps des femmes jeunes, c’est tout. Point. Je ne vais pas vous mentir. Un corps de femme de vingt-cinq ans, c’est extraordinaire. Le corps de femme de cinquante ans n’est pas extraordinaire du tout. »
De fait, la révolte monte, portée par des femmes. Dans Le Cœur synthétique, l’écrivaine Chloé Delaume décortique avec humour le cas d’Adélaïde, attachée de presse dans l’édition. À quarante-six ans, elle a toujours « enchaîné », croit que ça va continuer mais, après un divorce qu’elle a suscité, elle se découvre soudain périmée sur le marché de l’amour. On la retrouve dans un club chic, pathétique, à enchaîner les gin tonics. « Elle repère un quadra, il a de la bedaine, elle pense avoir ses chances, elle est plus jolie que lui. Elle s’approche et se pose dans son champ de vision. Il ne se passe rien, son regard la transperce. Adélaïde découvre l’invisibilité de la femme de cinquante ans, avec un peu d’avance. À cet instant précis, elle se sent déjà morte », écrit Chloé Delaume.
« En sortant du groupe des femmes potentiellement procréatrices, c’est-à-dire aussi du groupe des femmes désirantes, les quinquagénaires passent de l’autre côté. »
Camille Froidevaux-Metterie, philosophe
La question du vieillissement des femmes a émergé très récemment dans l’espace public, portée par diverses productions culturelles : sur les planches, avec la pièce de théâtre Ménopause. La comédie qui bouscule les règles, jouée à la Madeleine puis à la Gaîté Montparnasse ; sur les ondes avec le podcast d’Arte Radio créé par Charlotte Bienaimé, « Vieille, et alors ? » ; en librairie avec l’essai de la sociologue Cécile Charlap, La Fabrique de la ménopause. « Le mot et les expériences qui l’entourent s’affichent et se disent. Jusqu’ici, la ménopause n’était traitée que sous l’angle médical, par des professionnels de santé qui avaient toute la légitimité pour l’évoquer. L’émergence de cette thématique participe d’une nouvelle vague féministe qui englobe les questions de génitalité, de clitoris, de menstruation, d’endométriose, de violences gynécologiques et obstétricales », estime l’autrice.
« Nous sortons d’un long déni », ajoute la philosophe Camille Froidevaux-Metterie, qui a publié Seins. En quête d’une libération (éd. Anamosa, 2020). « En 2017, le livre à succès Les Joies d’en bas. Tout sur le sexe féminin affirmait tout expliquer, les pertes blanches, les règles, la grossesse, le plaisir, mais ne consacrait aucun chapitre à la ménopause, balayée en une phrase sur une éventuelle sécheresse vaginale liée à ce phénomène, une image relayée elle avec constance ! », poursuit-elle.
Un impensé du féminisme
Qu’a donc fait le féminisme, durant toutes ces années, pour lutter contre le sort fait à celles qu’on traite parfois de « vieilles peaux » ? Pourquoi le slogan des années 1960, « Mon corps m’appartient », est-il resté inopérant face aux rides et aux cheveux blancs ? Comment expliquer que les mouvements pour l’émancipation des femmes n’aient pas essayé plus tôt de contrecarrer les stéréotypes et les inégalités attachés aux effets de l’âge qui, conjugués au féminin, s’apparente à une double peine ?
« Le vieillissement féminin est, au contraire du vieillissement masculin, considéré comme pathologique, synonyme de disqualification et d’exclusion. »
Cécile Charlap, sociologue
Première peine, les femmes deviennent invisibles, voire indésirables dès lors qu’elles ne sont plus fécondes. « Le tournant de la ménopause marque l’entrée dans le temps du vieillissement. En sortant du groupe des femmes potentiellement procréatrices, c’est-à-dire aussi du groupe des femmes désirantes, les quinquagénaires passent de l’autre côté, alors que rien ne signifie aux hommes qu’ils sont en train de vieillir. Ils peuvent donc vivre dans le fantasme d’une jeunesse perpétuelle, encouragé en cela par la trouvaille bienvenue du Viagra », indique la philosophe Camille Froidevaux-Metterie. « Le vieillissement masculin est vu du côté de la maturité, de la prise d’expérience. Jusqu’à la fin, on a trouvé Sean Connery beau, viril, sexy alors qu’il avait près de quatre-vingt-dix ans. Le vieillissement féminin est au contraire considéré comme pathologique, synonyme de disqualification et d’exclusion », abonde Cécile Charlap.
Seconde peine, leurs conditions de vie sont moins favorables que celles des hommes, si bien qu’au stigmate de la femme périmée s’ajoutent des inégalités économiques et sociales. « Ce pays est vieillissant, et la mortalité différentielle donne aux femmes une espérance de vie plus élevée que celle des hommes. Les femmes âgées sont plus nombreuses, plus pauvres aussi et plus solitaires que les hommes », rappelait la sociologue Rose-Marie Lagrave en 2009, dans la revue Mouvements.
« Cette heure de vérité sociale sexuée est paradoxalement passée sous silence par les groupes féministes qui laissent ‘le grand âge’, comme on dit, au traitement des politiques sociales et familiales. »
Rose-Marie Lagrave, sociologue
Et pourtant, on ne peut que le constater : si le droit à l’avortement et à la contraception ainsi que l’égalité professionnelle sont des causes historiques du féminisme, le vieillissement – lieu d’observation privilégié des normes de genre et de sexualité – est longtemps resté un angle mort des combats d’émancipation. Au point que Rose-Marie Lagrave y voyait à l’époque un « impensé du féminisme ». Pour rappel, « les engagements féministes ont marginalement concerné la vieillesse, qui n’a fait l’objet d’aucune lutte ou pratique spécifiques collective d’envergure », de sorte que « cette heure de vérité sociale sexuée est paradoxalement passée sous silence par les groupes féministes qui laissent ‘le grand âge’, comme on dit, au traitement des politiques sociales et familiales », déplorait la chercheuse. Ce silence lui apparaissait d’autant plus paradoxal que sa génération, celle des militantes du Mouvement de libération des femmes (MLF), atteignait justement « les lisières de la vieillesse ».
La force du stigmate
Il faut bien reconnaître que le MLF ne s’est guère préoccupé de mettre en relation sexisme et âgisme. « L’approche féministe de l’âge et du vieillissement demeure marginale au cours des années 1970. Les revendications se focalisent sur le contrôle de la fécondité, sur le travail, sur la liberté de mouvement ou sur celle de vivre sa sexualité », relève la sociologue Juliette Rennes. Ce qui ne veut pas dire que cette thématique est totalement absente du paysage foisonnant de l’époque. Peu après qu’aux États-Unis, en pleine guerre du Vietnam, une poignée de retraitées eurent fondé Les Panthères grises pour défendre les femmes âgées, quelques initiatives voyaient le jour en France. Entre 1975 et 1979, paraît Mathusalem, « le journal qui n’a pas peur des vieux », qui consacre deux numéros aux vieilles autour des questions de beauté, de ménopause, d’inégalités face aux retraites… Signalons aussi – au milieu d’autres mouvements revendiquant une identité commune tels que Les Gouines rouges, Les Mères célibataires et Les Femmes mariées – la création du groupe Les Mûres ont la parole, fondé par Arlette Moch-David, qui se réunissait pour échanger entre femmes de plus de cinquante ans. Sans oublier La Vieillesse de Simone de Beauvoir, icône féministe qui se plaisait en compagnie de la jeunesse et a prêté son nom comme son image aux combats du MLF.
Quelques années plus tôt, dans La Force des choses, De Beauvoir observait sur elle ce phénomène. « Souvent je m’arrête, éberluée, devant cette chose incroyable qui me sert de visage. (…) Rien ne va plus. Je déteste mon image : au-dessus des yeux, la casquette, les poches en dessous, la face trop pleine, et cet air de tristesse autour de la bouche que donnent les rides. Peut-être les gens voient-ils simplement une quinquagénaire qui n’est ni bien ni mal, qui a l’âge qu’elle a. Mais moi, je vois mon ancienne tête où une vérole s’est mise dont je ne guérirai pas », proteste-t-elle. Ce sentiment de dépersonnalisation, passé le cap de la cinquantaine, Beauvoir l’aura très bien décrit. Mais son discours trahit aussi la force du stigmate : être une femme, philosophe, ne l’a pas prémunie contre la haine de soi. « Ce rapport de dégoût qu’elle entretient avec sa propre avancée en âge était une forme d’incorporation de cette disqualification. À la fin de La Force des choses, elle évoque le fait qu’elle ‘déteste’ l’image d’elle-même vieillissante que lui renvoie son miroir », observe Juliette Rennes, qui note également : « Elle évoque aussi toute une série de renoncements qu’elle pense fatalement et naturellement liés à la vieillesse. C’était une forme de préjugé sur la vieillesse qu’elle n’avait pas tout à fait déconstruit. »
La conclusion triste à mourir de cet ouvrage publié en 1963, alors qu’elle n’a que cinquante-cinq ans, en dit long sur l’exclusion des femmes vieillissantes : « Oui le moment est arrivé de dire jamais plus ! Ce n’est pas moi qui me détache de mes anciens bonheurs, ce sont eux qui se détachent de moi : les chemins de montagne se refusent à mes pieds. Jamais plus je ne m’écroulerai, grisée de fatigue, dans l’odeur du foin : jamais plus je ne glisserai solitaire sur la neige des matins. Jamais plus un homme », confesse Simone de Beauvoir. En 1970, dans La Vieillesse, elle se rebellera contre cette condition de paria et appellera à « briser la conspiration du silence ». Pour Juliette Rennes, « en s’engageant avec passion dix ans plus tard aux côtés du mouvement féministe, elle a en partie contredit son discours pessimiste sur son propre vieillissement ».
Politiser le vieillissement
Il faut cependant attendre les années 2000, en France, pour que la question de la relation entre le sexisme et l’âgisme commence à prendre dans le débat public. On le doit à deux personnalités qui ont politisé le vieillissement des femmes : Thérèse Clerc et Benoîte Groult. La première a porté à bout de bras le projet des Babayagas, à Montreuil, une maison de retraite alternative qu’elle a voulue non-mixte et autogérée. Outre sa volonté d’accueillir une université populaire où l’on parle du vieillissement des migrantes et de la sexualité des personnes âgées, Thérèse Clerc a participé à une chorégraphie intitulée « Vieilles peaux ». Avec des élèves en arts appliqués du lycée Eugénie-Cotton de Montreuil, elle a organisé un défilé de mode dont les modèles étaient des femmes de plus de quatre-vingts ans, et elle imaginait un « festival de Cannes » où seraient présentés les meilleurs films sur la vieillesse.
Benoîte Groult, quant à elle engagée dans le mouvement pour le droit de mourir dans la dignité, a participé au documentaire d’Anne Lenfant, Une chambre à elle : entretiens avec Benoîte Groult (2005), dans lequel elle évoque comment elle s’est vue vieillir dans le regard des autres alors qu’elle se sentait « égale à elle-même ». « Grâce à sa notoriété, Benoîte Groult a contribué à ouvrir une brèche à ces questions à partir de sa propre expérience, celle d’une femme qui subit de plein fouet sa disqualification sociale dans un milieu de la bourgeoisie politique, intellectuelle et médiatique où beaucoup d’hommes de son âge étaient avec des femmes plus jeunes », souligne Juliette Rennes. En règle générale, les quelques figures féministes qui ont politisé le vieillissement l’ont fait à partir de leur propre expérience, dans des récits à la première personne.
« Beaucoup de mouvements révolutionnaires se constituent autour de clivages générationnels et, du même coup, assimilent jeunesse et transformation sociale, vieillesse et conservatisme. Parfois cela conduit les militants à nier l’héritage des générations antérieures, et à rejeter les militants plus âgés. »
Juliette Rennes, sociologue
Il n’empêche que nombre de militantes des années 1970 n’en ont pas fait leur cheval de bataille. « Cette génération qui n’a cessé de clamer ‘Mon corps m’appartient’, se tait étrangement lorsque ce même corps donne des signes de décrépitude et de départ », s’étonne Rose-Marie Lagrave. C’est complètement assumé chez Marie-Jo Bonnet, qui a participé au MLF ainsi qu’à la fondation des Gouines rouges : le vieillissement, elle n’en a cure. Cette historienne qui publie aujourd’hui La Maternité symbolique ne se sent pas très concernée : « J’ai soixante et onze ans et je ne me considère pas du tout comme vieille, je continue d’écrire, d’avoir des engagements. Tout dépend de la vie qu’on mène. Il ne faut pas se laisser enfermer dans le regard social, autrement c’est cuit ! On nous casse les pieds avec l’histoire des vieux et du Covid, on nous emprisonne dans l’âge. C’est très scandaleux, comme si on voulait nous voir dégager le terrain », clame-t-elle. Ce désintérêt tient peut-être à l’obsession féministe de dé-biologiser le corps pour le penser comme construction sociale. « Or la vieillesse est un temps où le biologique se rappelle cruellement au corps et à la pensée », avance Rose-Marie Lagrave.
Le tournant génital du féminisme
« Pour les féministes des années 1970, le corps des femmes était le socle de la domination masculine, il s’agissait de s’affranchir de ce carcan corporel. Les thématiques qui y étaient associées – maternité, sexualité, apparence – ont été assimilées à des vecteurs de perpétuation de la soumission des femmes. Elles ont été de ce fait déconsidérées », explique Camille Froidevaux-Metterie, qui voit dans l’intérêt actuel pour la ménopause l’ultime expression du tournant génital du féminisme – après avoir fait entrer dans le débat les règles, les violences gynécologiques et obstétricales, le clitoris et l’endométriose.
Mais si cette question a eu du mal à pénétrer l’agenda féministe, c’est aussi parce que le MLF était un mouvement de jeunes. « Beaucoup de mouvements révolutionnaires se constituent autour de clivages générationnels et, du même coup, assimilent jeunesse et transformation sociale, vieillesse et conservatisme. Parfois cela conduit les militants à nier l’héritage des générations antérieures, et à rejeter les militants plus âgés », affirme Juliette Rennes. « Des féministes qui avaient cinquante ans dans les années 1970 ont vécu de telles expériences de rejet. Les revendications du MLF étaient en outre très centrées sur une représentation implicite de femmes qui étaient en âge de procréer : avortement, contraception, partage des soins aux enfants, entrée dans la carrière… », précise-t-elle.
Force est de constater que cette coupure générationnelle n’est pas très féconde. « Longtemps, les femmes ont pu compter sur d’autres femmes, plus âgées, qui transmettaient leur savoir lié au corps… Cette chaîne s’est rompue avec l’individualisation de nos existences, mais aussi par la délégitimation des quinquagénaires comme figures connaissantes et puissantes, ce y compris dans le champ féministe », déplore Camille Froidevaux-Metterie. Avis aux jeunes sorcières : les vieilles ont plein de sortilèges à transmettre pour combattre la domination.