Une gauche conservatrice ?! Et puis quoi encore !
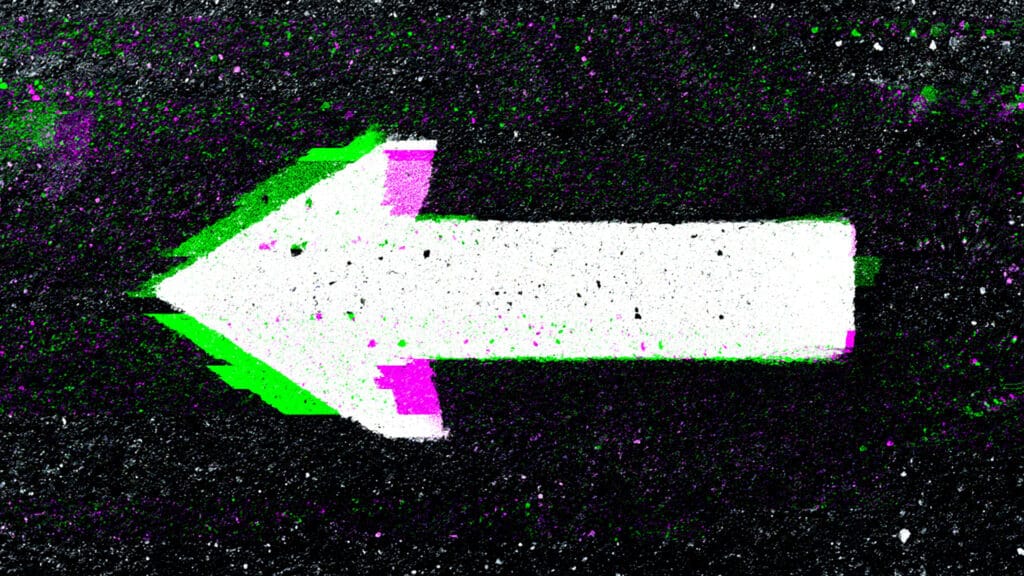
La lettre du 7 juillet 📨
par Catherine Tricot
Par une note, la fondation Jean Jaurès tente de structurer en France une force politique de gauche « post-sociétale », se différenciant de la gauche « identitariste » accusée d’être un accélérateur de l’individualisme et du libéralisme.
Comment la gauche peut-elle sortir de sa marginalité ? Comment peut-elle renouer avec le monde populaire ? Le cuisant échec de Kamala Harris aux États-Unis relance le sujet avec acuité. Depuis des mois, cette question occupe les formations politiques et alimente les réflexions (par exemple, le politiste Philippe Marlière ici et l’eurodéputée socialiste Chloé Ridel là). Il n’y a pas de semaine sans que les intellectuels y contribuent. Mais une publication de la fondation Jean Jaurès vient reformuler le débat : elle politise des idées déjà présentes dans le champ médiatico-intellectuel, notamment autour du Printemps républicain, du journal Franc-Tireur ou de lejournal.info de Laurent Joffrin.
« La troisième gauche : enquête sur le tournant post sociétal de la gauche européenne » n’est pas qu’une analyse. Elle se veut une proposition de stratégie politique. Par son ambition, elle évoque la note de Terra Nova de 2011 qui proposait au PS de délaisser la question sociale pour se centrer sur les enjeux de dominations et se tourner vers les minorités de genre, de sexe ou d’origine. Le rapport, coordonné par Renaud Large, et soutenu par une douzaine d’éclairages d’Europe ou d’Amérique, est l’exact inverse de la note Terra Nova.
Résumons la proposition : « Où que l’on regarde sur le continent, les forces politiques de gauche paraissent se tasser dans l’opinion, se réduire électoralement au point d’être menacées existentiellement ». Renaud Large rend compte des différentes tentatives politiques des 20 dernières années – sans toutefois mentionner LFI – pour constater leurs échecs ou leur épuisement : social-libéralisme de Tony Blair, altermondialisme, souverainisme de gauche en France, mouvement Occupy aux États-Unis, Podemos en Espagne, Syriza en Grèce… Pour les auteurs du rapport, « dans son ensemble, la gauche n’a pas adapté son logiciel intellectuel aux grandes transformations du monde qui ont eu lieu depuis la deuxième moitié des années 2010 » : fracture territoriale, crise climatique, crise migratoire et terrorisme. Sur ces enjeux, il est reproché à la gauche de n’avoir pas su répondre aux attentes du monde populaire. « Aucun effort n’a été fait pour réagencer un récit efficace alliant justice sociale, cohésion territoriale, identité populaire et transversalité des clivages » ; « l’écologie est devenue un épouvantail populaire, réceptacle de thèses complotistes » ; « la vision ouverte de la citoyenneté où la Nation est érigée comme un poison contre l’accueil inconditionnel des migrants ». Conclusion : « Ce refus d’affronter les réalités a laissé le champ libre à l’extrême droite, qui occupe désormais, seule, le terrain de la sécurité, de l’identité et du contrôle des frontières. En refusant de penser une alternative, la gauche a abandonné le peuple aux forces qu’elle prétendait combattre. Ce rejet interne d’une ligne républicaine, populaire et patriotique a pour conséquence une captation massive des colères par la droite radicale et identitaire. » Prenant acte de l’échec de Laurent Bouvet, fondateur du Printemps républicain, les auteurs tentent de relancer le projet.
Leurs idées méritent débat. Il n’est pas certain que le temps de la compétition électorale sera le meilleur moment. L’envie de se démarquer, quitte à outrer ses idées et disqualifier outrageusement celles des autres, pourrait prendre le dessus.
La note ouvre deux fronts de question : le fond des convictions et la stratégie sur la façon dont les questions « d’identité et d’appartenance » fonctionne dans les déterminations politiques.
Sur le fond des idées d’abord. On trouvera des ouvertures intéressantes sur l’approche décentralisée du combat écologique, au plus près des producteurs et du terrain, fondée sur des « coopératives locales, régies mutualistes, communautés énergétiques et circuits courts ».
Sur l’enjeu migratoire, les auteurs proposent d’aligner la gauche sur la « défense de l’État providence sur l’intégration des travailleurs et donc la régulation des flux migratoires ». Ils lient « accueil conditionné et devoir d’intégration, dans une optique de réconciliation entre universalité des droits et exigence de cohésion ». C’est en pratique ce que font les sociaux-démocrates danois et suédois. Aussi choquant que cela puisse paraître, cette proposition s’apparente à la préférence nationale. Sahra Wagenknecht, qui porte cette ligne en Allemagne, se dit désormais ouverte à la discussion avec l’extrême droite néonazie de l’AfD. La proposition dénie les mouvements migratoires qui s’annoncent et reste aveugle à la fragilisation extrême de l’État, qu’il soit de droit, providence ou expression du souverain : au-delà de son inefficacité, elle alimente les idées fausses sur les difficultés, en particulier celles du monde populaire.
Politiquement, la note propose « une stratégie d’apaisement des zones de clivage sur l’axe culturel et identitaire ». Disons-le : il s’agit ni plus ni moins de contourner ces sujets par la mise en avant de la question sociale. Cette idée est relayée avec bonne foi et bienveillance par les intellectuels et les politiques qui cherchent à combler le fossé entre gauche et monde populaire. Ils mettent en avant les évolutions progressistes des Français, leur attachement aux propositions redistributives et égalitaires et proposent également de remettre au centre la question sociale pour se défaire du RN. Même si, bien sûr, il est préférable que le peuple ne soit pas fascisé, il faut comprendre pourquoi il vote RN – et pas à l’insu de son plein gré. La recherche d’une explication à ce qui est perçu comme le déclin de l’Occident, de la France, la remise en cause du bien-être et des rêves d’ascension sociale… ont trouvé un explication globale et cohérente dans le discours de l’extrême droite. Contourner cet éléphant dans la pièce, ne pas offrir une vision alternative aussi forte et globale, ne permettra pas de se débarrasser de nos extrêmes droites. La proposition de troisième gauche l’esquive. Elle est non seulement peureuse mais dangereuse.
🔴 INUTILITÉ DU JOUR
Islamophobie : au PS, l’obsession sémantique d’une gauche qui doute

Le mot est désormais bien installé dans le débat public : « islamophobie » pour désigner la haine ciblée d’une religion, l’islam, et plus encore de celles et ceux qui en sont les fidèles ou les supposés fidèles. À défaut de toujours combattre ce racisme, une partie de la classe politique préfère contester… le mot. C’est ainsi qu’une frange des socialistes, hostile à la ligne incarnée par Olivier Faure, a choisi Marianne pour publier une tribune pour dire son opposition, non pas à la haine anti-musulmane, mais au mot qui la nomme. Mot qui, crime suprême à leurs yeux, a même eu l’audace de figurer dans le portefeuille d’un secrétaire national du PS. Trop « politisé ». Un scandale lexical qui, manifestement, mérite mobilisation générale. Le combat paraît pourtant dérisoire à l’heure où les agressions islamophobes explosent, où les femmes voilées sont stigmatisées jusque dans l’hémicycle et où la droite extrême impose son lexique à la République. On cherche en vain, dans ce refus du mot, dans la tribune, une pensée stratégique ; on y trouve plutôt une posture, une fracture de plus dans un parti qui hésite entre l’aggiornamento social-démocrate et le sursaut républicain de façade. Et que dire du député Jérôme Guedj ou de la sénatrice Laurence Rossignol, signataires du texte, qui n’hésitaient pas, il y a peu, à employer eux-mêmes ce terme qu’ils prétendent désormais combattre ? Faut-il y voir une conversion tardive, un oubli de plume ou l’aveu que le problème n’est pas tant le mot que la gauche qui l’emploie ?
P.P.-V.
ON VOUS RECOMMANDE…

Toute la série des fictions de France Inter. Car elles sont géniales et importantes et pourtant, vont être supprimées à la rentrée… Autant en emporte l’histoire en fait partie : des fictions historiques qui mettent en scène un personnage, connu ou pas, réel ou fictif, pris dans la tourmente d’épisodes de l’Histoire, de l’Antiquité à 1945.
C’EST CADEAU 🎁🎁🎁
ÇA SE PASSE SUR REGARDS.FR
Pour recevoir cette newsletter quotidiennement (et gratuitement) dans votre boîte mail, suivez le lien : regards.fr/newsletter !






Bonjour,
ils disent ;
– « La troisième gauche : enquête sur le tournant post sociétal de la gauche européenne »
– « Dans son ensemble, la gauche n’a pas adapté son logiciel intellectuel aux grandes transformations du monde qui ont eu lieu depuis la deuxième moitié des années 2010 »
– « Aucun effort n’a été fait pour réagencer un récit efficace alliant justice sociale, cohésion territoriale, identité populaire et transversalité des clivages »
et on se demande comment « renouer avec le monde populaire » ? Pour commencer, soit tu changes de vocabulaire, soit tu la fermes.
Est-ce que vous croyez sincèrement que des gens qui ne savent pas ce qu’est le peuple, qui ne l’ont ni vu ni approché, qui ne lui ont jamais parlé, ne l’ont jamais entendu, encore moins écouté, peuvent vraiment pondre ne serait-ce que la moindre possibilité d’une solution ?
Arrêtez de ne voir et n’écouter que le microcosme (pseudo) intellectuel ! C’est ça que demande le peuple !
Arrêtez de faire écho à ceux qui veulent nous laisser dans la merde qu’ils ont créée pour nous.
Arrêtez d’espérer qu’on puisse faire alliance avec Hollande, Caseneuve, Glucksman et autres du même acabit.
Laissez ceux qui ne font que la course aux sièges trahir le peuple qu’ils prétendent représenter et défendre.
Laissez ceux qui ont participé à la casse des services publics (éducation, santé, culture, transports, etc.) prendre leurs responsabilités, seuls.
Oubliez cette chimère de LA Gauche qui n’a jamais existé et n’existera jamais.
Prenez de la hauteur et parlez avec vos tripes, votre Regards n’en sera que plus pertinent.
Non à la vacuité des think tanks !
Non à l’union hypocrite!
Bien à vous.
PS : Kamala Harris est de gauche et je suis la reine d’Angleterre !