François Bayrou et les pièges de « l’identité française »

Le débat lancé à la suite de la remise en cause du droit du sol à Mayotte s’inscrit dans une histoire intellectuelle riche… souvent d’impasses.
François Bayrou a décidé d’ouvrir le débat sur « qu’est-ce que c’est qu’être Français ? » Officiellement, il le fait en se démarquant des positions de Gérald Darmanin qui, lui, a prétendu « que le débat public [devait] s’ouvrir sur le droit du sol dans notre pays ». En fait, Bayrou s’inscrit dans la droite ligne de Nicolas Sarkozy qui, sitôt élu en 2007, avait proposé de débattre en grand de « l’identité française ». Il s’y résout alors que la situation de Mayotte a réactivé le sentiment de « submersion migratoire » et que la crise politique a conforté la place centrale occupée par l’extrême-droite sur la scène publique française et européenne. Nul ne devrait ignorer que c’est elle qui imprègne les idées et les mots, les doutes, les angoisses et les peurs. Notre premier ministre intérimaire n’en a cure, comme s’il ne savait pas que la France pourrait bien payer un prix très lourd pour cette capitulation.
Quand Sarkozy lance son grand débat, il vient de triompher de la gauche incarnée par Ségolène Royal et il a terrassé au premier tour celui qui était parvenu au second tour de la présidentielle de 2002, Jean-Marie Le Pen. Il est persuadé d’être désormais le maître du jeu et il a le soutien d’une partie non négligeable de l’intelligentsia de droite. Pour Alain Finkielkraut, par exemple, il n’y a rien de plus important que de « sortir de l’indifférencié par l’affirmation […] de l’identité nationale ». Quant à la politiste Dominique Schnapper, spécialiste reconnue de la « nation citoyenne », elle voyait dans le regain d’attention à l’identité une réponse saine aux déboires de la construction européenne, aux désordres de la mondialisation et aux « excès de la démocratie extrême » (sic).
Sarkozy avait ouvert la voie
Or personne n’a jamais su dire, de façon claire, ce qu’était l’identité française et les conséquences que l’on pouvait en tirer. L’historien Fernand Braudel, qui a pourtant consacré trois volumes à ce qu’il titrait lui-même L’Identité de la France, confessait honnêtement que le mot « n’a cessé des années durant de [le] tourmenter ». On semblait jusqu’alors n’avoir retenu en France que la célèbre formule de Jules Michelet : « L’Angleterre est un empire, l’Allemagne un pays, une race ; la France est une personne ». La métaphore avait au moins l’avantage de ne pas faire oublier qu’une personne naît, vit et meurt… En fait, c’est moins Michelet qui a façonné les représentations ultérieures, que le grand maître de l’École française de géographie, Paul Vidal de la Blache.
Pour lui, l’enracinement dans le sol fonde l’identité du pays, en lui assurant « son caractère original d’ancienneté et de continuité » et en l’ancrant ainsi dans « des habitudes transmises et entretenues sur les lieux où elle avait pris naissance ». C’est dans cette lignée d’une identité figée et quasi naturelle que s’inscrit Finkielkraut, quand il évoque avec émotion « l’homme de la terre et des morts », Maurice Barrès, chantre inspiré du nationalisme français. On n’en est pas loin du côté du géographe Christophe Guilluy, quand celui se met à glorifier la France périphérique, au nom de la tradition immémoriale du « village ».
L’identité française n’est pourtant pas une « chose » dont il suffirait de décrire les composantes ou d’énoncer les caractères. Le terme renvoie en fait à une construction permanente, qui n’existe que comme un récit, un mythe ou une mémoire. Même la « nation citoyenne », dont on fait volontiers la grande référence depuis la Révolution, est avant tout un imaginaire, nécessairement traversé de conflits. Dès lors, où va-t-on trouver cette nation citoyenne ? Dans la conception de l’abbé Sieyès, qui ne veut surtout pas que la souveraineté nationale soit directement une souveraineté populaire ? Dans la démocratie mandataire des sans-culottes, qui se défie de la représentation ? Dans la centralité de la Convention jacobine, fondée d’abord sur la vertu des représentants ? Dans la culture républicaine des « opportunistes » et des « radicaux », qui fait du canon républicain et de l’exaltation des classes moyennes l’antidote à la lutte des classes ? Dans une logique bonapartiste, qui veut concilier l’héritage de 1789, la rigoureuse centralisation monarchique et une incarnation du pouvoir supposée plus efficace que la médiation traditionnelle des notables ?
En 2007-2008, le projet de Nicolas Sarkozy fonctionnait comme une machine à produire un consensus effaçant d’un même mouvement les cultures de classe et le dualisme de la droite et de la gauche. Il voulait donc, déjà, raccorder la droite parlementaire et l’extrême-droite autour de la peur du chaos culturel et de l’identité menacée. C’était au fond une manière de dire qu’il fallait choisir entre l’intégration vertueuse par l’ordre et la tradition d’un côté et, de l’autre côté, l’éparpillement culturel et le creuset des cultures, source de faiblesse et de déclin national. Parler de l’identité française, c’était chez lui introduire et imposer une vision plus présentable et plus populaire de l’identité excluante et de la peur de ne plus être chez soi.
Le président bling-bling a échoué et son « ministère de l’identité nationale » est heureusement mort-né. Mais, des décombres de son projet de débat national, est sortie une poussée plus forte encore de l’extrême-droite. Comment s’en étonner ? Alors qu’il n’était encore que ministre de l’Intérieur de Jacques Chirac, Sarkozy n’avait pas hésité à lancer une de ces saillies dont il avait le secret : « S’il y en a que ça gêne d’être en France, je le dis avec le sourire mais avec fermeté, qu’ils ne se gênent pas pour quitter un pays qu’ils n’aiment pas ». Être français aujourd’hui, c’est « aimer la France », déclare en écho Manuel Valls, premier ministre en novembre 2015. Aimer ou s’en aller…
Alors que commence un nouveau millénaire, on continue en France de se gargariser de la grande nation ouverte et, en pratique, on ne pense qu’à tracer la limite qui sépare le bon grain de l’ivraie, le bon Français de l’ingrat qui ne sait pas respecter sa terre d’accueil. On se plaît à célébrer l’universalisme français et l’on s’empresse de dresser les murs qui repoussent ceux qui n’en sont pas dignes, parce qu’ils viennent d’ailleurs et qu’ils ne sont même pas européens. Le confusionnisme qui fait partie de l’air du temps est alors en marche. Depuis, il ne fait que s’épaissir.
Être français
Était-il besoin d’un nouveau grand débat national, pour savoir ce que c’est qu’être français ? Pour la puissance publique, il suffirait en fait de s’en tenir à la loi.
La définition juridique a le mérite de la simplicité. Est Français tout individu qui peut attester de la nationalité de ce pays, certifiée par des papiers d’identité. Cette nationalité relève du droit du sang (un parent au moins de nationalité française) ou du droit du sol, automatique à la majorité (un enfant né en France de parents étrangers et qui réside en France depuis au moins cinq ans depuis l’âge de 11 ans) ou sous conditions par naturalisation ou par mariage. Au fil des années, des avancées et des reculs, ces conditions se sont faites plus ou moins restrictives, mais elles n’empêchent pas que la double tradition du sol (la plus ancienne, puisqu’elle remonte au Moyen-Âge) et du sang (institutionnalisée par la Révolution et le Code civil) soit une composante à part entière de la conception française de la nationalité.
Tout individu qui dispose par naissance de la nationalité française et qui choisit de résider en France accepte de facto de partager une histoire, matérielle, culturelle et affective, et de participer à une vie commune encadrée par la loi. Tout individu qui acquiert la nationalité française accepte explicitement les conditions de cette acquisition et se trouve soumis lui aussi à l’obligation de respecter la loi, sans qu’il soit besoin de le contrôler plus que toute autre personne vivant sur le territoire national, de nationalité française ou non. Quant à l’étranger qui réside en France, il respecte la loi commune, est protégé à la fois par l’État français et par la représentation de son pays d’origine (s’il a la binationalité) et il dispose des mêmes droits que les nationaux, en dehors pour l’instant, du droit de vote (hors élection européenne). En bref, nul n’est censé ignorer la loi et nul, pour ses origines, ne peut être suspecté a priori de ne pas vouloir la respecter.
Au-delà, tout relève du choix des individus : la profondeur du sentiment national (la fierté plus ou moins grande de l’appartenance à la nation), le patriotisme (qui fait de la nation un territoire patrimonial chargé d’affectivité, pour lequel on peut consentir des sacrifices afin de garantir son intégrité), voire le nationalisme (qui fait de la nation une communauté supérieure qui surplombe toutes les appartenances, religieuses, philosophiques ou de classe).
Il n’y a pas plus de bon et de mauvais Français qu’il n’y a de bon et de mauvais étranger. En dehors du respect de la loi, du patrimoine commun et des normes civiles de la vie commune (la liberté de chaque individu est bornée par la liberté de tous les autres), rien ne peut distinguer légalement les individus résidant sur le territoire national. Les particularités de langue, de religion, de coutumes et de culture doivent donc être respectées et tenues pour des enrichissements de la culture commune qui peut être celle de tous les résidents, sans distinction entre eux.
Ces particularités peuvent même être encouragées, dès l’instant où elles ne contreviennent pas aux droits de la personne et n’instituent pas, en normes obligatoires, les discriminations fondées sur le genre, l’origine, la religion ou la conviction politique. Il est vrai que, au regard du respect de la vie commune, le monoculturalisme (la norme commune est celle du groupe majoritaire) est tout aussi pernicieux qu’une conception contraignante du multiculturalisme (les individus sont distribués en communautés délimitées par leur culture).
La nation est une communauté imaginée, après d’autres (les principautés féodales et les Empires) et avant d’autres (les regroupements transnationaux). Celle de la France est le fruit d’une longue histoire, marquée par les guerres, les conflits internes, les équilibres entre groupes dominants (aristocratie ou bourgeoisie) et entre dominants et dominés (paysans, puis ouvriers). Elle est le fruit des tensions entre les idéologies, religieuses ou non, entre les tentations de la centralisation et celle de la dispersion. Après les Lumières, elle est devenue le territoire par excellence des droits de l’Homme, de la laïcité, de la République, étroitement bourgeoise ou ouvertement démocratique et sociale. Choisir d’être français signifie s’inscrire librement dans cette histoire populaire complexe.
La France a ainsi son originalité dans le concert des nations, sans être pour autant un modèle simple et indépassable, que l’on peut copier à l’infini. Trop diverse pour se réduire à une dimension unique… N’a-t-elle pas été à la fois la terre de la Révolution et celle de la domination coloniale, la France de la Déclaration de 1789 et celle de Jules Ferry affirmant que les « races supérieures » avaient le droit de dominer les « races inférieures », celle des antisémites de principe et celle des dreyfusards, celle de la Commune de Paris et celle de la France de Vichy ?
Dans cette France foisonnante, on peut penser que la paix civile suppose le respect des spécificités. Il est légitime de comprendre la demande de pleine reconnaissance des cultures régionales, la volonté des populations dites issues de l’immigration d’être tenues pour des composantes en tant que telles de la culture française. Il est inimaginable d’expliquer, comme l’a fait le politique comme Laurent Bouvet, que la cause de l’insécurité culturelle est avant tout due au désir des minorités d’affirmer leur façon d’être dans la cité et à leur refus de se fondre dans la norme réputée commune.
Ce n’est pas pour autant qu’il faut s’abandonner aux vertiges d’un communautarisme qui fait de la différence la base de la protection des spécificités. La spécificité n’implique pas la différence. La société ne se réduit à la séparation inexorable du eux et du nous. L’imposition des normes de la majorité – naturellement blanche – est donc tout aussi dommageable, pour l’autonomie des personnes, que le repli sur la communauté plus étroite, d’autant plus refermée sur elle-même qu’elle semble être la seule protection possible des minorités discriminées.
Ce qui doit être au cœur du pacte national et républicain n’est ni la soumission aux normes du plus grand nombre, ni la juxtaposition des identités et des communautarismes, majoritaires comme minoritaires. Pour fonder les bases du vivre-ensemble, il n’y a pas d’autre possibilité réaliste que le libre choix des appartenances, entre des individus qui devraient être, dans un même mouvement, pleinement autonomes et solidaires de tous les autres. En cela, le droit à la libre identification est incompatible avec l’assignation des individus à des identités préétablies.
Le risque des dérives
On peut craindre le pire du processus engagé par François Bayrou. Au lieu de produire du commun, il risque de multiplier les clôtures. Au lieu de réduire les inégalités, il les creusera un peu plus en légitimant les discriminations, avant tout au détriment de celles et ceux que leurs origines plus ou moins lointaines et leur culture de départ vouent à rester à l’écart de l’identité française supposée.
Il ne faut pas sous-estimer en effet que l’extrême-droite abordera ce débat avec sa cohérence, qui associe l’inquiétude devant un monde dangereux, la peur des arrivées que multiplieront les désordres dus aux dérèglements climatiques et à l’instabilité du monde, le refus lancinant et le mépris de l’autre, l’obsession de la protection par la frontière et l’angoisse du déclassement provoqué par la pression des assistés, surtout ceux que l’on considérait autrefois comme des indigènes de couleur. Alors, la relégation des populations dites à risque et le confinement de l’étranger au profit du natif deviendront des recours tenus pour réalistes, face au déclin supposé.
Ce réalisme de l’inégalité n’en est pas un. Nous n’avons qu’un monde et seuls le partage et la communauté de destin assumée sont à même de pouvoir assurer la survie de notre commune humanité, contre toutes les folies des Trump et de leurs riches consorts. À tourner le dos à cette idée de bon sens, la France ne conforterait rien de sa spécificité ; elle y perdra en revanche de sa créativité et de son attractivité.
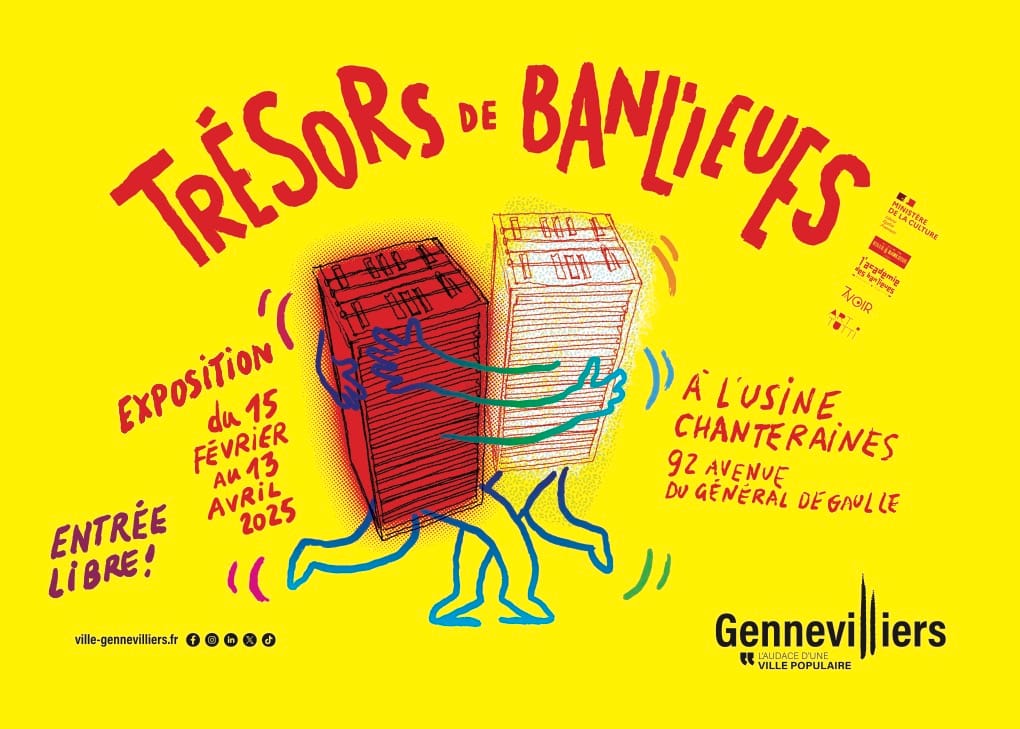




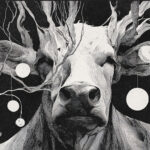

En fait, au bout du raisonnement, on trouve les stateless people (définition UNHCR)
Comment garder des OQTF non expulsables ? comme des untermensch !
Bayrou est probablement en train d’ouvrir (en toute conscience) cette fenêtre d’Overton en France.