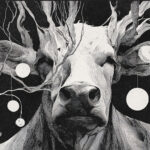Festival de Cannes : art politique et langage vivant

Le cinéma est un creuset des bouillonnements du monde, à la fois dedans et mis à distance. En 2025, il est toujours aussi nécessaire.
Le cinéma est un art qui résonne mondialement ; ses protagonistes ont une idée de leur impact et parfois s’en servent. On se souvient bien sûr que ce sont les actrices américaines qui ont levé le voile sur un système de domination sexuelle, violent, imposé au corps des femmes. #MeToo est parti d’elles et est devenu une révolution planétaire qui ne cesse de s’étendre.
TOUS LES JOURS, RETROUVEZ L’ESSENTIEL DE L’ACTU POLITIQUE DANS NOTRE NEWSLETTER
Ce surgissement venu de l’intérieur d’Hollywood a révélé le cœur battant du cinéma : ce n’est pas seulement une industrie ou un art, c’est un espace traversé par les conflits sociaux, les rapports de domination, les récits hégémoniques. Et parfois, les artistes reprennent la main. Ils arrachent la parole aux figures imposées, renversent le dispositif. On ne filme plus « comme avant », après #MeToo, pas seulement parce qu’on a changé de sujets, mais parce que le regard, la mise en scène, la place du corps dans le cadre prend sens : la « fausse naïveté » n’est plus de mise.
Le Festival de Cannes reste cette caisse de résonance pour un monde qui invente et qui lutte. Le milieu du cinéma français n’est pas un idéal. Mais il est aussi marqué par des engagements d’acteurs et d’actrices, de réalisatrices et réalisateurs, de scénaristes, de monteurs et monteuses, de producteurs et productrices. Cette culture qui est celle d’une éthique vis-à-vis du monde et du public s’est fait entendre à Cannes au travers des prises de position de la présidente du jury de la sélection officielle Juliette Binoche, des choix de programmation, des exigences au sujet des violences sexuelles et sexistes, des hommages qui y sont rendu comme cette année au grand Robert De Niro, loquace comme jamais sur ce qui arrive à son Amérique.
Ce qui s’exprime cette année, c’est aussi un refus du silence. L’hommage rendu à la jeune photojournaliste palestinienne Fatima Hassouna, morte sous les bombardements israéliens à Gaza, au travers la présentation saluée largement du documentaire « Put your soul on your hand and walk », tranche avec la cérémonie des Oscars 2025 à Los Angeles, mutique face aux guerres et au désordre du monde, dont celle qui sévit depuis Trump. Le cinéma, ici, ne dit pas « regardez », il dit « vous ne pouvez plus ne pas voir ».
L’impact de Cannes se mesure souvent dans son palmarès. Cette année, il s’affirme dès son ouverture hors compétition : « Partir un jour » est un premier film qui s’inscrit dans la suite des nombreux et récents films audacieux, inventifs, qui racontent notre pays qui tient debout, en ville comme à la campagne. Les films de Cannes, des diverses sélections qui y sont présentées, dessinent un récit mondial. Et ils ne le font pas seulement par leur sujet, mais par leur forme.
La France reste un pays de cinéma par son enseignement dès le lycée, par la large diffusion de ces œuvres et par son mode de financement. Le CNC menacé doit être préservé. Canal + doit maintenir son engagement dans le financement des films. Le rôle du Festival de Cannes pour tenir haut cette culture est décisif. Il montre aussi que la France peut avoir de l’influence à l’échelle internationale. Le cinéma est une grande affaire politique.
Et c’est là un point essentiel : ce qui fait la vitalité d’un art, ce n’est pas seulement son audience et son box-office. Ce qui compte, c’est la liberté laissée à celles et ceux qui créent. C’est la possibilité de dire autrement, de filmer autrement, de penser autrement. C’est plonger dans l’histoire de l’art, dans l’histoire même du cinéma – de ses formes, de ses ruptures, de ses inventions. Revisiter ce que fut le montage soviétique, la lumière chez Sirk, le plan-séquence chez Akerman, le silence chez Bresson, le cadre chez Varda, ce n’est pas une affaire de musée : c’est une manière de comprendre le monde, et de s’y inscrire. C’est parfois une raison suffisante pour faire un film. Interroger cette histoire, c’est interroger notre capacité à voir autrement. La force du cinéma, c’est sa capacité à ouvrir des brèches dans l’imaginaire dominant. Même quand ces brèches n’attirent pas les foules. Mais elles existent, elles nourrissent.
Faire du cinéma, ce n’est pas seulement raconter des histoires : c’est une façon d’hériter, de critiquer, de bifurquer. La liberté des artistes et leur puissance de création ne se mesurent pas à l’aune de leur succès. Il faut de tout pour faire le cinéma.