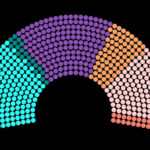Comment enseigner la laïcité sans tomber dans les caricatures ?
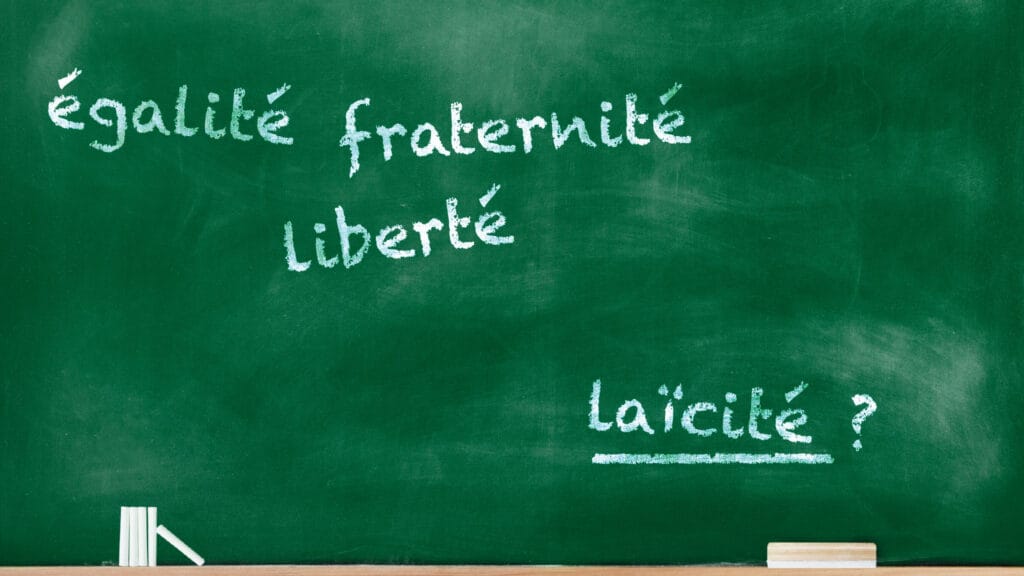
Sommés d’inculquer les « valeurs de la République » à leurs élèves, les enseignants restent livrés à eux-mêmes et à des situations complexes. Mais le débat a bel et bien lieu dans les classes, expliquent Françoise Lantheaume et Christophe Naudin.
***
Cet article est extrait du n°55 de la revue Regards, publié au deuxième semestre 2021 et toujours disponible dans notre boutique !
***
Françoise Lantheaume est professeure des universités en sciences de l’éducation et de la formation à l’université Lumière Lyon-2.
Christophe Naudin est historien professeur d’histoire-géographie au collège.
E n octobre 2020, Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine, a été décapité en pleine rue, peu de temps après avoir présenté à ses élèves des caricatures de Charlie Hebdo dans le cadre d’un cours sur la liberté d’expression. Un événement tragique qui vient réactiver les puissantes attentes pesant sur l’école française, dont la mission historique consiste à former des citoyens.
Selon une enquête de l’Ifop, les enseignants ressentiraient une montée de la contestation des valeurs républicaines en milieu scolaire. Qu’en pensez-vous ?
Christophe Naudin. Après l’assassinat de Samuel Paty, on nous a demandé de transmettre à nos élèves des valeurs de la République qui ne sont jamais précisément définies par notre ministre. Ce sont bien sûr la liberté, l’égalité et la fraternité. Mais on y ajoute souvent la laïcité, alors que c’est un principe et non une valeur, que l’on associe à la liberté d’expression sans que les deux soient forcément liées. Dans mon collège, très mixte socialement, nous avons choisi d’écouter les élèves, ce qu’ils avaient envie de dire sur cet événement tragique et ce qu’ils pensaient de la satire vis-à-vis de la religion. Nous n’avons assisté à aucune contestation ni provocation dans le cadre de cet hommage. Juste un sentiment de choc. Et beaucoup de réactions de curiosité chez les élèves les moins passifs. J’ai cependant constaté une évolution au fil des ans : les élèves ont parfois du mal à accepter qu’on puisse critiquer une religion qu’ils placent du côté de l’intime. Mais ils ne refusent pas l’échange. Autour de l’assassinat de Samuel Paty, de l’attentat contre Charlie Hebdo comme lors des enseignements habituels, la plupart sont friands de discussions. Je n’ai jamais vu de collégiens se braquer complètement.
Françoise Lantheaume. Les questions posées par le sondage de l’Ifop sont orientées et les résultats ne sont pas congruents avec les autres données dont nous disposons. Une étude réalisée par le Centre national d’étude des systèmes scolaires (Cnesco) montre au contraire que les élèves adhèrent très majoritairement aux valeurs de la République. C’est aussi ce qui ressort de l’enquête que je conduis depuis cinq ans sur les religions, les discriminations et le racisme en milieu scolaire. Au collège et au lycée, les élèves sont très curieux, intéressés par ces questions. Nous n’avons pas constaté d’opposition auxdites valeurs de la République – non seulement floues, mais aussi interprétées de différentes façons selon les politiques et les enseignants.
On a souvent entendu que les enseignants s’autocensureraient. Ne sont-ils pas désarmés, plutôt ?
Christophe Naudin. Je n’ai jamais rencontré d’autocensure chez des collègues. Moi-même, je n’hésite pas à montrer en classe les caricatures de Charlie Hebdo – mais, évidemment, en les comparant avec d’autres caricatures. Le problème est qu’on nous en demande trop. On veut que l’école transmette les valeurs de la République et, en même temps, on incrimine les enseignants lorsque des jeunes basculent dans le terrorisme. Et nous devons nous débrouiller avec ça. Même si les rectorats ont mis des outils intéressants à notre disposition, nous sommes dans le flou. Nous nous sommes rendu compte, en faisant un petit sondage dans mon collège, de la méconnaissance de beaucoup d’enseignants d’autres disciplines que la mienne, qui sont cependant avides d’échanges et d’informations. Par exemple, une jeune collègue de SVT était embêtée car elle n’était pas sûre de savoir réagir aux questions que peuvent susciter ses cours sur l’évolution et la reproduction. C’est compliqué, aussi, parce que nous nous sentons instrumentalisés politiquement par un ministère qui attend de nous que nous distillions une sorte de catéchisme républicain. Une enquête récente indique que les élèves auraient une vision dite « à l’anglo-saxonne » de la laïcité. Ils seraient très tolérants par rapport à la religion, ce qui a donné lieu à des commentaires acrimonieux contre les enseignants, accusés de ne pas faire leur travail. Notre rôle est de transmettre des notions comme la liberté de conscience et la neutralité de l’État, qui sont au fondement de la laïcité.
« Je m’interroge sur l’obsession française de montrer des caricatures de Mahomet, comme si c’était l’alpha et l’oméga du bon enseignement des valeurs de la République. »
Françoise Lantheaume
Françoise Lantheaume. Selon la discipline enseignée, les professeurs sont plus ou moins à l’aise avec ces questions. En histoire-géographie, ils sont investis d’une mission qu’ils maîtrisent. Ce n’est pas forcément le cas des professeurs de maths, par exemple. Et la tâche est plus difficile pour quelqu’un qui débute dans le métier, plus susceptible d’être « bizuté » par les collégiens sur une question qu’ils savent sensible, qui manque de ressources pour réagir quand il n’existe pas de collectif enseignant sur lequel s’appuyer, et qui exerce dans un établissement où il n’y a pas de mixité sociale ou culturelle. Entre parenthèses, je m’interroge sur l’obsession française de montrer des caricatures de Mahomet, comme si c’était l’alpha et l’oméga du bon enseignement des valeurs de la République. Cela me semble absurde ! Quant à la montée d’une conception plus libérale de la laïcité, c’est un fait de société. La conception et la pratique des religions et de leur coexistence entre elles, ainsi qu’avec l’agnosticisme ou l’athéisme, ont évolué dans toutes les sociétés démocratiques vers un sens libéral, assorti d’une demande de reconnaissance. Les enseignants prennent appui sur ce mouvement pour amener les élèves à une conception inclusive de la laïcité.
Christophe Naudin. J’ai montré des caricatures après l’attentat contre Charlie Hebdo, mais je ne me sens pas obligé de le faire tous les ans. Là encore, une injonction pèse sur nous, a fortiori depuis l’assassinat de Samuel Paty. C’était dit quasiment mot pour mot par le gouvernement et les médias : nous avions presque le devoir de les afficher, à commencer par celle sur laquelle avait travaillé notre confrère. Cela n’a aucun intérêt pédagogique. Quand je travaille sur de telles images, je ne les présente jamais hors contexte. J’essaye de les inscrire dans une histoire des caricatures depuis la fin de la Révolution, au XIXe siècle autour de l’affaire Dreyfus, au détour de la loi de 1905 sur la séparation de l’Église et de l’État…
Depuis la Révolution française, on demande à l’école d’asseoir ou de sauver la République… Ce n’est donc pas une nouveauté ?
Christophe Naudin. La différence, depuis quelques années, est le retour de la question de la laïcité dans la sphère politique et médiatique. Il engendre une confusion, dans la tête de nos élèves, entre ce qu’on leur apprend et ce qu’ils entendent par ailleurs. Beaucoup de collégiens musulmans voient la laïcité comme anti-musulmane, ou plus largement antireligieuse.
« Si le débat est cadré et ne part pas dans tous les sens, ils apprennent à écouter l’autre, argumenter, mettre en forme leurs idées, accepter que nous ne soyons pas tous d’accord. »
Christophe Naudin
Françoise Lantheaume. Avant l’affaire de Creil [en 1989, trois collégiennes sont exclues pour avoir refusé d’enlever leur voile en classe], la laïcité ne faisait pas l’objet d’un apprentissage spécifique dans les établissements scolaires. Le retour de cette question est associé au projet d’un islam politique, lequel a imprégné le discours institutionnel sur la laïcité d’une méfiance qui s’est parfois élargie à l’islam tout entier. À tel point que l’on retrouve aujourd’hui chez certains enseignants – les plus perméables au discours public et les moins formés – l’idée qu’une élève qui porte le voile dans la rue porte atteinte à la laïcité. Quant aux élèves qui ne seraient pas d’accord avec ce principe, c’est leur droit ! Le rôle de l’école est de les amener à comprendre et intégrer ce principe qu’ils connaissent très mal. Ils n’arrivent pas à l’école avec tous les codes, toutes les connaissances. Et être dans la provocation, cela correspond à leur âge. Toute la question est d’en débattre, de mener un travail pédagogique comme celui que mènent les enseignants.
Au-delà de la transmission de contenus, quel rôle joue l’expérience du débat dans la formation à la citoyenneté ?
Christophe Naudin. Les élèves ne demandent que ça, de débattre ! De plus en plus, ils nous demandent quand on va faire de l’EMC, cette éducation morale et civique qui est souvent le parent pauvre de notre enseignement, même si tous les professeurs sont censés en faire. Les collégiens attendent la séance sur les discriminations en cinquième ou sur la liberté en quatrième. Si le débat est cadré et ne part pas dans tous les sens, ils apprennent à écouter l’autre, argumenter, mettre en forme leurs idées, accepter que nous ne soyons pas tous d’accord, à critiquer certains concepts.
Françoise Lantheaume. Le programme de l’EMC a évolué. Au début, il était fondé sur le débat. Aujourd’hui, la conception de cet enseignement est beaucoup plus normative, assertive. Ce qui n’empêche pas les enseignants de mettre en place des dispositifs pour déconstruire les stéréotypes des élèves, en partant de leur parole afin de savoir d’abord ce qu’ils ont dans la tête. Pour cela, ils ne s’appuient pas sur les discours publics, mais sur leur discipline – les SVT, la philosophie, les lettres ou l’histoire. La difficulté à laquelle sont confrontés les enseignants est que débattre n’est pas du tout naturel hors des couches moyennes éduquées, des milieux populaires politisés, syndiqués, militants. Tout centrer sur le débat peut mettre en difficulté des élèves qui n’ont pas les outils intellectuels et langagiers pour construire les argumentaires.
Les formations délivrées aux enseignants sont-elles trop théoriques ?
Christophe Naudin. Il faut déjà se battre pour obtenir une formation théorique sur la laïcité, alors ne parlons pas des stages de mise en pratique… Il y a là une grosse lacune. Le passage au concret est pourtant compliqué, y compris pour des enseignants armés intellectuellement.
Françoise Lantheaume. Quand on demande aux professeurs ce qu’ils attendent d’une formation à la laïcité, ils répondent qu’ils aimeraient travailler sur des situations locales, des cas précis. Dans les métiers de relation à autrui, les compétences « prudentielles », qui reposent sur la délibération, permettent de trouver les meilleures solutions. Les enseignants manquent d’espaces-temps pour échanger sur les cas humains, concrets, qui sont toujours complexes. Il ne suffit pas de mettre sur un tableau Excel un élève X en relation avec une solution Y pour que ça marche.
La question de la formation citoyenne prend tellement de place qu’elle finit par occulter celle des inégalitaires scolaires. Ne faut-il pas penser les deux ensemble ?
Françoise Lantheaume. Les politiques publiques devraient le faire. Quand on ne met pas en place les conditions d’une mixité sociale à l’école, il ne faut pas s’étonner que dans les établissements les plus homogènes, on rencontre des problèmes liés à la religion – quelle qu’elle soit. Les enseignants sont confrontés à une contradiction, que ressentent les élèves, entre les valeurs de la République et leur expérience sociale. Comment leur parler d’égalité alors qu’ils font l’expérience permanente des inégalités ? Les discours sur les valeurs de la République télescopent les conditions de vie de certains élèves qui sont dans la pauvreté.
Christophe Naudin. Parfois, on a l’impression que les injonctions sur les valeurs de la République servent de paravent. On nous dit que nous devons former des citoyens qui vont respecter ces valeurs, et ainsi on évite de parler des inégalités sociales.