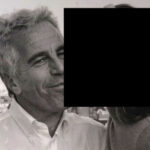Dans Les nomades face à la guerre, Lise Foisneau met à jour la violence de la politique de l’État contre les nomades via leur assignation à résidence. Une réalité effroyable jusqu’à présent méconnue.
Peu d’historiens ont étudié le sort des nomades, en France, durant la Seconde Guerre mondiale. Et les travaux menés depuis les années 1980 se sont focalisés sur un aspect de la répression : leur internement dans des camps. Éthnologue chargée de recherche au CNRS, Lise Foisneau élargit la focale : elle s’intéresse aux mesures de surveillance et de contrôle prises par l’État avant même le vote des pleins pouvoirs à Pétain, jusqu’à la situation d’après-guerre ; et surtout elle s’attache à la résistance des nomades face à l’inflation bureaucratique et répressive.
Depuis la loi du 16 juillet 1912 existaient en France des statuts différents pour trois catégories d’individus exerçant des professions ambulantes : les marchands ambulants, les forains et les nomades. Entre autres contraintes bureaucratiques, les nomades devaient posséder un carnet anthropométrique individuel et faire systématiquement viser leurs arrivées et départs dans les communes. Ainsi, la discrimination des nomades n’est pas un phénomène nouveau lorsque la guerre commence.
Cependant, le 6 avril 1940, un décret vient bouleverser le mode de vie des nomades en interdisant leur circulation et en les assignant à résidence. L’État prétexte que leurs déplacements incessants leur permettraient de recueillir de nombreux et importants renseignements – « pour la Défense nationale un danger très sérieux » ! Quand elles ne sont pas internées dans des camps, les familles se trouvent ainsi rattachées au territoire d’une commune ou d’un canton, sous la surveillance de la brigade de gendarmerie locale, soumises au couvre-feu, dans l’impossibilité de pratiquer leurs métiers ambulants. Il s’ensuit des conditions sociales et sanitaires dramatiques.
Pour Lise Foisneau, on est là au cœur d’un processus de « déshumanisation », puisque l’État contraint, sous peine de lourdes sanctions, une population à renoncer à sa manière d’être au monde. De plus, mettant en œuvre en réalité une politique raciste (sous couvert des indices que seraient les modes de vie, le manque de « morale » ou encore des « caractéristiques ethniques » particulières), il n’a prévu aucun moyen. Les nomades développent seuls des stratégies de survie, dans le climat difficile de l’Occupation allemande. Aiguillonnées par la politique pétainiste, les populations voisines des lieux d’assignation sont souvent hostiles… et parfois solidaires.
Lise Foisneau révèle à la fois le régime spécifique subi par les nomades pendant la guerre et la continuité de la politique répressive à leur égard. Une histoire française avec laquelle il reste, si l’on peut dire, beaucoup de comptes à régler.
La méthode de l’autrice a combiné de nombreux entretiens auprès des derniers témoins vivants de la Seconde Guerre mondiale et l’exploration de multiples fonds d’archives. Grâce à un travail mené sur plusieurs années, on trouve tout au long du récit de nombreux exemples concrets, témoignant du processus de contrôle et de déstructuration du monde du voyage. On trouve aussi – et c’est la force de l’ouvrage, à travers la mémoire des premiers concernés – un riche aperçu des pratiques de résistance mises en œuvre par les nomades. Pour échapper à l’assignation à résidence ou à l’internement, ils multiplièrent les démarches (rapidement empêchées) pour obtenir le statut de forain, achetèrent des maisons et se marièrent en mairie. Pour survivre, ce fut la circulation contrevenant à l’assignation, l’usage de fausses données d’état civil ou encore la débrouille pour l’obtention de bons d’alimentation. Enfin, Lise Foisneau évoque la participation de nomades à des actions de résistance contre l’Occupant, dont certains subirent les conséquences (internement pour des raisons politiques, déportation, représailles, exécutions).
L’intention politique, ou le fantasme, d’en finir avec le nomadisme s’est matérialisée dans la période pétainiste. Mais elle continue jusqu’en juillet 1946, puisqu’après la Libération le pouvoir gaulliste poursuit dans un premier temps la politique de sédentarisation forcée des nomades. Le décret d’avril 1940 est ensuite abrogé et… l’on revient au système discriminatoire d’avant-guerre. Le grand mérite de l’ouvrage de Lise Foisneau est ainsi de révéler à la fois le régime spécifique subi par les nomades pendant la guerre et la continuité de la politique répressive à leur égard. Une histoire française avec laquelle il reste, si l’on peut dire, beaucoup de comptes à régler.