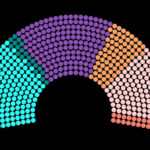« L’amour à la française est devenu dans le discours politique un marqueur de l’identité française »

Avec ou sans Valentin ou Valentine, ce soir il faut regarder l’excellent documentaire en trois épisodes « L’Amour à la française », sur France 3. Les réalisateurs de « Histoire d’une nation », Françoise Davisse et Carl Aderhold, reviennent cette fois-ci sur l’évolution de nos rapports à l’amour, la sexualité, au consentement, à la séduction. Ils retracent deux siècles d’une histoire d’amour à la française. Ils sont les invités de #LaMidinale.
UNE MIDINALE À VOIR…
ET À LIRE…
Sur l’amour et l’égalité
« Notre fil directeur, c’est la question de l’égalité ».
« On a voulu raconter ce pays à partir d’une question qu’on considère ahistorique. Ça n’est pas rien, c’est une affaire d’Etat en France. »
« Il y a une espèce de fierté française, une sorte d’amour à la française, qui est devenue ces dernières années dans le discours politique un marqueur de l’identité française. »
« L’amour à la française repose sur une domination masculine. »
« Toute l’évolution du combat des femmes a permis de faire bouger cet amour à la française et le remettre en question pour en faire quelque chose d’un peu plus égalitaire. »
« Dès que les femmes franchissent une nouvelle étape de leur émancipation, il y a une crise de la virilité. »
Sur les arts dans nos rapports à l’amour
« L’histoire d’amour à la française n’est pas à sens unique. Il n’y a pas une puissance dominante qui déciderait de tout, il y a aussi l’ensemble des expressions culturelles qui font bouger les normes. »
« Le romantisme est l’expression des jeunes bourgeois (…). Balzac dit : « Ne commencez pas le mariage par un viol ». »
« Dans le deuxième épisode de la série, on raconte le match Pagnol/Prévert (…). Le « t’as de beaux yeux tu sais » de Prévert est très important dans notre histoire. »
« L’idée que quand on embrasse une femme, elle tombe amoureuse – l’histoire du baisé forcé – est encore présente dans un film sur trois. »
Sur Darmanin face à Malherbe
« Quand on regarde sur un plan historique, il y a une construction culturelle : aux hommes la raison, l’intelligence et la maîtrise des sentiments. Aux femmes, les débordements, les émotions. Elles sont forcément historiques. Et il y a ce regard-là que Darmanin véhicule. »
« La construction de l’amour a été une bagarre de deux siècles. »
« La science est partie prenante. Il y a des médecins qui analysent les cerveaux féminins. Il y a des grands débats au 19è siècle – alors qu’on est en pleine théorie des races – pour savoir si le cerveau des femmes est supérieur ou pas à la race noir. »
Sur sexualité et crises ou prospérité économique
« La Belle époque est un moment où les femmes travaillent – elles travaillent même plus qu’après – et va provoquer une grande crise de la virilité. »
« Dès qu’il y a un peu une émancipation des femmes, il y a une crise de la virilité. »
« La crise des années 30 est très rude pour les femmes. »
« Ce ne sont pas toujours les périodes de prospérité qui sont des périodes d’amélioration. Les Trente Glorieuses sont plutôt une catastrophe pour le couple. »
« Avant, la double-vie, c’était d’avoir un amant. La double vie des années 60 c’est d’aller travailler et de s’occuper de la famille. »
Sur la crise sanitaire et les comportements amoureux
« La fin des années 70 et le début des années 80 sont ce que nos témoins appellent une parenthèse heureuse. Ça ne touche pas tout le monde mais ça touche beaucoup de monde : on le sent dans les chansons notamment. Et personne n’imagine qu’on va revenir en arrière. Ça va être stoppé par deux choses : la crise économique et le Sida. Il va y avoir un retour en arrière moral. »
« Je ne sais pas ce que va provoquer la pandémie mais on a une génération de jeunes qui pendant deux/trois ans, n’ont pas fait de fête, n’ont pas eu de vie ensemble, tout ce qui se fait à cet âge là : il faut être attentif à ça. C’est angoissant. D’autant qu’on s’est aperçu d’une chose, c’est que c’est beaucoup la jeunesse qui permet de faire bouger notre rapport à l’amour. On l’a vu avec #MeToo. »
« Les jeunes font moins l’amour que les générations précédentes. »
« Les relations sexuelles sont moins au centre que pour les générations précédentes. »
Sur les mouvements homosexuels
« Les homosexuels, pendant longtemps, ne peuvent pas imaginer la vie en couple, ils sont interdits de vie en couple. »
« Qu’est-ce que le couple quand on est interdit de couple ? On invente. »
« Le mot homosexualité s’invente deux ans avant le mot hétérosexualité. Il s’invente pour le combattre et pour en faire une maladie mais ce mot, hétérosexualité, intervient pour définir quelque chose qui ne serait pas homosexualité. »
« Le rôle des Etats-Unis sur l’amour est plutôt bénéfique. »
« Quand on fait un film sur l’amour, on fait généralement un film sur l’hétérosexualité et l’homosexualité intervint en périphérie. À travers ce documentaire, on s’est aperçu qu’à chaque fois que la condition féminine s’améliore, c’est bon pour les homosexuels. Et inversement, à chaque fois que la situation des homosexuels s’améliore, c’est bon pour les femmes. »
Sur la puissance masculine
« La question de la puissance masculine et des gros besoins est une question de hiérarchie entre les hommes. »
« L’homme puissant au 19è siècle, c’est l’homme bourgeois. Il a les femmes du peuple. Contrairement aux hommes ouvriers, le tiers des femmes ouvrières – qui sont en ménage – sont avec des commerçants ou d’autres hommes plus hauts dans la hiérarchie sociale. »
Sur le rapport amoureux à l’heure des réseaux sociaux
« Il y a à la fois une forme de triomphe du capitalisme dans ces usages des réseaux sociaux, applications de rencontre, mais on a aussi entendu que c’était une manière plus facile de faire le premier pas et de sortir un peu plus de son milieu social. »
« On va plus du côté du triomphe du capitalisme et de la marchandisation des rapports mais je pense que les gens prennent la chose en main et en font quelque chose d’autre. »
« Il y a les réseaux sociaux qui sont une révolution mais la vraie révolution, c’est #MeToo. »
« À travers ce documentaire, on a fait le fil du consentement. On peut peut-être aller plus loin que la seule question du consentement et commencer à définir le « j’ai envie ». »
Sur la liberté du désir
« Pour l’instant, on a le sentiment que tout ce qui concerne les rapports de pouvoir ne s’est pas éclairci. Il y a encore du chemin à faire pour arriver à une liberté libre. »
« Les gros besoins masculins restent encore d’actualité. »
« On est encore au tout début [de cette recherche de la liberté et de l’égalité]. »
« On est dans cette période un peu charnière ou il y a plein de possible mais aussi beaucoup de refus. »
« L’amour à la française est un marqueur politique, comme un marqueur identitaire contre les populations immigrées. On est Français si on est galant, si on sait séduire, etc. Ça vient complexifier la question et la politiser. »