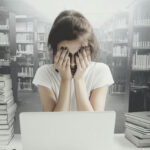Jack Lang : « Si l’on veut sauver le cinéma, il faut prendre le taureau par les cornes »

Exposition « Habibi : les révolutions de l’amour » à partir du 27 septembre à l’Institut du Monde Arabe, place de l’art dans la culture et dans la société, états généraux du cinéma : on a causé avec Jack Lang.
Jack Lang est président de l’Institut du Monde Arabe et ancien ministre de la Culture.
* * *
Regards. À propos de « Habibi : les révolutions de l’amour », dans laquelle 23 artistes queers nous parlent de corps, de sexualité et d’identités multiples, diriez-vous qu’il s’agit d’une exposition de lutte ?
Jack Lang. De lutte… en tout cas celle des peintres, des artistes, est une expression de leur désir de vie. Je lirais plus largement, et d’une façon plus personnelle : je suis depuis toujours attaché à la liberté – liberté d’être, liberté d’écrire, liberté de penser, liberté de vivre sa vie et liberté d’aimer – et que ça ne concerne pas que le monde arabe. Je me bats, donc je lutte, pour cette liberté. Ce n’était pas une évidence, qu’ici même à l’Institut du monde arabe, nous puissions organiser un tel événement qui, j’imagine, suscitera quelques interrogations, des controverses qui surgiront dans tel ou tel pays. Mais je ne les crains pas. C’est une exposition qui permettra de mettre au jour les réalités et l’extraordinaire créativité d’artistes pleinement engagés dans leur art ou dans la vie.
VOIR AUSSI SUR REGARDS.FR
>> Jack Lang : « Dans certains pays, l’art est la seule forme d’expression »
De cette exposition ressort le bouillonnement artistique du monde arabe, mais pas uniquement puisqu’il y a aussi des œuvres qui viennent d’Afghanistan ou d’Iran. Dans ce monde arabe, vous intégrez aussi la diaspora qui vit en Europe ou aux États-Unis. Ce monde artistique transnational, très pluriel, qu’est-ce qui fonde son unité ?
C’est leur histoire commune. Commune et séparée parce qu’il n’y a pas un monde arabe. De plus, il y a des pays qui ne sont pas des pays arabes, qui appartiennent à la civilisation musulmane. Donc c’est beaucoup plus large que le monde arabe, je dirais l’Orient. Mais ce qui fonde l’unité, c’est la langue. Mais cette langue elle-même n’est pas nécessairement connue par ceux de la diaspora. C’est une certaine forme de civilité, de vie. Donc ce n’est pas un, c’est multiple, comme l’est le genre humain.
« Oui ou non veut-on que le cinéma sur grand écran survive ou bien accepte-t-on que petit à petit, insensiblement, le système se dilue, se détricote ? »
Est ce que les queers arabes ont quelque chose à dire au queers français ?
C’est évident. Je ne coupe pas les pays en morceaux, je ne coupe pas les civilisations en morceaux. Je n’aime pas les frontières. J’aime au contraire les ponts qui réunissent plutôt que les murs qui divisent. L’exposition qui réunit des artistes venant principalement de ces pays touche le cœur, la pensée de visiteurs venant de France et d’ailleurs.
Est-ce que l’art est toujours aussi important pour dire le monde, si tant est qu’il ait jamais été important d’ailleurs pour le dire ?
Oui, absolument oui. Parfois, dans certains pays, c’est la seule forme d’expression. Il y a des pays où la parole est interdite, des pays dans lesquels l’homosexualité, par exemple, est interdite et réprimée. Donc l’art, l’écriture, la littérature peuvent permettre à des personnes, à des créateurs, à des artistes de dire ce qu’ils sont sans encourir nécessairement les foudres des autorités. Et puis, au-delà de cette question des autorités, exprimer une passion de vie pour moi, c’est une manière d’être dans la vie, dans la cité. C’est une manière d’être politique, dans le meilleur sens du terme. La politique, c’est l’art de vivre en cité.
Quelle est la place de l’art, aujourd’hui, dans la culture, et est-ce que cette place a reculé depuis le moment où vous étiez ministre de la Culture ?
Plus que jamais, je crois que que l’art est et la culture sont les ciments de toutes nos sociétés. Depuis l’époque où j’ai eu la chance, sous l’impulsion du président François Mitterrand, d’animer une politique de l’art et de la culture qui a concerné tout le pays, qui d’ailleurs s’est étendu à à d’autres pays dans le monde, on a l’impression que les pouvoirs publics nationaux sont timide, parfois en retrait. Aujourd’hui, il y a une ministre de la Culture qui s’appelle Rima Abdul Malak, qui est une femme très engagée sur ces sujets, qui y croit et qui, je le pense, va pouvoir redonner de la vie et de la force à la politique des arts. C’est bien de ne pas perdre la mémoire des choses, non pas pour célébrer le passé, mais pour précisément comprendre qu’aujourd’hui il y a une urgence culturelle, une urgence éducative, une urgence scientifique. Emmanuel Macron est un homme cultivé, qui s’intéresse et qui se passionné pour ces sujets. Mais on a besoin, au-delà d’une impulsion, d’une forte puissance. Il faut que le mot d’ordre soit « donner à nos rêves une réalité ». On n’a pas le sentiment que cela soit partagé par beaucoup.
Jeudi après-midi de 13h30 à 18h dans une salle de l’Institut du monde arabe se tiendra une Agora de réflexion collective sur l’évolution du cinéma et de nos politiques culturelles. Les professionnels du cinéma se réunissent pour appeler à la tenue d’États généraux du cinéma. Il y a péril en la demeure, disent-ils, et ils ont l’impression que les pouvoirs publics, justement, détournent le regard. Est-ce que vous soutenez cette démarche et surtout comment est-ce que vous voyez l’évolution du secteur du cinéma ? Son évolution est-elle porteuse de belles promesses ou est-ce qu’on fonce tête baissée dans une impasse avec l’apparition des plateformes numériques, la disparition des salles ?
Si l’on veut sauver le cinéma, il faut prendre le taureau par les cornes. Aujourd’hui, il est gravement menacé de toute part : par les plateformes, par les géants du net, par les télévisions privées… et par une indifférence. Quand, en 1981, je suis devenu ministre de la Culture de Mitterrand, je voulais aussi que le cinéma sorte d’un risque qui le menaçait. Je voulais ce qui se passait dans les pays voisins, dans des pays qui avaient été des grands pays du cinéma (l’Italie, l’Espagne, l’Angleterre, l’Allemagne). Les uns après les autres, ces cinématographies se sont effondrées en raison de l’impéritie des pouvoirs publics et de la pénétration du système privé des télévisions. À ce moment-là, j’ai dit à François Mitterrand « On ne peut pas accepter ça, il faut que la France sauve son cinéma ». Je pense qu’aujourd’hui la même question se pose : oui ou non veut-on que le cinéma sur grand écran survive ou bien accepte-t-on que petit à petit, insensiblement, le système se dilue, se détricote ?
Propos recueillis par Pablo Pillaud-Vivien