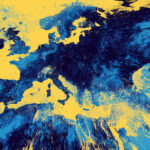TRIBUNE. Mourir au travail : selon que vous serez puissant ou misérable

En France, chaque jour, trois personnes meurent au travail. Une dimension sociétale pétrie d’inégalités, dénoncent les eurodéputés insoumis Marina Mesure et Anthony Smith.
Il y a quelques semaines, un tribunal jugeait la responsabilité d’un chef d’entreprise et de sa société après la mort d’un travailleur dans un accident du travail. La procureure a requis des amendes (entre 1000 et 10 000 euros), dont certaines avec sursis ! Quelques heures plus tôt, sur les mêmes bancs du même tribunal mais dans une autre affaire, deux jeunes prévenus pour trafic de cigarettes avaient écopé de peines de prison avec sursis et de la confiscation de leurs biens.
Cette juxtaposition interroge. Comment comprendre qu’une entreprise mise en cause pour avoir laissé mourir un de ses salariés au travail encourt des sanctions financières et judiciaires faibles voire parfois inexistantes quand d’autres infractions, sans atteinte physique immédiate à une personne, sont bien plus lourdement punies ? Que nous dit cette asymétrie sur la manière dont la justice, et plus largement notre société, considère la vie au travail ? Cela en dit long sur la place du droit pénal du travail en France.
Le 28 avril, la Journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail doit être l’occasion de rappeler que le droit à un environnement de travail sain et sûr est un droit fondamental internationalement reconnu. Pourtant, derrière les discours de façade, une réalité demeure inchangée : c’est l’impunité patronale systémique lorsqu’un travailleur perd la vie.
Les chiffres sont accablants : selon l’Organisation internationale du travail, près de trois millions de travailleurs meurent chaque année dans le monde des suites d’accidents du travail ou de maladies professionnelles. En Europe, on recense plus de 3000 accidents du travail mortels par an et on dénombre en France, chaque jour, trois personnes qui meurent au travail.
Et pourtant, ces drames restent invisibles. Car ils surviennent au travail, dans des espaces où la souffrance et le danger sont invisibles aux yeux du grand public. Il n’y a pas de battage médiatique pour rendre compte de la réalité de ces morts silencieuses, qui ne troublent pas l’ordre public.
D’ailleurs, l’un des premiers effets de l’accident du travail est de diluer la responsabilité individuelle de l’employeur, la « personne physique », au profit de l’entreprise, en tant que « personne morale ». Pourtant, ce sont bien des choix concrets qui exposent les travailleurs aux risques : rythme de production infernal imposé, équipements vétustes, consignes de sécurité contournées…
L’impunité patronale n’est pas un dysfonctionnement du système : elle en est une composante essentielle. Car pour un employeur, faire peser des risques sur les travailleurs est un calcul rationnel. Lorsque l’alternative est une sanction dérisoire, la tentation est grande de fermer les yeux sur des manquements pourtant évidents. À cela s’ajoute une chaîne managériale qui joue un rôle central dans cette mécanique de l’évitement. Les décisions les plus dangereuses sont le fruit d’arbitrages conscients, validés à différents niveaux de hiérarchie. Dans cette organisation floue et fragmentée, chaque maillon de la chaîne peut prétendre ne pas être responsable et invoquer les directives venues de plus haut pour diluer sa responsabilité, à l’image des pratiques de sous-traitance dans le secteur du BTP.
Le ministère du travail lui-même oriente les pratiques en ce sens en abandonnant massivement les outils coercitifs à disposition des inspectrices et inspecteurs du travail et en organisant sciemment le sous-effectif des services d’inspection du travail.
Outre les consignes ministérielles, la justice est défaillante : en France, selon les syndicats, moins d’un tiers des procès-verbaux de l’inspection du travail relevés à la suite d’accidents du travail ont donné lieu à des condamnations. Les chiffres sont dramatiques : en Seine-Saint-Denis, entre 2014 et 2020, sur 150 procès-verbaux dressés par l’inspection du travail concernant des accidents du travail, seuls 43 ont fait l’objet d’une audience devant le tribunal correctionnel ; dans le Bas-Rhin, entre 2012 et 2019, sur 712 procès-verbaux relevés en toutes matières par l’inspection du travail, 50% ont été « classés sans suite » ou sont « en attente » ; dans le Rhône, entre 2017 et 2022, plus de 70% des procès-verbaux de l’inspection ont été « classés sans suite » par les parquets ou ont eu des suites inconnues.
Le rôle des syndicats, pourtant essentiel pour prévenir ces drames et défendre les victimes, a été massivement attaqué depuis qu’Emmanuel Macron, et avant lui François Hollande, dirige le pays. Leur accorder des droits et des moyens supplémentaires permettrait de mener des inspections indépendantes et de remettre les représentants des travailleurs au cœur des politiques de santé et sécurité au travail. C’est notamment ce que nous avons proposé dans notre feuille de route « Zéro mort au travail ».
Quant aux familles et ayant droits des victimes, elles affrontent, outre le chagrin, un parcours judiciaire long, incertain, souvent décevant. La reconnaissance du statut de victime est un combat en soi. L’indemnisation, quand elle existe, ne répare ni l’injustice, ni la douleur. Mais le plus insupportable, c’est le sentiment d’injustice et le silence. Le silence des responsables, le silence médiatique, le silence des institutions. Chaque mort au travail devrait être un scandale national, pas un chiffre s’ajoutant à un autre. Il est temps d’en finir avec l’hécatombe des morts au travail. Parce que personne ne devrait perdre sa vie en tentant de la gagner.
Marina Mesure et Anthony Smith, députés européens de la délégation France insoumise au Parlement européen, groupe La Gauche