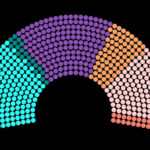La République à toutes les sauces

Le PCF participe à une manifestation de policiers, se fait encenser par le Printemps républicain et met en scène une amorce de dialogue avec, entre autres, la très controversée Caroline Fourest. Ces choix concertés dessinent-ils une ligne politique ? Et si oui, laquelle et que peut-on en penser ?
En proposant à Caroline Fourest d’intervenir lors d’une soirée d’hommage aux victimes de Charlie Hebdo, le 6 janvier dernier à Colonel Fabien, le PCF a pris un risque calculé. Il l’a fait au nom de l’attachement communiste à la laïcité. Le problème est que cette laïcité-là a aujourd’hui de bien curieux défenseurs.
Depuis Samuel Huntington et son « choc des civilisations »[[1993]], on s’est mis à tenir pour une évidence que, une fois terrassé le communisme soviétique, l’islam était devenu l’ennemi principal. Que l’islam historique ait pu être porté à une extrême tolérance, que partout dans le monde des autorités religieuses condamnent les attentats-suicides au nom même du Coran, que l’islam se décline au pluriel et pas au singulier, tout cela n’a aucune importance. Ce qui compte, c’est que l’islam en bloc, par nature quasi exclusive, subordonnerait le politique au religieux et prônerait la lutte contre tout ce qui n’est pas musulman.
Contrairement à ce que l’on entend souvent, la loi de 1905 n’était pas anticléricale. Pour ses principaux promoteurs, et notamment pour les socialistes Aristide Briand et Jean Jaurès, le but n’était pas de proscrire les signes religieux de l’espace public. Depuis le milieu des années 1990, la laïcité de certains a glissé de la liberté de conscience et de la tolérance vers l’exclusion.
La laïcité républicaine est ainsi ravalée au rang d’instrument permettant de conjurer un nouveau spectre, dont on ne sait plus s’il est celui de l’islamisme ou celui de l’islam. Et tout cela, bien sûr, se mène sous la bannière de la loi de 1905. Or, cette loi avait pourtant un seul objectif : séparer les Églises et l’État et assurer ainsi l’indépendance des unes comme de l’autre. Contrairement à ce que l’on entend souvent, elle n’était pas une loi anticléricale. Pour ses principaux promoteurs, et notamment pour les socialistes Aristide Briand et Jean Jaurès, le but n’était pas de proscrire les signes religieux de l’espace public. Il fallait tout simplement éradiquer les souches de ces guerres religieuses qui, depuis trop longtemps, divisaient le peuple et empêchaient de traiter les dossiers bien plus urgents d’une souveraineté vraiment populaire et d’une République sociale.
Or, depuis le milieu des années 1990, la laïcité de certains a glissé de la liberté de conscience et de la tolérance vers l’exclusion. Elle a ainsi participé d’un étonnant paradoxe. Alors que le cours du temps se traduit par un recul général de la croyance, dans toutes les générations et dans toutes les aires géographiques, les crispations identitaires ont produit une poussée générale des intégrismes. Dans ce contexte explosif, intégrismes religieux déclarés et intégrismes laïques peuvent alors se nourrir l’un l’autre, dans un cycle exclusif et continu.
Ils ont tué la laïcité
Le Printemps républicain est particulièrement significatif de ce glissement. Il est né officiellement, au début de 2016, de l’horreur légitime provoquée par les attentats de novembre 2015. Il est au départ connoté à gauche. L’un de ses premiers maîtres à penser est le socialiste Laurent Bouvet, récemment décédé. Préoccupé à juste titre par la « crispation identitaire » qui poussait une part des catégories populaires vers l’extrême droite, le politologue en voyait l’origine dans ce qu’il appelait « l’insécurité culturelle »[[2015]], dont l’expression populaire se trouve dans le classique « On n’est plus chez soi ».
Le peuple serait donc clivé entre une majorité qui ne se sent plus chez elle et une minorité ancrée dans le multiculturalisme. Le « piège identitaire » se referme, nous dit Bouvet, un piège dont les ressorts ne sont ni dans les méandres de la mondialisation financière, ni dans les déboires de l’État-providence, ni dans les pressions ethnicistes et culturalistes de l’extrême droite. C’est la « diversité » qui, d’après lui, « conduit à la dégradation du lien social d’ensemble en raison d’un renfermement des différents groupes sur eux-mêmes ». L’insistance sur la diversité « favorise l’insécurité culturelle des individus et des populations qui n’en sont pas les bénéficiaires ».
Extraordinaire paradoxe ! Ce sont les discriminés qui sont la cause de la machine sociale à discriminer ; ce sont les « minorités » qui sont la source des crispations identitaires de la « majorité » ; ce sont les cultural studies qui provoquent la fixation contemporaine sur les identités. La solution de la crispation identitaire pourrait ainsi couler de source : que les minorités cessent de penser leur « différence » et acceptent leur « intégration ».
Quand ladite République, l’universalisme des Lumières et la laïcité servent à cataloguer, à stigmatiser, à marginaliser ceux qui n’acceptent pas une République du renoncement, peut-on sans risque donner l’impression qu’on préfère discuter avec les nouveaux inquisiteurs qu’avec leurs victimes ou avec ceux qui les défendent ?
En fait, l’analyse a ouvert la voie à une déconcertante évolution. On a ainsi peu à peu glissé des railleries à l’encontre de la cancel culture à la vitupération frénétique du « wokisme ». Quiconque insiste sur la lutte nécessaire contre la violence des discriminations est désormais désigné, au pire comme un « communautariste », au mieux comme un « idiot utile ». La French Theory (Deleuze, Derrida, Foucault…) devient un « virus » pour Jean-Michel Blanquer. Se dresser contre l’islamophobie vaut d’être aussitôt dénoncé comme un « islamo-gauchiste ». Des institutions officielles – le ministère de l’Éducation en tête – patronnent des colloques universitaires chargés de « déconstruire le déconstructivisme » et de donner une onction scientifique à ce qui n’est qu’une nouvelle doxa, parée des vertus rassurantes de la « laïcité ».
On est passé des réflexions argumentées de Laurent Bouvet aux théorisations brutales de Mathieu Bock-Côté, de la Gauche populaire critiquant le think tank socialisant et droitier Terra Nova aux imprécations de Manuel Valls et au maccarthysme de Marlène Schiappa et de Jean-Michel Blanquer. Et tout cela sous les louanges appuyées de Gilles Clavreul et d’Amine El Khatmi, figures de proue du Printemps républicain. L’appel dans Le Monde de 1997 – « Républicains n’ayons plus peur » – s’est abîmé dans la « gauche Finkielkraut »[[Le Point, 2 février 2016]], puis dans une « laïcosphère » des réseaux sociaux, bien trop souvent gangrenée par les trolls de la droite identitaire.
Sur le papier, aucun dialogue n’est interdit avec quiconque se réclame avec constance de la République. Mais quand ladite République, l’universalisme des Lumières et la laïcité servent à cataloguer, à stigmatiser, à marginaliser ceux qui n’acceptent pas une République du renoncement, peut-on sans risque donner l’impression qu’on préfère discuter avec les nouveaux inquisiteurs qu’avec leurs victimes ou avec ceux qui les défendent ? Mettre sous les projecteurs le dialogue avec Caroline Fourest revient aujourd’hui à reconnaître, comme plus légitime que d’autres, un discours qui est en train de devenir une perversion mortelle de la laïcité.
Courir après l’extrême droite pour retrouver le peuple ?
La mode aujourd’hui est à la grande repentance devant le peuple oublié et à la question sociale abandonnée. Il est vrai que les catégories populaires ont été les dindons de la grande farce de la modernisation néolibérale et que la régression sociale s’est installée durablement au nom de l’inénarrable compétitivité. Mais les responsables de cet état de fait sont souvent trop vite trouvés : les bobos enivrés par les vapeurs du « sociétal » et qui ont oublié les saines vertus du « social ». Il faut donc tirer un trait sur cette parenthèse et revenir aux temps heureux du mouvement ouvrier, ces temps où l’on pouvait répéter à l’envi que « quand Renault éternue, la France s’enrhume ».
Tourner le dos au « sociétal » et revenir au « social » ? Comme s’il était possible de séparer un seul instant les effets de l’exploitation, de la domination et de l’aliénation des sociétés de classes. Comme si l’inégalité et la discrimination ne faisaient pas corps, comme si les carences de la répartition ne s’entremêlaient pas avec les logiques de la relégation et de l’invisibilité des humbles. Comme si le « peuple » était un corps social homogène, avec un bloc central majoritaire et « natif », ayant les mêmes attentes, partageant les mêmes rêves et formulant les mêmes demandes que dans le passé. En bref, comme si le peuple et les ouvriers étaient toujours les mêmes et qu’il suffisait donc de « retrouver » le langage qui scellait naguère les accordailles de la gauche et des catégories populaires.
Quelque part, continue de traîner cette conviction ruineuse qu’il n’y a pas d’autre moyen, pour contrer l’extrême droite, que de prendre soi-même en charge ses thèmes de prédilection. Le socialisme au pouvoir s’y est exercé, en se rassurant avec les formules faciles : le FN pose de bonnes questions, mais offre de mauvaises réponses ; la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde ; la gauche doit abandonner les postures morales et le laxisme.
On peut craindre que le salut sympathique au vin et au fromage (Roussel 2022) soit tout aussi inefficace que l’apologie du pull marin rayé bleu et blanc (Montebourg 2015) ou que l’exaltation lyrique d’une « latinité » démocratique contre les vertiges ethnicistes de la « germanité » (Mélenchon 2015).
Est-ce dans un esprit voisin que Fabien Roussel a décidé de s’afficher à la manifestation de policiers et qu’il a pris un malin plaisir à vanter la France du vin et du fromage, certain par avance que ses propos feraient le « buzz » ? Il pourrait pourtant se méfier de ces formules dont on ne sait plus très bien – pour continuer la métaphore culinaire – si elles relèvent du lard ou du cochon. À proprement parler, il n’y a aucune honte à se référer à un certain patriotisme : l’histoire lui a en effet donné une consistance populaire qui a pu, à plusieurs reprises, contredire la propension chauvine que les nationalismes européens ont imprimée sur deux siècles. Va-t-on dès lors se contenter de disputer ce patriotisme aux nationalismes d’aujourd’hui, par on ne sait quelles surenchères ? Le socialisme d’après août 1914 a-t-il brisé l’expansion chauvine des droites extrêmes en se ralliant à l’Union sacrée ? C’est le contraire qui s’est produit : à la fin de la Grande Guerre, la gauche s’est trouvée affaiblie et la droite cocardière a prospéré. Aujourd’hui, on peut craindre que le salut sympathique au vin et au fromage (Roussel 2022) soit tout aussi inefficace que l’apologie du pull marin rayé bleu et blanc (Montebourg 2015) ou que l’exaltation lyrique d’une « latinité » démocratique contre les vertiges ethnicistes de la « germanité » (Mélenchon 2015).
Fabien Roussel a raison de rappeler cette tradition communiste qui, à partir de 1934, s’est attachée à combiner l’esprit internationaliste et la fibre patriotique révolutionnaire de 1792-1794. Les communistes ont alors eu l’intelligence de se détourner tout autant de la surenchère chauvine que du parti pris antinational. Il en est toutefois de cet équilibre comme de tout autre : il ne se reproduit dans la durée que s’il se transforme.
Le cadre national de la vie sociale reste une réalité matérielle et symbolique et il peut être un levier pour l’action. Mais dans le monde interconnecté qui est le nôtre, l’insistance sur le national ne peut plus suffire. Au contraire, le glissement de la spécificité vers la différence, l’exaltation identitaire, l’obsession de la protection, le jeu des supériorités et des infériorités supposées structurelles tournent le dos à ce qui devient de plus en plus essentiel : le parti pris universel du partage et de la solidarité. C’est à donner corps à ce parti pris qu’il faut s’atteler, bien plus qu’à clamer haut et fort que l’on n’est pas du côté de « l’anti-France ».
Ne pas se tromper d’époque, ne pas se tromper de gauche
On a parfois l’impression que le PCF ne résiste pas à la tentation de reproduire de vieux réflexes pour retrouver la place qui fut la sienne jadis. Par exemple, il est vrai que le PCF a assumé pendant quelques décennies un statut de parti d’ordre et de morale. Il le faisait dans un temps où le désir d’une sécurité, d’un ordre et d’une morale commune travaillait les représentations des communautés partageuses et protectrices qui, dans les campagnes et les villes, corrigeaient en partie les désordres et les malheurs de l’exploitation. Mais ce modèle communautaire et la sociabilité qu’elle a produite se sont effacés peu à peu, par l’exigence croissante d’autonomie de l’individu, grâce à la conquête des statuts reconnus, aux progrès du mouvement ouvrier organisé et à l’installation de l’État-providence.
De plus, cet ordre et cette morale populaires ne se confondaient avec l’esprit de résignation, d’acceptation et d’obédience. Leur référence a coexisté longtemps avec une détermination ouvrière farouche face à la violence populaire d’État ; elle n’annulait pas l’esprit de fronde, de lutte ou même de rébellion, quand cela était nécessaire. En ce temps-là, l’acceptation incontournable de la nécessaire présence de « forces de l’ordre » dans les quartiers populaires ne risquait donc pas de déboucher sur la participation à des manifestations policières, que l’histoire a toujours vouées à la plus extrême ambiguïté. Les changements de situation légitiment-ils un changement d’attitude ? On peut pour le moins en douter.
Au fond, s’il est toujours bon qu’un collectif politique ne perde pas la mémoire de ce qu’il fut et d’où il est venu, il tout aussi nécessaire qu’il n’oublie jamais la mise en garde de Marx pour qui l’histoire se répète toujours deux fois : « La première fois comme une tragédie, la seconde fois comme une farce ». De la même manière, il faut prendre conscience de ce qu’une suite d’actes, en apparence différents les uns des autres, peut devenir une ligne politique, voire une culture politique. Il convient alors de s’interroger sur les effets possibles de cette ligne et de cette culture.
Par exemple, quand les dirigeants communistes manifestent avec les policiers, ils semblent continuer la fibre du parti d’ordre, responsable et en état de gouverner. Quand le secrétaire national vante la France des vins et des fromages, il s’inscrit formellement dans la continuité patriotique du parti qui entendait réconcilier le drapeau rouge et le drapeau tricolore. Quand les textes officiels du parti se réclament avec ferveur de l’essor du nucléaire, ils continuent le parti pris rationaliste qui a pu conduire naguère de la défense de la science aux illusions scientistes. Chacun de ces actes peut se discuter, sans se livrer nécessairement au jeu de l’anathème ou de la défense inconditionnelle.
Le PC insiste sur « l’esprit français » et sur « l’identité française » à un moment où la tentation du repli protectionniste s’installe, où les visions de la patrie se font volontiers exclusives, où c’est l’extrême droite qui donne le ton. De même, en lançant un clin d’œil appuyé au laïcisme intransigeant, quand bien même il le fait au nom de la condamnation nécessaire et totale du terrorisme religieux, il se glisse plutôt dans la tonalité de ceux pour qui « l’islamo-gauchisme » est l’ennemi principal.
Mais il y a dans leur addition une trame bien problématique. Tout se passe comme s’il s’agissait avant tout, pour le PC officiel, de se démarquer d’un certain « gauchisme ». Il est vrai que le langage communiste a longtemps reposé sur le double refus de « l’opportunisme » et du « sectarisme » : en pratique, il fallait entendre la double critique du socialisme et de l’extrême gauche. Tout bien considéré, cela lui a permis pragmatiquement de conjuguer la fibre révolutionnaire, qui le protégeait des usures du pouvoir, et le sens majoritaire, qui lui permettait d’inscrire fortement sa marque dans le paysage social et institutionnel.
Encore faut-il maîtriser l’équilibre entre les deux refus. Il fut un temps, comme dans les années 1960-1970, où la crainte du débordement « gauchiste » a nourri une méfiance corrosive à l’égard des mouvements de fond qui traversaient l’espace public français (féminisme, écologie, autogestion, « nouveaux mouvements sociaux », etc.). À d’autres reprises, comme dans les années 1950 ou à la fin des années 1970, la crainte du débordement « réformiste » (« mendésisme », socialisme mitterrandien) poussa les communistes vers un raidissement qui les pénalisa jusque dans les catégories populaires.
Pense-t-il aujourd’hui que la crise politique lui permet de reconquérir une part de l’espace perdu au profit de Mélenchon et de sa France insoumise ? Depuis quelque temps, son ancien allié devenu concurrent assouplit plus ou moins son tropisme « républicain » et « vieille gauche » pour séduire des générations nouvelles éloignées de l’engagement électoral et partisan. Le PCF considère-t-il que la reprise des thèmes abandonnés par le concurrent lui permettent de « faire la différence » et de reprendre la main ? Peut-être. En recueillera-t-il quelques fruits ? L’avenir proche le dira.
Mais force est de signaler d’ores et déjà les effets potentiels de ce choix. Le PC insiste sur « l’esprit français » et sur « l’identité française » à un moment où la tentation du repli protectionniste s’installe, où les visions de la patrie se font volontiers exclusives, où c’est l’extrême droite qui donne le ton. De même, en lançant un clin d’œil appuyé au laïcisme intransigeant, quand bien même il le fait au nom de la condamnation nécessaire et totale du terrorisme religieux, il se glisse plutôt dans la tonalité de ceux pour qui « l’islamo-gauchisme » est l’ennemi principal. Enfin, il affirme son choix enthousiaste du nucléaire, alors que l’état d’esprit à gauche reste, soit au refus persistant du nucléaire, soit à une acceptation prudente par « raison » (l’urgence du réchauffement climatique).
La tradition politique du communisme, en tout cas depuis les prémices du Front populaire, est de considérer que, s’il faut rassembler la gauche, on ne peut à aucun moment oublier qu’elle est polarisée. En particulier, la tension de la rupture systémique et de l’accommodement pragmatique est au cœur de la dynamique de gauche en longue durée. Estimer que la force respective des deux pôles n’est pas un enjeu secondaire et qu’il ne relève pas que des conflits de chapelles ou des querelles d’ego est une chose. C’en est une autre que de considérer que cet enjeu prime sur le nécessaire rassemblement, surtout quand l’existence politique de la gauche est en jeu et que la droitisation de la droite est en cours d’accélération.
Nous sommes dans un moment où, plus que jamais, s’impose la double exigence inséparable d’une gauche rassemblée et d’une gauche bien à gauche, le plus loin possible des renoncements des dernières décennies. Donner l’impression que l’on « tacle » surtout la partie gauche de la gauche, laisser entendre que l’on discute plus facilement avec un côté qu’avec l’autre : voilà qui ne serait pas émettre un bon signal.
Mais il est toujours possible de corriger ce qui doit l’être.